| Publié par (l.peltier) le 17 septembre 2008 | En savoir plus |
fin 1918
La terre, la mer… les deux grandes nourricières de l’homme depuis le nuit des temps. Le Grand métier de Jean Recher date de 1977. Il concerne l’immédiat après-guerre, à partir des années 1950. Mais l’essentiel de la vie dont il parle n’a guère changé depuis la naissance de ce grand métier au tout début du XVI° siècle. Le Grand métier, c’est celui de la grande pêche qui, parce qu’effectuée en des mers lointaines, signifiait une absence de plusieurs mois de la maison familiale quand la petite pêche était côtière et permettait de rentrer tous les jours à la maison.
En annexe au Grand métier, Paul Adam, chef de la division des Pêcheries à l’OCDE dans les années 1970, a écrit une histoire de la pêche à la morue qui retrace l’essentiel de l’évolution de ce métier, du début du XVI° siècle à nos jours :
En décrivant son expérience du grand métier, Recher a donné nombre d’explications techniques simples et claires. Il a de plus ajouté un glossaire reprenant beaucoup de termes spécialisés, familiers ou patoisants, utilisés par les pêcheurs morutiers. Il n’est donc pas question de compléter une œuvre remarquable qui fera date.
Mais le monde des morutiers, leurs techniques, leurs traditions sont si profondément ancrés dans certains lieux du littoral français et si étrangers aux terriens qu’il n’est peut-être pas inutile d’en préciser certains aspects, en donnant aussi le point de vue de quelqu’un dont la profession a exigé qu’il reste en contact permanent avec les morutiers et réfléchisse à leurs problèmes. Voici bientôt trente ans qu’à des titres divers, sur le plan de la France ou d’une organisation internationale, j’ai eu à défendre les intérêts de la pêche et j’ai pu mesurer la distance qui sépare les uns des autres.
Si à Yport on parle du grand métier, dans les milieux spécialisés on parle de la grande pêche. Ce même adjectif employé par les professionnels et les administratifs exprime bien une même appréciation des mêmes faits malgré le fossé qui sépare la connaissance concrète de la connaissance abstraite.
Il y a longtemps déjà que Pierre Loti puis la pêche française à la morue d’Islande sont morts. Aujourd’hui sonne le glas de la pêche française à la morue de Terre-Neuve. Une quinzaine de bateaux sont encore partis pour la première campagne du début de 1977 ; aux alentours de Pâques, ils seront rentrés et il n’y aura pas de seconde campagne. Pourront-ils repartir en 1978 et combien seront-ils?
Le premier débarquement de morue salée venant de l’autre côté de l’Atlantique – et dont les archives aient conservé la trace – a eu lieu à Dahouet (petit port de Bretagne nord, à 25 km à l’est de Saint-Brieuc) vers 1509… moins de vingt ans après la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb. Depuis, à part les interruptions dues aux guerres – et seulement durant certaines d’entre elles – la grande pêche française n’a jamais cessé son activité, activité qui fut considérable dans la nation tout au long des siècles.
Avant 1789, on pouvait dénombrer plus de 300 navires et plus de 10 000 marins pêcheurs. Avec la vapeur, le diesel et le chalut, le nombre des navires et des équipages s’est sérieusement réduit. Mais c’est seulement durant la dernière décennie que l’accélération du processus s’est affirmée. 1972 : 1 500 marins seulement. Aujourd’hui et demain ? On tend vers zéro.
Des origines à la fin du XVIII°, durant trois siècles, les morutiers français ont pratiqué deux sortes de pêche. La plus importante débarquait hommes et matériel sur la côte de Terre-Neuve ou du Labrador, le bateau ne servant que de moyen de transport pour l’aller et le retour. La pêche se pratiquait à partir de chaloupes sortant seulement pendant la journée ; c’est à terre qu’on salait-séchait la morue. L’autre pêche, pratiquée par des bateaux moins nombreux et moins gros, était appelée pêche errante ; le bateau se laissant dériver en pleine mer, les hommes se servaient de lignes à main du bord même du bateau où la morue était ensuite travaillée. Durant ces longs siècles, la royauté, très soucieuse d’avoir à sa disposition des équipages rompus à des navigations difficiles, exprima sa sollicitude à l’égard de la grande pêche en instituant un système d’aide sociale financée grâce aux cotisations des armateurs et des marins ; la contrepartie : un service militaire obligatoire – à l’époque il ne l’était pas – sur les navires du roi. Il y avait aussi des privilèges commerciaux, des droits réduits sur le sel (la gabelle)… et en conséquence des contestations sans fin.
Peu avant 1789, commence une pêche nouvelle, en pleine mer ; le bateau étant à l’ancre, les chaloupes qu’il transportait partaient du bord dans toutes les directions, chacune ayant son secteur de la rose des vents, pour pêcher puis revenaient au bateau pour livrer le poisson et le travailler. C’est cette pêche qui s’est pratiquée toute la première moitié du XIX° siècle et qui a continué durant la seconde moitié, les lourdes et dangereuses chaloupes étant alors remplacées par des doris, barques à fond plat, que l’on disait d’inspiration indienne et mises au point par les marins américains : non seulement elles étaient plus légères, mais elles présentaient aussi l’insigne avantage, sur ces goélettes où la place était rare, de pouvoir s’encastrer les unes dans les autres. Il en fut ainsi jusqu’en 1939. Toutefois, dès avant le début du XX° siècle, on avait inauguré le chalutage avec vapeur et chauffe au charbon d’abord, puis le Diesel. Le chalutage par le côté décrit par Recher au début de son livre.
À partir de 1950 et surtout de 1960, nouvelle révolution technique : addition d’engins électroniques variés, chalutage par l’arrière avec véritables usines installées à bord. Le progrès accompli durant les quinze à vingt dernières années, extrêmement efficace mais incontrôlé, réduisit peu à peu les ressources disponibles de morue, portant gravement préjudice aux pêches françaises en premier lieu. En effet, la France – et c’est un trait singulier sur lequel il y aurait beaucoup à dire – ayant un solide marché pour la morue salée ne devait se mettre que très progressivement à la congélation : résistance des mentalités des producteurs ou des consommateurs, l’un suivant l’autre comme le berger, dit-on, suit les moutons. J’ai vécu cette évolution : les modernistes voulant tout surgeler, les traditionalistes disant qu’ils n’avaient pas les moyens financiers… Pour une fois, ce n’est pas coutume en économie, le juste milieu a gagné, ou du moins a subsisté mieux que les autres c’est-à-dire ceux qui ont continué à faire du salé tout en commençant à congeler selon le dosage inconnu qu’il fallait deviner.
En tout cas notre pays qui, avant 1939, détenait la première place après le Canada sur les bancs de l’Ouest Atlantique, commença à se faire distancer dès après 1945 : d’abord par les Espagnols et les Portugais, consommateurs traditionnels de morue salée qui, sans doute à cause d’une main-d’œuvre meilleur marché, ont pu maintenir en activité des techniques anciennes plus ou moins modernisées : dorissiers à moteur parfois utilisés avec des filets maillants (longs filets droits soutenus par des bouées et dans les mailles desquels les poissons se prennent par les ouïes), chalutiers-bœufs (parejas en espagnol, pair trawling en anglais) qui travaillent par paires, chacun tirant une des funes, l’ouverture du chalut étant commandée par l’écartement des deux bateaux. Notons en passant que les chalutiers de fond, comme ceux de Recher, évitent dans la mesure du possible ces bateaux dont les engins de pêche se tiennent au-dessus du fond ou l’effleurent seulement, ce qui leur permet de fréquenter des parages rocheux où les lourds chaluts à panneaux risqueraient de crocher. Mais Espagnols et Portugais qui cherchaient le même produit que les Français et qui se modernisaient plus lentement encore ont été eux aussi dépassés par les flottes des pays de l’Est européen et d’Allemagne fédérale. Ces derniers avaient des navires équipés des techniques les plus modernes ; et en même temps que la morue, qu’ils ne salaient pas, ils cherchaient tous les poissons qui avaient un marché. Renversement des choses qui allait aboutir entre autres à la fin de la grande pêche française.
Si nous voulons mieux comprendre les problèmes économiques actuels, reportons-nous d’abord aux origines de la grande pêche.
Pendant plus de 450 ans, la grande pêche a, chaque année, fourni des dizaines de milliers de tonnes de morue salée, ce qui correspond au triple en poids vif puisque la morue, après avoir été éviscérée, étêtée, désarêtée et entassée avec du sel, perd une partie de son eau. À l’arrivée en France, un kilo de morue verte (c’est l’expression technique consacrée) correspond à trois kilos péchés. Et quand on sèche encore davantage la morue, comme c’était le cas autrefois dans les sécheries provisoires sur le littoral de Terre-Neuve, ou encore pour l’expédier dans certains pays tropicaux, le rapport peut être de 1 à 5. Il faut donc être très prudent quand on manipule les statistiques.
Pendant plus de 450 ans, la grande pêche a donc fourni de grandes quantités de morue salée, protéine du pauvre, pêchée par des pauvres. Pour qu’il y eût industrie dans l’économie de l’Ancien Régime, c’est-à-dire production de masse, il fallait que les prix fussent très bas et ils continuèrent de l’être longtemps après la révolution industrielle.
À la veille de la guerre de 1939, quand Recher a commencé à naviguer, le prix moyen de la morue salée ramenée au poids vif était encore cinq fois plus faible que le prix moyen de la morue fraîche (cabillaud) pêchée en mer du Nord. Il fallait donc que les Terre-Neuvas prennent, tranchent, éviscèrent, salent… au moins cinq fois plus de morue que les Boulonnais.
Après 1945, la situation devait changer peu à peu, d’abord à cause du développement de la congélation, ensuite à cause de la raréfaction du poisson, tant et si bien que ce rapport de 1 à 5 passa de 1 à 2,5 ou 2 au début des années 60, puis de 1 à 1,8 ou 1,6 durant les années 71 à 73 ; enfin, de 1 à 1,3 en 1975. Certes, il s’agit là de chiffres moyens qui ne tiennent pas compte des variations de prix selon la taille des poissons (on sale les gros et on congèle les petits), mais la tendance est très nette et ce ne sont pas des corrections de décimales qui changeraient le fait que les dernières années ont été exceptionnelles dans la longue histoire de la pêche à la morue.
Ainsi, jusqu’en 1939 la morue fut une nourriture de pauvre, ce qui ne veut pas dire qu’elle soit devenue une nourriture de riche lorsque, salée ou séchée, son prix a rejoint celui du bifteck : il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un produit déshydraté (c’est-à-dire représentant deux ou trois fois plus de protéines au kilo) et qui ne donne pas de déchets. Parallèlement, jusqu’en 1939, la morue a été produite par des pauvres ; si, depuis cette date, le grand métier a été mieux rémunéré, il n’en reste pas moins que pêcher la morue n’est pas encore le meilleur moyen de faire fortune.
Le schéma de recrutement du marin morutier ne varie pas. Ce dernier ne vient pas du port d’armement mais d’un village voisin. Paysan sans terre, condamné à être ouvrier agricole sur un terroir où il y en a déjà trop, il préfère embarquer. Si tout va bien, il gagne à peu près autant qu’un bon ouvrier de la ville (à Paris, en 1789, une livre tournoi, soit un franc-or par jour). Mais assurément, la pêche n’est pas toujours abondante… Il arrive que, déduction faite des avances perçues au départ, le marin rentre à la maison avec rien ou quasi-rien ; il y a des mauvaises années et des malchanceux… moins à plaindre que ceux qui ne reviennent pas, car les risques de ne pas revenir, dans ce dangereux métier, sont exceptionnellement élevés : naufrages, hommes enlevés par une lame, doris perdus en mer…
Il semble bien qu’après 1850 (une analyse détaillée des chiffres donnés par Henri du Rin sur la pêche morutière dunkerquoise apporte à ce sujet plus que des présomptions), le salaire du morutier soit tombé au-dessous de celui de l’ouvrier des villes, à moins que ce ne soit ce dernier qui ait alors été relevé. C’est que, pour pêcher la morue, on en était toujours à naviguer à la voile tandis que dans tous les autres métiers on s’industrialisait. L’armement à la grande pêche abandonna donc des ports devenant florissants comme Dunkerque pour se rapprocher des lieux où l’on pouvait trouver de la main-d’œuvre à bon marché. Ce fut la raison pour laquelle Fécamp, par exemple, passa de petit à grand port morutier. Le pays de Caux, aux structures féodales, fournit son contingent annuel d’hommes sans terre, durs à la tâche, solides, encadrés par ces marins nés que sont les Yportais, les Fécampois et les Havrais.
On aimerait pouvoir mieux chiffrer ces salaires ou gains et les comparer avec ceux d’autres catégories. Mais si des structures socio-économiques permettant la grande pêche ont persisté, ce fut dans la mesure où subsistaient des espèces d’enclaves trop populeuses pour les ressources disponibles, enclaves qui n’étaient pas encore vraiment ouvertes au monde économique moderne et où n’était plus suffisante cette vie ancienne faite pour une part importante d’auto-suffisance et de relations personnelles.
À cette époque, comme le dit la chanson, pour devenir capitaine de pêche, il fallait commencer par être mousse et passer par tous les grades. Le patron devait connaître chacun des aspects du métier, y compris les pires. Toutefois, c’est jeune qu’on devenait capitaine, car après 25-30 ans et une bonne dizaine de campagnes sur les bancs, il devenait hors de question de trouver encore le courage de s’asseoir à l’école pour obtenir les diplômes exigés.
Au temps de la voile, les capitaines gagnaient évidemment plus que les dorissiers mais pas tellement plus. On comptait les morues et chacun était payé à la part. Il n’y avait alors ni contrat collectif ni salaire minimum garanti. Les premières actions syndicales sérieuses datent seulement d’après 1914 et leurs résultats furent progressifs, très lents.
Il fallut attendre 1945 pour qu’un contrat d’engagement fût négocié pour toute la profession. On avait alors définitivement abandonné la voile, ce qui avait pris du temps car elle n’exigeait que des investissements faibles et permettait de mieux tirer sur les coûts. Les premiers chalutiers à vapeur, à piston et au charbon ne donnaient d’ailleurs qu’une autonomie assez réduite pour les grandes distances à parcourir. Puis ce fut le Diesel ou la turbine avec leurs auxiliaires, enfin le Diesel électrique (un gros moteur Diesel fournit du courant qui alimente à la fois la propulsion, et les auxiliaires servant à virer le chalut et faire fonctionner les frigos, etc.). Comme ces améliorations coûtaient de plus en plus cher, elles ne furent pas toujours adoptées à temps… et puis un bateau doit durer une bonne vingtaine d’années : c’est ce qui explique que, parfois, les chalutiers français ont eu des moteurs trop faibles pour chaluter assez profond ou des coques trop minces pour jouer les brise-glace.
La période de 1950 à 1975 fut une sorte de jeu, subtil ou féroce, où la grande pêche a dû s’adapter à un développement général de type suicidaire. Les prises de morue des côtes canadiennes et groenlandaises, dans l’Atlantique nord ou est, tous pêcheurs réunis, ont jusqu’à 1960 frôlé le million de tonnes pour atteindre 1.100.000 tonnes en 1960, 1.300.000 en 1961, 1.600.000 en 1967, 1.800.000 en 1968… Après quoi, on est redescendu nettement au-dessous du million de tonnes. En somme, on est passé de prises excessives, coûtant de plus en plus cher et provoquant de périodiques chutes de prix, à des prises faibles insuffisamment compensées par des prix en hausse. Après la période euphorique de 1945 /47 où il y avait tout à la fois abondance de poissons et de consommateurs et où seuls les bateaux manquaient, des difficultés surgirent. Recher, qui a vécu cette grande mutation, raconte que, pour répondre aux exigences de la vente, son navire fut choisi pour des essais de congélation. À la même époque, j’assistais, en tant, que représentant du Secrétariat à la Marine marchande, à d’interminables réunions où l’on tentait de canaliser des opérations d’export-import dans lesquelles les bénéfices sur des machines comptables ou autres objets importés devaient compenser les pertes sur les exportations de produits variés, dont la morue. Les pays sous-développés, principaux acheteurs de morue salée, en auraient acheté bien davantage, mais ils n’avaient pas de devises et les vendeurs se tournaient tous vers Porto-Rico qui payait en dollars.
Pour les morutiers eux-mêmes, la grande affaire fut le passage au chalutage arrière. Assurément, un chalutier par le côté, comme un chalutier par l’arrière, tire le chalut sur son arrière. La différence est que le premier le relève et le met à l’eau par le côté, alors que le second le relève et le met à l’eau par l’arrière. Les manœuvres ont toutefois des implications qui dépassent cette différence de base.
Quand le chalut est relevé par le côté, il faut procéder en hissant autant de palanquées qu’il y a de fois 2 à 3 tonnes dans le fond du chalut (on dit le cul du chalut). En effet, dans l’eau, le poisson ne pèse rien et il oppose seulement la résistance due au frottement des filets d’eau. Par contre, si le cul du chalut était hissé hors de l’eau avec 5 ou 10 ou encore 20 tonnes, les mailles du filet ne sauraient résister à un tel poids et casseraient. Dans les navires modernes où le chalut est relevé par l’arrière, il y a des détails variables et complexes. L’essentiel est que, le cul du chalut laissant reposer une grande partie de son contenu sur la rampe arrière du navire, la manœuvre de relevage peut être faite d’un seul coup et plus rapidement sans que la solidité des mailles du filet soit mise en danger.
Le relevage du chalut par le côté impose que le pont, dans sa plus grande partie, soit dégagé et qu’il soit maintenu relativement bas au-dessus de l’eau. D’où la silhouette typique des chalutiers par le côté qui, à la suite de l’expérience de plusieurs générations, étaient arrivés à une disposition quasi normalisée avec le pont dégagé et le château sur l’arrière, ce qui, par mauvais temps, permettait une excellente tenue à la cape, machine arrêtée ; les morutiers disaient à la cholle. En effet, offrant davantage de prise au vent sur l’arrière, le navire tendait à pivoter sur son centre de dérive pour tourner son avant vers la direction du vent et des vagues.
Le relevage du chalut par l’arrière conduit au contraire à dégager l’arrière et à repousser le château vers l’avant. De plus, il devient inutile d’avoir un pont proche de l’eau. D’où un pont couvert supplémentaire qui permet à l’équipage d’être à l’abri pour le travail du poisson. Net progrès dans les conditions de travail, mais aussi possibilité de continuer à travailler par des temps plus mauvais, de monter plus au nord, dans les glaces, avec des navires renforcés, etc. Le travail reste toujours dur, physiquement très pénible et le relevage du chalut par l’arrière, s’il est plus rapide, est parfois aussi délicat et plus dangereux. Quand une fune (nom donné aux filins qui servent à tirer le chalut) balaie le pont ou qu’une vague s’engouffre par la rampe arrière, les risques pour l’homme sont considérables.
Mais c’est par ses conséquences économiques que le chalutage par l’arrière a rapidement bouleversé la pêche sur les bancs du plateau continental canadien et groenlandais.
La distance entre ces bancs et les côtes européennes rendait très aléatoires des voyages pour le poisson frais sur glace : ou il restait trop peu de temps pour la pêche proprement dite, ou on risquait de ramener du poisson en décomposition. Il fallait donc saler le poisson à bord ou s’abstenir si l’on n’avait pas de marché pour la morue salée. Mais le chalutage par l’arrière, avec un pont supplémentaire permettant l’installation d’une véritable usine à bord, coïncida avec le développement de la surgélation. Il devenait ainsi possible de fournir un marché potentiel beaucoup plus vaste et de ne plus se concentrer sur la seule morue. Le résultat fut un accroissement spectaculaire du nombre des navires et des quantités de poisson péché. Tant et si bien que les stocks de poissons, et notamment la morue toujours la plus recherchée, furent exploités au-delà du maximum renouvelable, la quantité de poissons disponibles devenant de moins en moins grande alors que les bateaux devenaient de plus en plus nombreux. Il est évident que les taux de prises par navire diminuèrent. C’est pourquoi on ne construisit plus de saleurs purs : on aurait été sûr d’y perdre de l’argent car les saleurs ne pouvaient conserver à bord que de la morue ; or, pour rentabiliser les voyages, il fallait pêcher tout ce qu’on trouvait, jusqu’à l’encornet que l’on surgèle et dont les Japonais sont friands. Peine perdue. Même les gros chalutiers congélateurs voient depuis quelques années leur rentabilité fortement compromise. Devant la menace de la surexploitation des fonds de pêche, les organismes internationaux réglementaires ont enfin institué des contingents de prises, en nette réduction par rapport aux prises antérieures. De plus, les Etats côtiers, forts de l’évolution en cours du droit de la mer, ont étendu leurs eaux réservées (on dit zone économique exclusive) et considèrent comme leur propriété les poissons qui peuvent être péchés jusqu’à 200 milles au large…
Cette évolution, qui conduit à la disparition du grand métier, apporte aussi l’explication d’une différence d’appellation. En effet, on entend souvent déclarer en France : Le cabillaud, j’aime bien ; mais pas la morue. Il s’agit pourtant du même poisson. Seulement, quand commença à s’étendre, à l’intérieur du pays, la consommation de poisson de mer frais (en grande partie avec le développement du chemin de fer), les pêcheurs de morue fraîche en mer du Nord (à partir de Boulogne-sur-Mer) voulurent, pour ne pas manquer la clientèle riche, distinguer leur poisson de la morue salée des morutiers terre-neuvas ou islandais, qui se vendait nettement moins cher et gardait sa réputation de poisson des pauvres ou de jours d’abstinence. D’où, pour la morue fraîche, l’appellation de cabillaud (terme de même origine que Kabeljau en allemand). La France est le seul pays où existe une telle distinction, mais c’est aussi le seul pays à avoir eu deux pêches importantes distinctes, l’une pour la morue fraîche, l’autre pour la morue salée à bord. Cette distinction, qui se maintient sur les marchés, est devenue absurde du fait que sur les mêmes bateaux de grande pêche, on congèle et on sale le même poisson vendu salé sous le nom de morue et congelé sous le nom de cabillaud !
On a aussi essayé de congeler la rascasse du nord, nom séduisant donné à un poisson rose et laid qu’on prend quelquefois avec la morue et que les saleurs rejetaient à la mer alors même qu’il y avait une clientèle en Allemagne. Mais le nom n’a pas apporté le succès commercial escompté auprès des consommateurs français. Recher l’a rebaptisé fausse rascasse car les Fécampois – qui savent manger – connaissent et apprécient la vraie, irremplaçable dans une bouillabaisse digne de ce nom.
Ces distinctions entre les poissons conduisent à parler de la rémunération des pêcheurs qui se comptait, à bord, non pas en francs mais en morues. Le poisson autre que la morue, c’est-à-dire qu’on ne pouvait pas saler, était du faux poisson, comme à terre on dit de la fausse monnaie.
Les morutiers sont toujours payés, selon le prix de la morue, à la part de pêche, avec un minimum garanti correspondant aux salaires de base des marins du commerce. Mais si, les prises étant insuffisantes, ce minimum doit jouer, le grand métier est trop dur pour une telle rémunération.
Le pêcheur ressemble au paysan qui, on le sait, se trouve rarement satisfait sur tous les plans, mais de plus les terrains de pêche qu’il fréquente et qu’il connaît, comme le paysan ses champs, ne lui appartiennent pas. Cependant, l’un dans l’autre – et à condition de ne pas faire le compte de ses heures de travail, mais quoi faire d’autre à bord – le morutier qui a fait le métier sur de bons bateaux depuis 1945 peut considérer qu’il a bien gagné sa vie ; mieux qu’à terre. Il est évidemment difficile de donner des chiffres, car ils varient selon les années et les individus de façon notable. Disons qu’un bon capitaine de pêche pouvait gagner plus qu’un haut fonctionnaire de l’administration de la Marine marchande. Toutefois, il est impossible de comparer sérieusement les métiers ou les retraites qui sont (en tenant compte de revalorisations récentes) au maximum de 5 000 F par mois pour un capitaine de pêche ayant 37 ans % de service et de 2 150 F pour un matelot.
Aujourd’hui, un chalutier moderne est une usine périmée en moins de dix ans et valant plus de 30 millions de francs (3 milliards de centimes) qui, pour faire ses frais, doit rapporter au moins le tiers par an… Aussi est-il impossible, dans la conjoncture actuelle, de penser construire de tels bateaux.
Peut-être est-ce le temps de réfléchir à nouveau – mais c’est le dernier rendez-vous– sur des politiques, des progrès techniques et des structures économiques qui ont fait un grand métier que les autorités françaises ont soutenu et aidé pendant près d’un demi-millénaire, un métier qui aujourd’hui disparaît, mettant au chômage des spécialistes qui avaient pourtant su rester dans la tradition tout en s adaptant aux perfectionnements les plus modernes.
À Recher mousse, matelot léger, capitaine – écrivain aussi par l’effet de je ne sais quelle grâce – à Recher, sac à terre… il reste d avoir été un témoin privilégié exceptionnel. Par père et frères interposes, il a vécu dans la légendaire Fécamp, la vieille tradition de la grande pèche à la voile la plus dure qu’il y ait jamais eu. Et il a aussi connu les développements les plus avancés dans une exponentielle de croissance qui a fini par le mettre au chômage…
Une vie qui en moins de quarante ans, l’a fait passer de l’âge de Jacques Cartier à celui de l’Électronique !…
Paul Adam, chef de la division des pêcheries à l’OCDE Mars 1977
Le récit qui suit est extrait d’Avec les bagnards de la mer du Père Yvon. S’il ne représente pas une situation générale, mais bien exceptionnelle, il n’est cependant aucunement une fiction, et dit combien ces hommes pouvaient se faire à l’inacceptable, quand ils avaient la possibilité de faire ce à quoi que leurs aïeux s’étaient parfois résolu : jeter le commandant à la mer.
Le Père Yvon, 1888-1955, fût, entre autres apostolats, aumônier des Terre Neuvas… Yvon le Typhon pour son biographe Alain Guellaf.
Aussi fort en gueule que l’abbé Pierre…
Tous ceux qui s’intéressent à la vie des marins-pêcheurs ont entendu parler du Père Yvon, l’aumônier des terre-neuvas.
Un tempérament de feu, une liberté d’esprit, une énergie indomptable, un génie de la communication au service d’un engagement militant en faveur des forçats de la mer, en font une figure mythique.
Un homme d’Église, un moine capucin aussi surprenant, aussi iconoclaste, aussi important pour l’amélioration du sort des marins-pêcheurs que l’abbé Pierre le fut pour les mal-logés.
Ses films – il utilise le cinéma dès les années 20 – ses livres, notamment Avec les Bagnards de la Mer, ont réussi à faire comprendre, à émouvoir sur le sort inhumain des hommes et parfois des enfants engagés dans la Grande Pêche.
L’épopée de sa goélette-hôpital, le Saint- Yves, apportant courrier, secours et réconfort sur les Bancs de Terre Neuve reste dans la mémoire de tous les gens de mer.
Mais les Bancs de Terre Neuve ne sont qu’une part limitée de l’existence extraordinaire d’un homme qui a vécu mille vies, des tranchées de la Grande Guerre aux contrées les plus reculées de l’Inde.
Franck Martin. Éditions de l’Ancre marine
Une tête au raz des épaules : une figure bouffie où se projetait l’étrave d’un nez obtus ; des yeux injectés de sang, exorbités comme des yeux de hanneton ; un front proéminent strié de rides moulées par son caractère hargneux ; un corps bien cordé, tissé de muscles puissants mais noyés dans la graisse d’une corpulence carrée ; des lèvres gourmandes ; une gueule de bouledogue à voix de canon ; des bras longs projetant des mains violentes, terribles, à gros doigts plats : voilà le capitaine Jean Le Roux !
Un capitaine, conscient de ses responsabilités et soucieux d’épargner la vie de ses hommes, consulte le baromètre et inspecte l’horizon avant de commander la sortie des doris. Jean Le Roux, le cerveau intoxiqué d’alcool, le corps lourdement collé à sa couchette, tous les matins, sans aucun souci de la prévision du temps, hurlait d’une voix rauque et sauvage : Croche !
Le marin a une âme de discipline, mais l’abus brutal de l’autorité le révolte.
Un matin, devant le baromètre tourmenté de crises d’épilepsie depuis plusieurs heures, le second fit remarquer au capitaine combien il était imprudent de faire mettre les doris à la mer.
Croche ! hurla la brute, c’est ainsi qu’on gagne son bifteck, bande de feignants !
Sur les conseils du second, les hommes crachèrent dans les doris et les projetèrent à la mer ; mais le second leur recommanda d’avoir l’œil sur le bateau et de rallier dès qu’ils verraient le pavillon en berne.
Les hommes obtempérèrent à ses conseils.
La brise soufflait et verdissait de plus en plus. Le V aigu, enregistré par le baromètre, est le signe avertisseur infaillible de l’approche d’une perturbation atmosphérique cyclonique. Devant cette menace écrite d’un coup de chien, le capitaine et les hommes du bord furent pris de frissons.
Effrayé par la terrible perspective des conséquences dramatiques de son inconscience, le capitaine perdit de sa pression alcoolique, et fit mettre immédiatement le pavillon en berne.
Les lames, encore petites, couraient les unes après les autres. Leur nervosité dénotait que la mer, dont elles sont l’épiderme, se trouvait dans un état de fièvre et de surexcitation extraordinaire.
Soudain, on eût dit que toute cette masse liquide eût pris feu ; il en sortait des fumées avec un grésillement sinistre comme d’une matière qui cuit et qui brûle !
La goélette, tenue en laisse par son énorme câble de mouillage, était comme prise de stupeur ; elle cherchait à se dégager par des bonds et des efforts violents pour fuir le temps. Elle ressemblait à ces chevaux fougueux qui, pris d’épouvante, se cabrent et s’agitent pour casser brutalement les attaches qui les retiennent captifs.
Les doris, pauvres feuilles de bois au milieu des éléments déchaînés, se débattaient dans la tourmente. Halés par des muscles d’une puissance titanesque multipliée encore par la rage et la brutalité de l’instinct de conservation, ils montaient sur les crêtes des vagues et s’engouffraient dans leurs creux. Les embruns se dressaient en volutes et, chassés par le vent, cinglaient violemment les nageurs et remplissaient les doris. De temps en temps, on voyait un homme soulager les embarcations à l’aide d’une écope, tandis que l’autre redoublait d’efforts pour maintenir son doris bout à la lame. Ceux qui se trouvaient dans le vent au bateau ralliaient sans trop de peine, mais ceux qui étaient sous le vent au bateau gagnaient difficilement.
Jean Le Roux, flagellé par les douches glaciales de paquets de mer qui déferlaient sur le pont, perdait toujours de sa pression alcoolique et retrouvait progressivement sa lucidité d’esprit ; il commençait à réaliser puissamment l’horreur du drame dont il avait la responsabilité coupable. Debout sur le gaillard-arrière, agrippé au roof de la cuisine, il regardait au large avec des yeux de hanneton. Quand il voyait les doris plonger dans les creux béants, il éructait d’une voix rauque, rageusement, horriblement, un cri de désespoir :
Malheur ! Ils sont foutus !
Dans cette mer devenue sauvagement folle furieuse, la goélette qu’ils voulaient regagner, la goélette qui voulait les sauver, était devenue pour les doris le danger le plus menaçant, le pire ennemi. S’ils parvenaient à l’accoster, ils avaient les plus grandes chances de venir se fracasser contre sa coque, d’être écrasés par un coup de hanche au roulis ou d’être soulevés par un paquet de mer qui les écraserait sur le pont ou sur le bord de la lisse. Il fallait, coûte que coûte, déborder les doris.
Tous les hommes du bord s’étaient munis de bouées, de gaffes, de filins. Le second avait empoigné un rouleau de cordages dont il avait fait un énorme lasso. Penchés sur la lisse, le cou allongé, les yeux exorbités braqués sur les doris qui approchaient, anxieux, haletants, conscients de la gravité de la minute, de la seconde où la vie de leurs camarades allait dépendre de l’adresse et de la rapidité de leur intervention, tous attendaient.
Tout à coup, on voit monter à l’horizon une horde de nuages, telle une armée tumultueuse, se bousculant à l’assaut des pauvres doris. Le vent les mène comme un troupeau, les cingle, les mord, les bouscule, leur arrache des flocons de laine noire pour les déployer en rideaux superposés, d’un noir qui obscurcit tout. Le noir du ciel qui se reflète dans l’eau l’a transformée en encre de Chine.
L’eau tourmentée donne l’impression d’un incendie d’océan, tantôt elle grésille comme sur de la braise, tantôt ses lames explosent et se tordent comme des flammes blanches dans un ronflement de fournaise.
Le vent souffle avec une violence qui cingle et cuit la peau des joues ; il coupe la respiration ; il crie et gémit dans les haubans, les cordages et les antennes, avec des cris et des gémissements d’enfants pris de peur soudaine et de souffrance affolante.
Un doris approche ! À chaque traction sur les avirons, les hommes poussent des hans formidables de bûcheron ; ils ont l’écume aux commissures labiales et un air hagard de malheureux qui, depuis une heure, luttent avec un acharnement farouche contre la mort et qui se demandent si, après tant d’efforts, ils ne vont pas sombrer à l’entrée du port !
Le second, avec une force de catapulte, lance son lasso. Bien envoyé ! Il a pris son homme à plein tronc. Le marin dépose ses avirons, saisit le câble à pleines mains et, en charriant son doris, se laisse amener le long du bord. De la goélette, les hommes, à l’aide de leurs gaffes, débordent le doris pour l’empêcher de se briser contre la coque, tandis que l’autre marin passe les crocs aux extrémités du doris pour l’embarquement. Puis les ordres tombent en cascade :
Paré à virer ? Virez ! Mais vire donc ! Décolle ! Mais décolle donc. Les salauds ! ils vont tout casser. Tiens bon! Tiens bon ! Amène ! Amène doucement ! Attention ! Larguez tout ! … Et d’un ! La manœuvre se renouvelle 5 fois, 10 fois, 12 fois ! À cinq reprises, les hommes sont tombés à la mer !
Il fallut alors se livrer à un jeu effrayant. Du bord, les sauveteurs, à coups de gaffes, pèchent dans la baille avec une brutalité de chirurgien. Les crocs mordaient dans les vêtements et les chairs. La charité a parfois des nécessités cruelles pour le salut de la vie !
À deux reprises, la mer, au moment de l’ascension des doris, piocha deux hommes, les happa et les entraîna. Ils faisaient surface mais ils perdaient. Le mousse, perché dans les haubans, aperçut leur détresse, il appela Turc, le superbe terre-neuve du bord, son meilleur ami, et, lui montrant les hommes en perdition, il l’incita à se jeter à l’eau :
Tiens ! Tiens ! Turc !… Vas-y ! Vas-y ! Turc !… Amène ! Amène ! Turc !
Turc sauva les deux hommes !
Trois doris manquaient !… Tout l’équipage, anxieux, inspectait la mer d’un regard scrutateur !
Second ! s’écria un homme, là-bas, à deux cents mètres, un canard boiteux !
Deux hommes halaient sur les avirons avec rage et frénésie. Ils étalaient, mais ils ne charriaient plus…
Le second fit filer un doris à l’aide d’un filin. Les deux doris se rencontrèrent. Les deux hommes s’agrippèrent au doris sauveteur. Du bord, les hommes halèrent le convoi. Malheur !… Le filin cassa à 15 mètres de la goélette ! Les deux hommes reprirent leurs avirons et halèrent dessus avec la rage du désespoir… Ils gagnèrent le bord, mais, au moment où l’équipage s’apprêtait à les embarquer, une montagne énorme fonça sur la goélette : Sauve qui peut ! hurla le second. Les hommes s’agrippèrent où ils purent. Le doris fut soulevé violemment au-dessus de la goélette et, à la chute, se cassa en deux sur la lisse !… Les deux hommes disparurent…
Au bout d’une minute, le patron reparut à la surface. Une plaie béante au front, il saignait affreusement ; mais il nageait par la force de l’instinct de conservation. Commotionné, assommé, abruti, il prenait la direction opposée du bateau… D’un coup de gaffe, le second le hala vers lui ; deux hommes l’empoignèrent au collet et le jetèrent par-dessus bord.
Le matelot avait disparu… Tous le croyaient perdu ! Mais non… Il était resté accroché par ses cirés au tangon de bâbord ! Quand le roulis inclinait le navire à tribord, le malheureux émergeait et criait : au secours ! Quand le roulis inclinait le navire à bâbord, le malheureux plongeait et buvait à la tasse ! Il fut bientôt aperçu et halé à bord.
Deux doris manquaient…
Dans sa furie, l’équipage voulut se précipiter sur le capitaine ! Arrêté par l’autorité et le prestige du second, il hurla, pendant quelques minutes, son indignation au chef responsable du malheur :
– C’est toi qui les a lavés ! Bandit ! Crapule ! Assassin ! Vampire ! Requin ! Tu as sur la conscience quatre noyés, trois veuves et huit orphelins !
Soudain, on vit accourir le mousse, les yeux hagards, déments. Il déclara au second qu’il venait de couper, d’un coup de hache, le câble de mouillage de la goélette, et qu’il lui accordait, à lui et à tout son équipage, quinze jours de permission pour aller à Saint-Pierre-et-Miquelon chercher un autre câble…
C’était la première campagne du petit mousse ! Le choc des horreurs dont il venait d’être témoin avait été trop violent… Il était devenu fou…
4 péris en mer, 3 veuves, 8 orphelins et… un fou ! ! ! Joli bilan de commandement pour Jean Le Roux !
Père Yvon Avec les bagnards de la mer. Éditions de Paris.
13 11 1918
Création aux Bouffes Parisiens de l’opérette Phi Phi, sur une musique d’Henri Christiné, un livret d’Albert Willemetz et Fabien Sollar. De la légèreté, et encore de la légèreté : on en redemandera sans interruption jusqu’en novembre 1921, avec de nombreuses représentations en province.
19 11 1918
Le général Hirschauer, Lorrain de Saint Avold est entré à Mulhouse deux jours plus tôt, le général Messimy à Colmar la veille ; et c’est au tour de Pétain d’entrer à Metz. Tu peux m’enterrer maintenant, écrit Maurice Barrès à son fils. Le lendemain, c’est Gouraud qui entre à Strasbourg ; le maréchal Foch y sera six jours plus tard pour un défilé solennel.
Ou Wilson ou Lénine. Ou la démocratie née de la Révolution française, fortifiée par les luttes de tout un siècle, ou bien les formes primitives, incohérentes, brutales du fanatisme russe. Il faut choisir.
Albert Thomas, socialiste réformiste L’Humanité
11 1918
L’amiral Koltchak russe farouchement opposé aux Bolcheviques fonde à Omsk, bien à l’est de l’Oural, un gouvernement, se proclamant chef suprême de toute la Russie. Il marche vers l’Oural.
1 12 1918
Proclamation du royaume SHS, – Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes – qui regroupe douze millions et demi de ces peuples. Alexandre, de la dynastie serbe des Karageorgevitch, en deviendra le roi en 1921.
5 12 1918
Le Nationalrat d’Alsace-Lorraine proclame le rattachement du Reichsland à la France. Mais une décision politique votée par des députés est loin de pouvoir aplanir toutes les difficultés qui surgissent ; c’est Jules Jeanneney, ancien sous secrétaire d’État à la Guerre de Georges Clemenceau, qui centralisera l’action des commissaires de la République désignés à Strasbourg – Bas Rhin -, Colmar – Haut Rhin -, et Metz – Moselle -.
Dans les livres d’histoire, on vous dit que l’Alsace et la Lorraine ont été rattachées à la France dès novembre 1918. Il n’y a rien de plus faux. Nous avons vécu sous le joug d’une administration militaire d’exception qui nous a fait payer l’affront fait à la cathédrale de Strasbourg. Il nous a fallu prouver notre appartenance au peuple français, devant des Commissions de réintégration dans la nationalité française présidées par des officiers du Deuxième bureau. Plus de cent cinquante mille d’entre nous, les plus remuants, ont été expulsés vers l’Allemagne. Quinze ans plus tard, ils ont été les premiers à peupler les camps de concentration nazis.
Didier Daeninckx. Mort au premier tour. Éditions Denoël 1997
Une fois les premiers moments d’euphorie passés, l’installation de l’administration française n’ira pas cependant sans quelques heurts et beaucoup d’incompréhension de part et d’autre. Il ne suffit pas de quelques décrets pour effacer quarante huit ans d’occupation allemande. Les Français croyaient retrouver l’Alsace Lorraine de Hansi ou du Tour de la France par deux enfants. Exaltés par les Oberlé de René Bazin ou par le roman de Barrès Au service de l’Allemagne, ils s’attendent à accueillir une province martyre, figée dans le souvenir. Mais l’Alsace, plus encore que la Lorraine annexée, a évolué. Certes, elle conservait toujours à la veille de la guerre de fortes attaches sentimentales avec l’outre-Vosges (où d’ailleurs un grand nombre de ses enfants étaient établis), mais elle en avait aussi trouvé sa place dans le Reich. En 1911, le début d’autonomie qui lui avait été accordé avait satisfait beaucoup de monde.
La germanisation est bien réelle dans les provinces : l’école, l’université, l’administration et l’armée ont conjugué leurs efforts pour y parvenir. La langue française n’est plus parlée que chez les élites et les habitants des quelques zones rurales francophones, […] ainsi que par un dernier carré de militants à Metz. Depuis 1870, l’exil volontaire a privé la région des plus ardents fidèles de la France. Ajoutons à cela le traumatisme causé à des provinces en majorité catholiques, et très pratiquantes, par la rigueur de la république anticléricale. Pendant ce temps, l’Allemagne de Bismarck puis de Guillaume II dotait le Reichsland d’une législation du travail moderne, de retraites, d’assurances sociales et d’institutions décentralisées ; et la région goûtait à la prospérité économique.
[…] Ce qui rend difficile la réintégration pure et simple, c’est d’abord la question religieuse. L’Alsace et la Moselle [nouveau nom du département qu’était la Lorraine annexée], qui n’étaient plus françaises au moment du vote de la loi de séparation des Églises et de l’État en 1905, sont en effet encore soumises au Concordat de 1801, maintenu par l’Allemagne après 1871. L’Église catholique […] occupe une place très importante dans la vie sociale et politique. Or elle a joué un rôle de premier plan en faveur de l’idée française pendant les années d’annexion allemande. La partie est serrée, d’autant que protestants, Juifs, et même certains libéraux laïques se joignent aux cléricaux pour demander le maintien du statu quo.
La République est donc placée face à un dilemme : l’affrontement satisferait les radicaux et les socialistes, qui entendent appliquer l’intégralité des lois françaises aux territoires libérés ; mais composer avec la réalité du terrain permettrait de faire l’économie des scènes pénibles vécues en France en 1901-1906, et, au prix d’une entorse à la loi, de réintroduire plus sûrement la culture française. Par la loi d’octobre 1919 le gouvernement choisit la seconde solution et décide la mise en place d’un régime particulier qu’il veut croire transitoire [1].
Une autre question épineuse est celle de la langue : comment imposer, par exemple, à un instituteur alsacien de donner du jour au lendemain toutes ses leçons en français, langue qu’en général il maîtrise mal, au risque de le faire passer pour plus bête que certains de ses élèves ? La République prudente tolère donc dans un premier temps des enseignements en allemand.
[…] Reste qu’au-delà des discours l’accumulation des maladresses par certains fonctionnaires venus de la France de l’intérieur ou par des revenants (les descendants des Alsaciens Lorrains partis en France après 1871) est à l’origine du malaise alsacien, qui ne tarde pas à se faire jour. Les anecdotes fourmillent sur la morgue de fonctionnaires s’offusquant de l’ignorance de la langue française de leurs administrés, des noms de famille à consonance germanique ou de l’accent de la population, ou encore sur l’anticléricalisme militant de certains instituteurs.
Jean-Noël Grandhomme. Mensuel L’Histoire. Novembre 2008
8 12 1918
Les élections pour l’Assemblée nationale des 16 et 30 novembre ont amené une écrasante majorité favorable au gouvernement : c’est la Chambre bleu horizon. Les larmes de Clemenceau s’adressent aux 24 députés alsaciens et lorrains.
10 12 1918
Fritz Haber reçoit le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur la synthèse de l’ammoniac. Dès 1908, il avait découvert comment remplacer le salpêtre, indispensable à la fabrication de la poudre à canon, mais dépendant d’importations du Chili ou d’Inde car il n’y avait pas de gisement en Allemagne, par l’azote prélevé dans l’atmosphère. En 1915, il avait prouvé l’efficacité de ses connaissances avec le gaz de chlore qui avait tué cinq mille soldats alliés le 22 avril 1915 à Ypres : ces messieurs de l’Académie royale de Suède ne lui en ont pas voulu pour autant : après tout Nobel est bien l’inventeur de la dynamite !
Six mois plus tard, le traité de Versailles confisquera les brevets des grandes firmes allemandes de la chimie : BASF, Bayer, Agfa, Hoechst, Haber Bosch, pour le plus grand profit de l’Américain DuPont qui s’engouffrera dans le vide ainsi créé.
14 12 1918
Les Parisiens réservent un accueil triomphal au président des États-Unis, Woodrow Wilson.
16 12 1918
Le général Janin et les forces de la Mission Française arrivent à Omsk, 800 km. à l’est de l’Oural. Mais son titre de commandant en chef des forces alliées en Russie restera lettre morte : il va vite se heurter à l’opposition du général anglais nommé à la tête de la Mission britannique et à l’amiral Koltchak, à la tête des Russes Blancs. Les Tchèques, qu’il est censé embarquer pour l’Europe tiennent le transsibérien, les gares et commencent à être infiltrés par les Bolcheviks.
27 12 1918
On se bat aussi à l’ouest de la Russie : les Makhnovistes attaquent l’arsenal d’Ekaterinoslav. Ils finiront par voir leurs anciens alliés bolcheviques se retourner contre eux et les défaire en 1920. Blessé à plusieurs reprises, Nestor Makhno s’exilera et terminera sa vie à Paris, ouvrier chez Renault à Boulogne Billancourt.
Makhno était un véritable anarchiste, il galopait sur des chevaux qui tiraient de petits attelages, les tachanki, tout en brandissant un drapeau noir. Son idéologie était bien claire mais ses hommes, eux, pillaient, violaient, assassinaient en traversant les petits bourgs de paysans juifs.
Jacobo Glantz
1918
Émotion à la Principauté de Monaco, mais aussi au Quai d’Orsay : le prince Louis, né en 1870, fils d’Albert, le grand océanographe, n’a pas d’héritier, et dans ce cas, le trône passera au plus proche parent, le prince d’Urach, un Allemand : impensable pour la France ! Louis vivait dans un château du nord de la France, d’où il gérera à partir de son avènement en 1922, les affaires de son État de moins de deux km² et de vingt quatre mille habitants. Mais auparavant il avait fait son service militaire dans l’armée française en Algérie où, de son union avec Marie Juliette Louvet, née à Pierreval, en Seine Maritime, il avait eu une enfant naturelle, Charlotte, née le 30 septembre 1898 à Constantine, qui sera infirmière pendant la guerre ; pressé par le Quai d’Orsay, il va la reconnaître en 1919 ; elle va devenir princesse en épousant en 1920 un prince de Polignac, à qui l’on dira : désormais, tu ne t’appelleras plus Polignac, mais Grimaldi ; ils auront deux enfants, Antoinette et Rainier, en 1923. Louis se mariera sur le tard, trois ans avant sa mort avec une femme de trente ans sa cadette, Ghislaine Dommanget. Ouf, à grand renforts de trucages en tous genres, la continuité dynastique est assurée !
Les premiers réfrigérateurs se nomment Kelvinator et Frigidaire.
3 01 1919
Chaïm Weizmann, un des leaders du mouvement sioniste et Fayçal, le prince hachémite d’Arabie dont Lawrence d’Arabie avait été le conseiller, sont arrivés à Paris pour la conférence de Versailles avec un peu d’avance ; ils se voient et signent un document vantant les liens du sang et les rapports historiques entre leurs deux peuples, stipulant que, si le grand royaume indépendant souhaité par les Arabes venait à se créer, il encouragerait l’établissement des Juifs en Palestine.
6 au 13 01 1919
Les socialistes allemands majoritaires et réformistes ont suffisamment vu à l’œuvre les communistes de Russie depuis leur prise du pouvoir il y a plus d’un an pour se dire : pas de cela chez nous, nous ne pourrons pas le tolérer ; ce n’est pas pour en arriver à cette inversion du monde que nos parents ont construit patiemment et en travaillant beaucoup un des premiers pays du monde. Aussi mettent-ils beaucoup d’énergie à contrer les communistes allemands. Et puis il est bien possible aussi que Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg n’aient pas eu le génie manœuvrier de Lénine et de Trotski
La répression qu’ont subi les marins de Kiel donne du poids à la Ligue spartakiste qui appelle les ouvriers de Berlin à la grève, ils sont 500 000 à cesser le travail pendant une semaine. Ils vont être brutalement réprimés ; 32 communistes dont leurs meneurs Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg seront capturés par les Freikorps et assassinés le 15 janvier, le premier selon une apparente légalité, la seconde assassinée par Hermann Souchon, un officier de marine qui monta en route dans la voiture qui l’emmenait à la mort et la tua d’une balle dans la tête. Rosa sera inhumée dans un cercueil … vide le 25 janvier. Son corps sera repêché le 31 mai et elle sera à nouveau inhumée le 13 juin, suivie d’une foule considérable. Née Rozalia Luksemburg au sein d’une famille juive, elle avait été plâtrée pour conjurer une tuberculose osseuse, épreuve qui l’avait fait boiter, ce qu’elle était parvenue à dissimuler.
18 01 1919
Ouverture de la Conférence de la paix, à Versailles, dite encore Conférence de Paris. Elle se terminera fin août 1920, coiffant les traités de Versailles, le 28 juin 1919, Saint Germain en Laye [Autriche] le 10 septembre 1919, Neuilly [Bulgarie] le 27 novembre 1919, Trianon [Hongrie] le 4 juin 1920, Sèvres [Turquie] le 10 août 1920, qui sera remplacé par le Traité de Lausanne du 24 juillet 1923, Rapallo [Allemagne URSS] le 16 avril 1922.
Lors de cette conférence de la paix, les vingt-sept pays ont accepté de déléguer leurs pouvoirs à un Conseil des dix, qui ne sert pas à grand-chose. Dans les faits, toutes les décisions importantes sont prises par les quatre grands, les chefs des puissances victorieuses. Le Français Clémenceau, le Britannique Lloyd George, l’Américain Wilson et l’Italien Orlando. Leurs désaccords sautent vite aux yeux.
L’Italie a accepté d’entrer dans le conflit en échange de promesses de territoires dans les Alpes, de l’Istrie, de la côte dalmate ou encore des terres qu’elle appelle irrédentes, comme la ville de Fiume. Mais Wilson refuse la majorité de ces demandes au nom du principe des nationalités : la plupart de ces territoires sont peuplés de Slaves, qui doivent donc être rattachés à la fédération des Serbes, des Croates et des Slovènes. Avant même la fin de la conférence, Orlando, furieux, claque la porte, et les nationalistes italiens exploitent le thème de la victoire mutilée de leur pays.
Pour l’essentiel, il incombe à trois hommes de remettre le monde d’aplomb et de garantir la paix. Celui qu’ils conçoivent est boiteux à la naissance.
François Reynaert. La Grande Histoire du Monde. Fayard 2016
21 01 1919
En Irlande, les élections générales de 1918 avaient donné 73 sièges au Sinn Féin sur 105. Seul résistait l’Ulster avec 23 députés unionistes. Les députés du sud font sécession en se constituant en Assemblée d’Irlande – Dáil Éireann -, élisent comme président le seul commandant survivant de l’insurrection de 1916, Eamon de Valera, et proclament l’indépendance de l’Irlande. Et aussitôt commencent à claquer au long des chemins creux du Tipperary les premiers coups de feu de la guerre d’indépendance avec Michael Collins comme insaisissable stratège. Pour pacifier l’île, l’Angleterre va envoyer les anciens combattants de 14-18, et, dans l’Irlande du Nord, les catholiques vont être chassés de leurs emplois, expulsés de leurs foyers et agressés par des foules de protestants fanatisés.
8 02 1919
Ouverture de la première ligne aérienne commerciale française : Lucien Bossoutrot, sur un Farman-Goliath, transporte onze passagers entre Toussus-le-Noble et Croydon, en Angleterre, trois jours après le premier vol commercial réalisé en Allemagne.
2 03 1919
Dans l’ancien palais de justice du Kremlin, ouverture du congrès qui aboutit à la Troisième Internationale : pour la différencier de la deuxième, Lénine et Trotski décident de la nommer Internationale communiste, alias Komintern. C’est un triomphe pour les deux dirigeants.
Trotsky avait fière allure avec son pardessus en cuir, ses guêtres, sa culotte de cheval et son chapeau en fourrure portant l’insigne de l’Armée rouge ; mais pour ceux qui l’avaient connu comme l’un des plus grands antimilitaristes d’Europe, le spectacle était bien étrange.
[…] La conférence du Kremlin se termina par les chants et la photo habituelle. S’apercevant que Trotski venait de quitter la tribune après son allocution, le photographe, qui avait tout juste installé son appareil, protesta énergiquement. Quelqu’un cria à la dictature du photographe et ce fut au milieu d’un éclat de rire général que Trotski retourna à la tribune pour s’y tenir debout en silence, pendant que le photographe, nullement décontenancé, prenait deux photos.
Arthur Ransome, journaliste britannique.
À la conférence qui prépare cette III° Internationale, en 1919, ne viennent que 35 organisations représentant essentiellement Russes, Lettons ou Ukrainiens. Elu président, Zinoviev y voit pourtant le signe avant-coureur de la République soviétique internationale. Il devrait déchanter
La deuxième réunion de cette IIIe Internationale (Komintern), en juillet 1920, se réunit, elle, dans une atmosphère d’apothéose, à un moment où l’Armée rouge de Trotski menace jusqu’à Varsovie. Les images cinématographiques montrent les visages rayonnants des délégués du monde -occidental : les Français Marcel Cachin et Louis-Oscar Frossard, l’Allemand Paul Levi, l’Italien Giacinto Serrati, etc. A la tribune, Lénine et Zinoviev indiquent les 21 conditions qu’ils mettent à l’adhésion au Komintern : elles entraîneront une scission des partis socialistes en France, en Italie ou en Allemagne.
Ainsi, au moment où l’on croit la révolution imminente ailleurs qu’en Russie, l’Internationale communiste devient un appareil dépendant des dirigeants soviétiques. Si on suit la doctrine de Lénine, résumée dans L’Etat et la Révolution (1917), le socialisme doit instaurer le contrôle ouvrier de la production et l’autogestion, supprimer police, armée et Etat. Magnifique programme qui a enflammé les révolutionnaires du monde entier.
Dans la pratique, cela s’est traduit par la création de la Tcheka (décembre 1917), de l’Armée rouge (mars 1918), la nationalisation des entreprises (1918), par le retour nécessaire de l’obéissance à une volonté unique dans l’Etat, celle du parti (décret de 1919).
Mais le pays a faim, a froid, en a assez du travail forcé, de la terreur ; la Russie est devenue un cimetière, dans les campagnes surtout, où les révoltes sont incessantes. Dans les villes, les malheureux se pressent pour demander du pain et des médicaments, car le typhus a frappé. A Petrograd, 64 % des usines ont dû fermer faute de combustible.
Double réalité d’un pays qui souffre, tout en rejetant l’idée de restaurer le passé, mais qui, à l’extérieur, prend les traits d’une société qui annonce au genre humain un avenir nouveau.
Résumé de Marc Ferro. Le Monde Juillet 2017
23 03 1919
À l’initiative de Benito Mussolini, quelques dizaines de personnes se réunissent piazza San Sepulcro, Milan pour créer une organisation qui perpétuera l’inspiration révolutionnaire et patriotique de l’interventionnisme de gauche : le Fascio milanese di combattimento – Faisceau milanais de combat, plus brièvement parti fasciste, qui ne va connaître qu’une bien modeste audience pendant plus d’un an : il y avait moins de 300 personnes au départ ; dans l’opposition c’était alors Gabriele d’Annunzio qui avait encore la cote, mais plus pour longtemps.
Le terme fascio est à lui seul tout un programme. Il évoque à la fois l’unité de la Nation, l’autorité nécessaire à son épanouissement (le faisceau des licteurs dans la Rome antique), la solidarité des membres du corps social, ainsi qu’une tradition révolutionnaire et spontanéiste qui va des faisceaux de travailleurs siciliens de 1893-1894 aux faisceaux d’action révolutionnaires des interventionnistes de gauche.
Pierre Milza. Histoire de l’Italie. Arthème Fayard 2005
28 03 1919
À la conférence de la paix, Wilson – 63 ans – et Clemenceau – 78 ans – s’affrontent. Wilson a exigé une version en anglais du traité : pour la première fois, le français cesse d’être la langue de la diplomatie. Sitôt arrivé, Clemenceau maugréait : Quatorze points ? alors que Dieu lui-même s’est contenté de dix points. Cet homme serait-il au-dessus de Dieu ?
Wilson J’ai une si haute idée de l’esprit de la nation française que je crois qu’elle acceptera toujours un principe fondé sur la justice et appliqué avec égalité. L’annexion à la France de ces régions [la Sarre et Landau] n’a pas de base historique suffisante. Une partie des ces territoires n’a été française que pendant vingt-deux ans ; le reste a été séparé de la France pendant plus de cent ans.
La carte de l’Europe est couverte, je sais, d’injustices anciennes que l’on ne peut pas toutes réparer.
Ce qui est juste, c’est d’assurer à la France la compensation qui lui est due pour la perte de ses mines de houille, et de donner à l’ensemble de la région de la Sarre les garanties dont elle a besoin pour l’usage de son propre charbon. Si nous faisons cela, nous ferons tout ce que l’on peut nous demander raisonnablement
Clemenceau Je prends acte des paroles et des excellentes intentions du président Wilson. Il élimine le sentiment et le souvenir : c’est là que j’ai une réserve à faire sur ce qui vient d’être dit. Le président des États-Unis méconnaît le fond de la nature humaine. Le fait de la guerre ne peut être oublié. L’Amérique n’a pas vu cette guerre de près pendant les trois premières années ; nous, pendant ce temps, nous avons perdu un million et demi d’hommes. Nous n’avons plus de main d’œuvre. […] nos épreuves ont crée dans ce pays un sentiment profond des réparations qui nous sont dues ; il ne s’agit pas seulement de réparations matérielles : le besoin de réparations morales n’est pas moins grand. […]
Vous cherchez à faire justice aux Allemands. Ne croyez pas qu’ils nous pardonneront jamais ; ils ne chercheront que l’occasion d’une revanche ; rien ne détruira la rage de ceux qui ont voulu établir sur le monde leur domination et qui se sont crus si près de réussir.
29 03 1919
Raoul Villain, l’assassin de Jaurès est gracié. Il a été félicité pour avoir rendu service à la patrie et la famille du disparu se voit contrainte de payer les frais du procès ! Le président du tribunal déclare sans souciller : Si l’adversaire de la guerre, Jaurès, s’était imposé, la France n’aurait pas pu gagner la guerre. Villain va se cacher à Ibiza, jusqu’à ce que les républicains espagnols le trouvent en 1937, et lui tranchent la gorge.
Fin mars 1919
Joseph Kessel arrive à Vladivostok. La traversée des États-Unis a parfois frisé l’hystérie : dans les petites villes où ne sont pas prévus des arrêts, les gens se couchaient en travers des rails pour arrêter le train et fêter les soldats.
Dès l’arrivée [à San Francisco] à la descente du train, une foule en liesse nous a assiégés. Journalistes, photographes, opérateurs de cinéma étaient au premier rang. Puis des femmes, des femmes. En blouse de la Croix Rouge, en tailleur, en manteau, vieilles, jeunes, vendeuses, serveuses, millionnaires, toutes criant riant, riant, tendant vers nous des fleurs, des billets de rendez-vous, des cigarettes, des lèvres. À ne pas croire… En toute conscience, je n’exagère pas.
Nous étions logés dans le même hôtel, le plus luxueux de la ville : le San Francis. Quand on commandait un verre au bar, le barman refusait l’argent. Pour les chambres, elles étaient offertes par la direction. Et même dans la rue, quand on prenait un taxi, c’était pareil, impossible de payer. Tout nous était donné. Nous allions de réception en réception, de gala en gala, et de boîte en boîte et, partout où nous entrions, tout le monde se levait, hommes et femmes. Et l’orchestre entamait La Marseillaise puis La Madelon.
L’arrivée à Vladivostok, c’est autre chose :
Après le fourmillement, le tumulte, les édifices grandioses du port de New York, la baie sublime de San Francisco, sa Golden Bay, après les plages d’Honolulu et la magie de la Mer Intérieure, après tant de soleil, de vie intense et de beauté, qu’avions-nous sous les yeux ? Une lumière lugubre ; un port gelé ; des bateaux pris dans la glace ; sur les quais, des coolies chinois en guenilles semblaient des larves humaines. Tout – le ciel, la glace, les maisons, les gens -, tout était gris, triste, sale.
Enfin, déployés en grand arc de cercle, fantômes d’acier noir dans la brume, leurs tourelles braquées sur la ville, des cuirassés japonais. Oui, japonais. Dans cette guerre-là, ils étaient nos alliés. Pourquoi ? Contre qui ? J’avoue que je ne m’en souviens pas, si je l’ai jamais su. En tout cas, leurs bâtiments de guerre étaient là, monstres noirs assis dans la glace, gardiens d’un continent livide
[…] Ainsi, aux Japonais le port indispensable, unique, sur une mer accessible toute l’année par brise-glace. Aux Tchèques, le rail, l’artère nourricière, vitale. Japonais et Tchèques, deux forces supérieurement organisées, sûres, efficaces.
Mais pour le reste : désordre, incohérence, pagaille, bordel. C’étaient les propres termes des officiers qui nous renseignaient. Ils étaient écœurés. Cette expédition contre nature, rameutée des quatre coins du monde, pour affronter un ennemi fantôme et qui maintenant avait mis bas les armes, était un incroyable magma. On aurait pu croire à certains traits qu’elle était l’œuvre d’un fou.
Le corps de troupes anglais comptait un bataillon venu des Indes et celui des Français des éléments du Tonkin. En Sibérie, en plein hiver ! Parce que c’était plus près, sans doute.
Et puis il y avait tous les déserteurs et prisonniers de guerre des armées austro-hongroises constitués en détachements indépendants, nationalité par nationalité, et qui relevaient d’un état-major spécial – c’est-à-dire de personne.
– Vous avez vu en venant ici les patrouilles ? disaient nos informateurs. Elles ont bonne mine, non ? Eh bien, elles représentent douze pays différents – un soldat par pays. Oui, douze. Comptez avec nous : États-Unis, France, Angleterre, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Serbie, Japon. Et, enfin, Russie.
– Mais quelle Russie ? avons-nous demandé.
Là, c’était véritablement un cauchemar.
Au sommet de la hiérarchie, dans Omsk, la grande ville sibérienne, siégeait l’amiral Koltchak. Il était entouré de tous les attributs extérieurs du pouvoir : il avait un Premier ministre, un gouvernement, un grand état-major, un arroi démesuré de hauts généraux, de hauts dignitaires, de hauts patriarches de la vieille et sainte Russie. Proclamé régent de l’Empire, Koltchak avait fait serment d’anéantir les Rouges et de rétablir sur le trône l’héritier des tsars.
Mais, dans l’Empire, la Russie d’Europe, celle qui possédait les vraies ressources, en population, en industrie, en hommes d’élite, les Soviets en étaient les maîtres. Et à travers la Sibérie, immense à coup sûr, mais terriblement sous-peuplée et à demi sauvage, Koltchak pouvait seulement compter sur quelques régiments démoralisés de l’armée régulière et quelques bataillons d’officiers blancs qui servaient comme simples soldats.
[…] Et tout le monde, pour le ravitaillement, dépendait du Transsibérien – c’est-à-dire des Tchèques-, et du port de Vladivostok – c’est-à-dire des Japonais -.
Et les partisans rouges menaient une guérilla incessante, acharnée.
Et Semenov, l’ataman, le maître de Tchita… Semenov, simple sous-officier aux cosaques de l’Amour. Parti, il n’y avait pas deux ans, avec sept hommes, pas un de plus, disait-on, faire la chasse aux partisans rouges. Pris toutes les armes qu’il trouvait en route. Rameuté les étudiants en rupture d’université, les forçats en rupture de bagne, les soldats déserteurs, les chercheurs d’or dégoûtés de leurs mines, les trappeurs fatigués de leurs pièges, les vagabonds sans feu ni lieu, ni loi, qui rodaient à travers les taïgas et les toundras infinies. Formé pour le pillage, l’alcool, les filles et le sang, d’abord une sotnia, puis une bande, enfin une armée. Proclamé ataman. Installé à Tchita. Seigneur de la guerre civile.
[…] Oleg, son sbire à Vladivostok, invite Kessel chez lui, en l’occurrence, un train : Car ce n’était qu’un train. Blindé sans doute. Mais rien qu’un train. Et malgré moi, j’ai pensé à l’autre, celui des tieplouchki [les morts du typhus, regroupés dans un autre train]. Tous mes muscles se sont crispés quand j’ai gravi derrière mon guide les marches qui menaient à l’un des wagons.
Alors, alors, la tête, véritablement, m’a tourné. Un vertige. Un vrai vertige. J’ai du fermer les jeux pour retrouver un semblant d’équilibre, de raison. Car le contraste entre ce que j’avais vu quelques heures plus tôt et ce qui se passait ici, avait de quoi rendre fou.
Déjà, en eux-mêmes, les trains du Transsibérien étaient d’une espèce particulière. L’écart entre les rails qui dépassait de beaucoup celui des autres pays faisait les compartiments plus spacieux qu’ailleurs et, pour répondre aux exigences des voyages faits dans un climat terrible, sur une distance et d’une durée sans pareilles, on les avait équipées avec un soin, un confort, comme l’on en trouvait nulle part. Mais cela n’était rien.
Je sortais du froid de la nuit, du labyrinthe gelé des rails sur la terre des hommes perdus et je me trouvais d’un seul coup à bord d’une vaisseau pirate chargé de ses trésors. Je n’invente point. C’était comme ça.
Wagons-salons, wagons pour les repas privés, wagons munis de lits comme des cabines de luxe et qui servaient autrefois aux princes, aux barines, au hauts dignitaires de la Sainte Russie, les hors la loi de Semenov en avaient fait leur gîte, leur antre. Et de quel faste dément ne les avaient-ils pas habillés ?
Tapis de Perse, brocarts de Chine, soieries de Boukhara et de Samarkand, dépouille des ours et des tigres de la taïga, icônes superbes, armes précieuses, tous ça, accroché, jeté pêlemêle, en vrac, au hasard. Prises de guerre, rapines, pillages de grandes villes florissantes, sac des demeures opulentes, des entrepôts de marchands millionnaires, des trains surpris en gare ou saisis en route.
Et au milieu des trophées somptueux, les officiers cosaques avec leurs trognes, gueules, mufles sauvages, leurs énormes bonnets de martre, castor, vison ou zibeline, leurs longues et noires tuniques serrées à la taille, bardées sur la poitrine de cartouchières étincelantes et portant à la ceinture des poignard damasquinés.
Joseph Kessel
Muni d’un bon matelas d’argent liquide, il doit négocier avec les États-Majors officiels, mais aussi avec les seigneurs de guerre la constitution de trains de ravitaillement pour les troupes françaises du général Janin stationné à Omsk, le tout se déroulant dans l’unique lieu fréquentable, la boite de nuit l’Aquarium. Le général Janin a écrit Ma mission en Sibérie 1918-1920, Payot, Paris, 1933, où il doit sans doute dire quel fut le résultat de ces négociations arrosées. Pour Kessel, ce sera Nuits de Sibérie, 1928, Les Temps sauvages,1978, Le train du bout du monde nouvelle publiée dans Tous n’étaient pas des anges, 1963.
[…] Il y a ici, en Sibérie, huit cent mille prisonniers de guerre autrichiens et allemands qui ont été libérés depuis la signature du traité de paix. Nous devons les empêcher de regagner les champs de bataille européens. Enfin, nous soupçonnons les Allemands de convoiter les champs pétroliers de Bakou, dans le sud de la Russie. Nous devons les empêcher de s’en emparer.
Vladivostok grouillait de réfugiés qui avaient fui le bolchevisme. La plupart avaient emporté beaucoup d’argent. Ils le dépensaient comme s’il ne devait plus y avoir de lendemain, ce qui était dans doute le cas pour beaucoup d’entre eux. Du coup les magasins étaient bondés et les rues envahies de charrettes bourrées de marchandises. En raison de la pénurie qui régnait en Russie, la plupart des produits à vendre avaient été importés illégalement de Chine ou volées à l’armée.
[…] En venant du port, près des voies de garage du chemin de fer, il y a un important dépôt qui, sur cinq hectares, contient 600 000 tonnes de munitions et de matériel militaire livrés ici par la Grande Bretagne et les États-Unis quand les Russes étaient nos alliés. Maintenant que les Bolcheviks ont conclu la paix avec l’Allemagne, nous ne voulons pas que les armes que nos concitoyens ont payées tombent en leurs mains.
Ken Follett La chute des géants. Octobre 1918. Robert Laffont 2010
11 04 1919
À la conférence de la paix, le baron Nakino Nobuaki, représentant le Japon, avait demandé que les nations représentées reconnaissent l’égalité des races : sa proposition avait reçu une majorité de 11 voix sur 17, mais Wilson fera le nécessaire pour la torpiller.
13 04 1919
En Inde, les lois Rowlatt ont aggravé l’arbitraire judiciaire et de nombreux Indiens se sont mobilisés, particulièrement au Penjab. À Amritsar, la capitale des Sikhs, quelques milliers de personnes se sont rassemblées dans le jardin clos Jallianwala Bagh pour la fête religieuse de Baisakhi. Le brigadier général anglais Reginald Dyer perd son sang-froid face à une manifestation d’Indiens : il ordonne le tir sans sommations à ses gurkas – soldats originaires de l’actuel Népal – : elle fait 379 morts, 1137 blessés. La tuerie suscitera évidemment un grand émoi en Inde et dans les diasporas du sous-continent et des divisions dans les plus hautes instances de l’empire. Rudyard Kipling [né à Bombay où il passa ses six premières années] parlera de Reginald Dyer comme du sauveur de l’Inde !
16 04 1919
Mutinerie d’une partie de la Flotte française de la Mer Noire, mouillée à Odessa depuis décembre 1918. Le meneur, André Marty, deviendra député, membre influent du Parti communiste.
23 04 1919
Clemenceau ramène la durée quotidienne du travail à 8 heures, soit 48 heures hebdomadaires : les grèves des couturières parisiennes en mai et septembre 1917, n’y sont pas étrangères. Les maladies professionnelles – saturnisme, du au plomb, hydrargisme, du au mercure -, sont reconnues, prises en charge par les seuls employeurs. Mais la plus mortelle, la silicose, due au charbon, n’en fera pas partie.
28 04 1919
Les statuts de la SDN, Société des Nations, ancêtre de l’ONU, sont fixés : les états fondateurs sont au nombre de trente deux.
Pour ses promoteurs, et tout particulièrement Wilson, la Société des Nations représente une avancée significative vers la sécurité collective, le désarmement, la coopération internationale, le règlement des conflits par l’arbitrage.
Elle comporte trois organes : une Assemblée générale qui se réunit annuellement à Genève, où est fixé son siège, un Conseil de neuf membres chargé entre deux Assemblées de régler les problèmes, avec cinq membres permanents, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, États-Unis remplacés par la Chine, un Secrétariat général qui instruit les dossiers et organise l’exécution des décisions. Les vaincus s’en trouvent momentanément exclus, l’Assemblée générale étant compétente pour accepter de nouveaux membres ou au contraire procéder à des exclusions. Les traités lui confient par ailleurs le suivi des villes libres, des plébiscites envisagés, la répartition des mandats sur les anciennes possessions allemandes et turques.
Si sa création suscite de grands espoirs, elle sera en permanence handicapée par l’absence des Grands (URSS jusqu’en 1934, et surtout États-Unis). Si l’adhésion de l’Allemagne, en 1926, constitue un point fort, le retrait du Japon (voir Le Lotus Bleu de Hergé. La délégation japonaise avait proposé un amendement sur l’égalité raciale, qui avait été rejeté. Pour les Japonais, c’était moins une pétition de principe universel qu’une autorisation d’émigrer, et de coloniser à égalité. Ce refus va être perçu comme une insulte raciste et fera basculer beaucoup de Japonais du coté de l’expansionnisme japonais anti occidental.) lui cause un tort considérable, renforçant les doutes des diplomates sur sa réelle capacité à arbitrer des conflits graves : sanctions purement morales ou actions plus musclées.
Yves Carsalade Les grandes étapes de l’histoire économique. Les éditions de l’Ecole polytechnique. 2009
Les sarcasmes de la plupart des grandes puissances pourront faire croire que l’entreprise avait été vouée à l’échec dès sa naissance ; pour justifiés qu’ils aient été, il faut néanmoins rendre justice à la SDN de ses interventions bénéfiques dans cet entre-deux guerres :
La Société des nations n’a pas été aussi inefficace qu’on veut bien le dire. Dans les années 1920, elle a réglé un conflit entre la Finlande et la Suède, un autre entre la Turquie et l’Irak. Elle a empêché la Grèce et la Yougoslavie d’envahir l’Albanie et convaincu les Grecs de se retirer de la Bulgarie. Elle a également envoyé un contingent pour maintenir la paix entre la Colombie et le Pérou.
Ken Follett. L’Hiver du Monde. Robert Laffont 2012
En Turquie, début des procès des dirigeants du CUP et des responsables régionaux du génocide arménien : sur les 24 dirigeants du CUP, 12 seront transférés à la demande des Anglais sous l’autorité d’un tribunal international, projet qui n’aboutira pas. Quatre seront condamnés à mort par contumace, les autres seront soit acquittés soit condamnés à des peines de prison. Sur les 36 accusés responsables régionaux, 11 seront physiquement présents dans le prétoire, un seul sera condamné à 10 ans d’emprisonnement. Plusieurs procès se tiendront aussi dans les régions qui aboutiront à quelques condamnations à mort par contumace et quelques autres, effectives, pour des seconds couteaux. Ces procès prendront fin le 8 janvier 1920.
04 1919
Pierre Benoit publie à 33 ans L’Atlantide. Succès phénoménal très vite couronné par le grand prix du roman de l’Académie Française. Pour le prix modique d’un livre, les Français pouvaient oublier pendant quelques heures le cauchemar de la guerre et vivre dans le fantastique au cœur du Sahara.
1 05 1919
John Dewey, chef de file aux États-Unis du pragmatisme et du libéralisme, arrive à Shangaï. Il va rester en Chine jusqu’en juillet 1921, enchainant conférence sur conférence dans les universités de onze provinces sur l’éducation, la société, la politique et la science. Il va plaider en faveur de l’adoption de la pensée scientifique et l’introduction de la démocratie en Chine. Il va être aux premières loges pour voir les événements du 4 mai.
4 05 1919
À Pékin, plus de 3 000 étudiants font germer les graines de la révolution, aux cris de :
- Luttons pour notre souveraineté à l’étranger, débarrassons-nous des traîtres qui sont chez nous.
- À bas les 21 demandes. Ces 21 demandes sont celles que le Japon avait présenté à la Chine le 21 janvier 1915 : la Chine serait alors devenue ni plus ni moins qu’un protectorat japonais. Le conseil chinois les avait considérablement réduites, si bien qu’elles avaient été finalement acceptées par la Chine de Yuan Shikaï le 25 mai 1915
- Refusons de signer le traité de paix.
Chen Duxiu, qui va fonder un an plus tard le parti communiste chinois, est au cœur de l’affaire. C’est une dénonciation du sort fait à la Chine au profit du Japon dans le traité de Versailles – essentiellement le maintien des droits du Japon sur le Shandong [droits de l’Allemagne qui les cède au Japon] en Mandchourie du sud -.
Du vivant même de Yuan Shikai, en plein mouvement de restauration impériale, Chen Duxiu (18779-1942) lance de Shangaï un appel à la jeunesse, seule capable selon lui de renverser les traditions qui empêchent la Chine de se régénérer. Cet appel paraît en tête du premier numéro de La jeunesse (Quignian zazhi), une revue fondée par Chen lui-même et passée à la postérité sous un titre ultérieur (Xin Quignian, La Nouvelle jeunesse) qui exprime encore mieux l’ambition de son fondateur.
Cette jeunesse nouvelle que Chen rêve de forger, l’université de Pékin contribue à la former, une fois du moins qu’elle est rénovée par son président Cai Yuanpei (1876-1940). Lettré accompli, Cai fait régner une atmosphère studieuse dans une institution avant lui fameuse pour la frivolité et les frasques d’étudiants venus accomplir les rites d’accès aux plus hauts postes de l’administration. Rejetant l’idée même d’un enseignement orienté vers un but pratique, Cai s’assigne pour tâche de dispenser une culture désintéressée aux étudiants et d’aiguiser leur esprit critique : il veut former des intellectuels, non fabriquer des mandarins. À cette fin, il s’entoure de collaborateurs éminents, sans tenir compte de leurs prises de position politiques ou idéologiques : le conservateur Liang Shuming, le libéral Hu Shi, le radical Chen Duxiu, doyen de la faculté des lettres …
La tolérance de Cai n’empêche pas libéraux et radicaux de tenir le haut du pavé. À l’instar des étudiants de Beida, l’université de Pékin, les lecteurs de La jeunesse s’enthousiasment pour ces maîtres à penser à peine plus âgés qu’eux et se rallient en masse à la croisade à laquelle il les convient : en finir une fois pour toutes avec tout ce qui fait l’essence même de la culture nationale, tenu pour responsable de l’abaissement de la Chine. À commencer par le confucianisme, dont ces iconoclastes font le symbole et la source de tout ce qu’ils détestent. Dadao Kongjia dian (À bas la boutique Confucius !) devient le cri de ralliement des nouveaux intellectuels qui entreprennent d’extirper la mauvaise herbe là où elle sévit, c’est à dire à peu près partout, puisqu’elle régente la vie intellectuelle, justifie l’ordre politique et social, inspire les mœurs et les mentalités. Rien ne mesure mieux la profondeur de la remise en cause induite par l’échec de la République : il ne s’agit plus, comme au début de la décennie, de porter le coup de grâce à un empire chancelant, ni même seulement de déraciner le support idéologique du régime impérial qui survivait depuis des siècles à la chute des dynasties. Désespérant de sauver le pays aussi longtemps que ses compatriotes ne modifieront ni leurs habitudes de pensée ni leurs comportements, l’avant-garde intellectuelle aspire à rien de moins qu’à changer les Chinois. L’ambition préfigure celle de Mao un demi-siècle plus tard. Se répéteront aussi l’appel à la jeunesse éduquée, le déchaînement iconoclaste, etc, mais ne nous y trompons pas, le vocable de révolution culturelle eût mieux convenu à l’événement original qu’à la copie biaisée, même si pour une fois la farce s’est vite muée en tragédie.
Allègre autant qu’acharnée, l’entreprise de démolition a suscité effervescence et bouillonnement inventif : un de ses protagonistes les plus en vue, Hu Shi, l’a même comparée à la Renaissance. La révolution littéraire dont Hu Shi fut l’initiateur n’évoque pourtant pas l’engouement de la Renaissance européenne pour l’Antiquité, puisqu’elle bannit l’usage de la langue littéraire traditionnelle (le wenyan, ce latin des chinois) et imposa celui de la langue courante (baikua). De surcroit, la Renaissance chinoise mena à bien une réévaluation critique des Classiques (les livres canoniques, à la fois Aristote et la Bible pour les thomistes de l’orthodoxie néo-confucéenne) qui évoque moins Rabelais que Renan. Mais enfin, parler de Renaissance à propos d’un renouveau culturel aussi vif n’est pas tout à fait faux. C’est en tout cas trop restrictif, car ce qui s’est passé entre 1917 et 1923, les plus belles années de la Renaissance célébrée par Hu Shi, rappelle bien d’autres épisodes importants du cheminement des idées en Europe. À commencer par l’Aufklärung, puisque les Lumières chinoises exaltent la raison, le doute, la critique de l’autorité : leur travail de sape fut aux origines de la révolution chinoise ce qu’un siècle d’irrespect, de Bayle à Beaumarchais via Voltaire et l’Encyclopédie, fut à la préparation de 1789. De surcroît héritiers du XIX° siècle européen, Hu Shi, Chen Duxiu et consorts ont idolâtré la science et la démocratie, certains se sont entiché non seulement de la science mais du scientisme, et la passion démocratique en a conduit d’autres à l’anarchisme…
Cette ébauche d’inventaire ne serait pas encore assez hétéroclite si nous n’ajoutions au moins que l’exaltation de la raison et de l’impitoyable critique a été très vite (dès les années 1920) accompagnée, puis submergée par l’essor d’un romantisme littéraire débridé. Non point par réaction, car les apôtres de la raison ne l’étaient pas de l’ordre, ni de la mesure, encore moins des conventions. Comme ils critiquaient l’hypocrisie, et voulaient libérer l’individu des contraintes étouffantes, c’est dans leur village qu’ont vogué les chantres de la sincérité, de la spontanéité et de l’amour-passion. D’autant plus que leur aînés venaient de leur faire découvrir Rousseau et Byron en même temps que Voltaire et Auguste Comte et que la révolution littéraire préconisée par Hu Shi avait encouragé les écrivains à exprimer ce qu’ils ressentaient vraiment. En un mot, ce qui a pris des siècles en Europe a été peu ou prou expérimenté en moins d’une décennie. Il n’est donc pas tellement surprenant que des tendances à nos yeux divergentes aient pu coexister et même s’épauler : comment éviter qu’un foisonnement désordonné, auquel s’ajoute un syncrétisme induit par le mimétisme, n’accompagne une aussi prodigieuse accélération de l’histoire ?
N’exagérons pourtant pas : accélération n’est pas synonyme de surgissement spontané. Dès la fin du XIX° siècle, Tan Sitong avait critiqué la morale confucéenne, des pionniers (et pionnières) avaient dénoncé la soumission des femmes, la pratique des pieds bandés, les excès de la piété filiale, etc. Dès 1902, Liang Qichao avait propagé une conception de la démocratie peu différente de celle qu’exalteront ses cadets. Le même Linag parsemait ses écrits d’expressions de la langue parlée, des livres rédigés en baihua parurent avant la chute de l’empire (bien que personne avant Hu Shi n’eut osé faire de la langue parlée la forme majeure d’expression littéraire). À son tour, l’audace d’un Liang Qichao n’eût guère été concevable sans l’influence d’aînés tels que Kang Youwei et Yan Fu. Tous ces innovateurs avaient déjà importé d’Occident nombre d’idées, à l’époque sacrilèges, auxquels la génération suivante se ralliera, En fin de compte, la principale différence entre les deux générations, c’est peut-être Liang qui la suggère – involontairement – lorsqu’il proclame : J’aime Confucius, mais j’aime davantage encore la vérité. Des successeurs n’aimeront plus autant Confucius… bien qu’ils l’aient moins détesté et surtout rejeté qu’ils n’ont cru le faire.
Il y a plus. Comme leurs successeurs des années 1915-1920, Liang Qichao et les autres étaient de fervents nationalistes. Dans les dernières années de l’empire, des révolutionnaires chinois exilés à Tokyo et à Paris se sont désolidarisés du nationalisme et ont critiqué l’inspiration raciste de certains thèmes défendus aussi bien par Liang que par ses adversaires de la Ligue Jurée. À l’époque ou en Chine et ailleurs les mouvements nationalistes commençaient tout juste à recruter des adhérents parmi l’intelligentsia coloniale, les anarchistes (car c’est d’eux qu’il s’agit) rejetaient avec dédain le nationalisme comme une idéologie qui avait fait son temps. Ils en dénonçaient même à l’avance (c’est à dire avant qu’ils aient triomphé chez eux) les effets pernicieux. Les anarchistes ont été à la fois des précurseurs (dont l’influence sera importante entre 1915 et 1920) et une avant-garde dont la majorité des radicaux et iconoclastes se détournera assez vite, parce qu’elle n’est pas prête à épouser toutes leurs audaces – et aussi, soyons juste -, à cause de leur nostalgie d’un âge d’or préindustriel et de leur refus suicidaire de toute organisation.
Le nationalisme – en dépit des anarchistes, il faut sans cesse revenir à lui – avait enfin suscité le recours à des formes d’action proches de cclles qui ont rendu la période, et en particulier la journée du 4 mai 1919, à jamais mémorables. Dès les premières années du siècle, des mouvements anti-impérialistes (manifestations antirusses des étudiants chinois de Tokyo, Pékin et Shangaï en 1903, boycottage antiaméricain de 1905 et antijaponais de 1908) s’apparentaient moins au récent soulèvement des Boxeurs ou aux violences antichrétiennes du XIX° siècle qu’au mouvement (yandong) plus moderne de protestation suscité à Pékin par la façon dont les vainqueurs de la Première Guerre Mondiale réglaient les affaires de la Chine. Ne serait-ce que par la composition sociologique des participants : étudiants, homme d’affaires et autres citadins éduquées, qui lisent la presse et réagissent à des nouvelles venues de loin; ou par leur action concertée (aux antipodes de la xénophobie traditionnelle) contre un double adversaire : l’impérialisme et l’ennemi intérieur qui pactise avec lui…
Lucien Bianco. La Chine au XX° siècle D’une révolution à l’autre 1895-1949. Fayard 1989
7 05 1919
L’armée polonaise entre à Kiev, capitale de l’Ukraine : La paix de Brest-Litovsk avait conduit à la formation de plusieurs États dans les territoires de l’ancien empire russe. Après la retraite de l’armée allemande sur le front est, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie, progressivement stabilisées, formèrent des États indépendants. Vers la fin de l’année 1918, la Russie, l’Ukraine et la Biélorussie constituèrent des républiques soviétiques. Officiellement, il s’agissait d’États souverains, mais en réalité Moscou exerçait un contrôle suprême. Partout, les revendications territoriales s’accompagnaient d’explosions de violences. La question principale concernait la définition de la frontière occidentale de la Sovdépie, ainsi que les étrangers nommaient les pays sous contrôle communiste. Varsovie vivait dans la peur constante de ce que feraient la Russie une fois l’Armée rouge libérée de la guerre civile.
Les autorités polonaises elles-mêmes regardaient au-delà des territoires qu’elles contrôlaient : en avril 1919, leur armée chassa les Rouges de Vilnius, capitale de la République soviétique lituano-bielorusse ; Josef Pilsudski, commandant en chef de l’armée polonaise, organisa une campagne militaire pour renverser le gouvernement soviétique de Kiev et établir une union fédérale de la Pologne et de l’Ukraine. Dans un lointain passé, les Polonais avaient contrôlé les provinces de l’Ukraine, et une minorité ukrainienne importante occupait encore le sud-est de l’État polonais d’alors. Pilsudski avait calculé que l’acquisition de l’Ukraine, région agricole et industrielle prospère avant 1914, constituerait un avant-poste défensif qui protégerait Varsovie d’une éventuelle invasion soviétique. En outre, la Russie se trouverait de nouveau amputée d’un territoire, d’une population et de ressources économiques à l’ouest, comme le stipulaient les termes du traité de Brest-Litovsk. Ni l’opinion populaire ukrainienne ni le cabinet polonais ne furent consultés. Pilsudski comptait les mettre devant le fait accompli. En quelques jours, il avait atteint le centre de l’Ukraine. Le 7 mai, ses troupes entrèrent dans Kiev. Leur progression fut si rapide qu’ils capturèrent même des soldats soviétiques aux arrêts de bus.
Robert Service. Trotski. Perrin 2009
15 05 1919
Les Grecs occupent Smyrne – l’actuel Izmir, en Turquie -. Le même jour, Moustafa Kemal un vétéran de la guerre de Tripolitaine et de la lutte de 14-18, est nommé inspecteur d’armée.
20 05 1919
Par 344 voix contre 97, les députés se prononcent en faveur du droit de vote pour les femmes : mais les sénateurs ne suivent pas.
1 06 1919
À Valence pour fêter Jeanne d’Arc, on fait entrer à peu près 4 000 personnes dans une salle de spectacle acquise par l’évêché pour y passer des courts métrages sur l’héroïne nationale : quelques bandes de film brûlent dans la cabine du projectionniste et c’est la panique : on comptera cent trente et un morts, dont la moitié d’enfants.
14 06 1919
Les anglais John Willam Alcock et Arthur Whitton Brown effectuent avec un bombardier Vickers Vimy V/150 la première traversée de l’Atlantique nord d’ouest : Saint John’s à Terre Neuve, en est : Clifden en Irlande, en 16 h 12’.
21 06 1919
La flotte allemande – 74 navires – commandée par l’amiral von Reuter est consignée depuis l’armistice à Scapa Flow, vaste rade dans les Orcades, au nord de l’Écosse dont l’Angleterre a fait sa principale base navale. Les Allemands ayant appris qu’il leur faudrait livrer cette flotte aux Alliés, mettent à profit une sortie de l’escadre anglaise pour saborder la leur. 52 coulèrent, et les gardes britanniques parvinrent à en échouer 22 sur la plage. 32 navires seront renfloués après la guerre, puis 13 en 1939 : il restera sur des fonds importants 7 navires de 150 à 180 m de long.
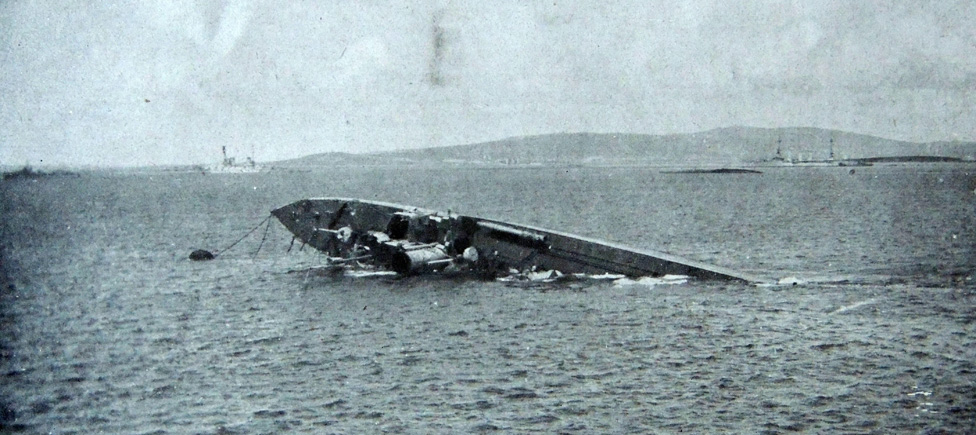
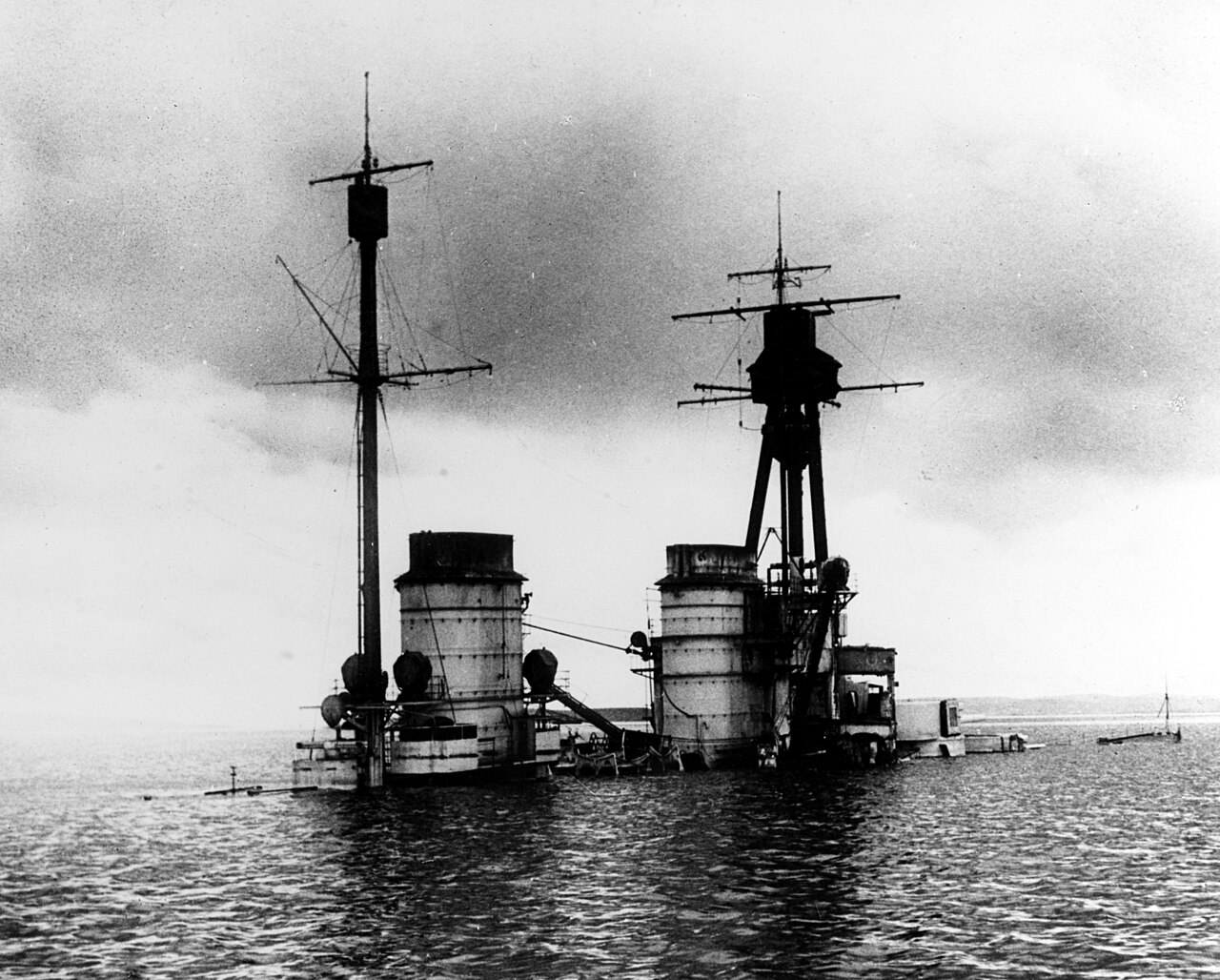
The upper-works of the German battle-cruiser SMS Hindenburg.

Tug alongside scuttled German destroyer G 102
28 06 1919
Traité de Versailles.


De gauche à droite : David Lloyd George, Grande Bretagne, Vottorio Orlando, Italie, Georges Clemenceau, France, Thomas W. Wilson, États-Unis.

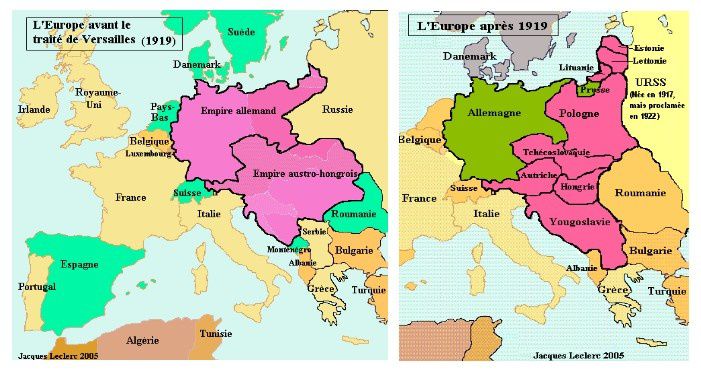
Mais tout d’abord, pourquoi ce choix de Versailles ?
[…] C’est à la demande de Georges Clemenceau que la Conférence de la paix s’ouvrit à Paris en janvier 1919 et que la signature du traité eut lieu au château de Versailles. Le président du Conseil avait, été, comme jeune journaliste, profondément marqué par la guerre franco-prussienne et par l’humiliation ressentie lors de la proclamation de l’Empire allemand dans la galerie des Glaces, le 18 janvier 1871. À soixante-dix-sept ans, Clemenceau tenait là sa revanche. Mais loin d’être propre à l’homme d’Etat, ce vif ressentiment était largement partagé par la population française. Et très tôt, alors que l’issue du conflit était encore incertaine, des voix s’étaient élevées pour que la future signature avec la puissance ennemie ait lieu à Versailles : ainsi Henri Welschinger écrivait-il dans une biographie consacrée à l’éphémère empereur Frédéric III [1831-1888] publiée en 1917 : la proclamation de l’empire allemand eut lieu, le 18 janvier 1871, dans la galerie des Glaces, au pied de la statue de Luis XIV au passage du Rhin. Nous n’oublierons pas, je l’espère, et je recommande instamment cette clause aux futurs négociateurs – de faire signer la paix prochaine à la même place, afin d’effacer le souvenir d’un acte insolent, accompli dans le palais du Grand Roi sur notre territoire profané, revendiquant deux ans plus tard l’honneur d’avoir été le premier en pleine guerre, bien avant la victoire décisive, à souhaiter une réparation qui va devenir un fait historique considérable entre tous. La vision de Bismarck, chancelier de Prusse, au lendemain de la reddition de l’armée française à Sedan et de la chute du second empire, était tout aussi symbolique : marquer par un cérémonie à Versailles le revanche de l’Allemagne sur les humiliations subies au passage des armées de Louis XIV et de Napoléon. La galerie des Glaces cristallise dans son décor la relation conflictuelle entre les deux nations, sa voûte figurant le déroulement de la guerre de Hollande qui avait opposé à la France les puissances alliées, guerre conclue par la paix d’Utrecht en 1678 qui renforçait le pré carré français ; et nombre de compositions rappellent des épisodes victorieux des armées de Louis XIV en terre germanique, notamment La Franche-Comté conquise pour la seconde fois, 1674, où l’Empire est ridiculisé sous les traits d’un aigle qui crie et qui bat des ailes sur un arbre sec, évoquant les vains efforts que fit l’Allemagne pour empêcher cette conquête.
Outre son décor à la gloire d’une France omnipotente en Europe, la galerie des Glaces était apparue, dès son inauguration, comme l’outil privilégié de la grandeur du Roi Soleil. Ainsi le doge de Gênes avait-il dû se rendre à Versailles en 1685 pour présenter à Louis XIV les excuses de la République ligure.
Cette manifestation fastueuse, mais particulièrement humiliante en public, avait marqué la galerie d’un ton politique dominateur vivement ressenti à l’extérieur. Mais l’animosité de l’Allemagne envers la France s’était installé durablement à l’occasion du sac du Palatinat, ordonné par Louis XIV lors de la campagne militaire de 1688-1689. Spécifiquement dirigée contre le Saint Empire, ces ravages systématiques – symbolisés par les ruines volontairement conservées en l’état du château électoral de Heidelberg – ne lui furent jamais pardonnés. Ils exacerbent le sentiment anti-français dont Bismarck sur jouer, près de deux siècles plus tard, en réunissant les princes allemands autour de la Prusse. La galerie toutefois avait pu présenter un jour diplomatique plus aimable lorsqu’y furent reçus en audience les ambassadeurs du Siam, en 1686, puis l’ambassadeur de Perse, en 1715, et sous le règne de Louis XV, l’ambassadeur turc en 1742. Le cérémonial avait alors repris celui de l’audience du doge de Gênes, avec le trône du roi dressé à l’extrémité de la galerie contre l’arcade fermée du salon de la Paix. En 1871, les Prussiens avaient adopté cette même disposition, plaçant toutefois l’estrade du côté du salon de la Guerre. Mais ce ne fut pas le parti retenu en 1919, ce n’était pas alors un chef d’Etat, mais le Conseil des Alliés qui recevait la délégation allemande, et ses représentants furent installés au centre de la galerie, derrière une longue table placée devant les miroirs. Tout fut pensé pour transcender le souvenir de 1871. La délégation allemande, composée de près de 200 experts, fut logée à l’hôtel des Réservoirs, à proximité immédiate du château, non seulement pour des raisons pratiques, mais surtout parce que c’était là qu’avait résidé les représentants français lors des négociations avec Bismarck. Les représentants allemands reçurent au Trianon Palace, les conditions de pais des Alliés le 7 mai, date anniversaire du torpillage du paquebot britannique Lusitania en 1915, qui avait indigné l’opinion [à tort, puis que la suite révélera qu’il transportait effectivement des armes, ce qui était l’argument allemand, que les Alliés nieront très longtemps]. La date du 28 juin choisie pour la signature correspondait à celle de l’assassinat à Sarajevo, cinq ans plus tôt, de l’archiduc François Ferdinand par le nationaliste serbe Princip qui avait provoqué l’escalade fatale menant au déclenchement du premier conflit mondial.
Bertrand Rondot, conservateur en chef au musée national du château de Versailles et de Trianon Les carnets de Versailles N° 15 avril-septembre 2019
Outre les clauses de l’armistice qui sont confirmées, l’armée française occupe la Rhénanie, rive gauche du Rhin pendant quinze ans. La Sarre passe pendant 15 ans sous l’administration de la SDN, les houillères étant sous contrôle de la France ; l’Alsace et la Lorraine reviennent à la France, sans plébiscite [le gouvernement français craint que la population ne préfère rester allemande]. Le tracé des frontières du nouvel État polonais exproprie trois millions d’Allemands et son territoire comprend désormais les gisements houillers de Silésie. L’Allemagne perd toutes ses colonies. Les réparations sont fixées à 52 milliards de marks or, soit 165 milliards de francs dont 52 % (85,8 milliards) doivent aller à la France.
L’occupation de la Rhénanie fera l’objet d’une campagne haineuse de l’extrême droite allemande contre les soldats noirs de l’armée française. Ceux-ci, au nombre de 20 000, essentiellement Sénégalais et Malgaches seront accusés de viols sur des Allemandes. L’armée enregistra de fait 66 plaintes pour viols. En mars 1920, la France passera sur la rive droite du Rhin, occupant Francfort ; il y aura des incidents. À côté de cela, il y eut des unions tout à fait consenties entre Noirs et Allemandes, avec de nombreux enfants métis. Cela était inacceptable pour l’Allemagne, qui votera des lois de stérilisation eugénique de ces enfants le 14 juillet 1933, puis une loi de prévention des maladies héréditaires. En avril 1937, Hitler donnera l’ordre de la stérilisation de ces enfants, sans même que les parents aient leur mot à dire, et s’ils manifestaient leur désaccord, c’était les camps. Il n’y a pas de chiffre précis, seulement une très large fourchette, entre 400 et 1 000.


L’article 231 impute à l’Allemagne la responsabilité pleine et entière de la guerre :
Les gouvernements alliés et associés déclarent, et l’Allemagne reconnaît, que l’Allemagne et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre, qui leur a été imposée par l’agression de l’Allemagne et de ses alliés.
Pour faire bref, on est en droit de dire que l’esprit de vengeance l’emportait, et de beaucoup, sur l’esprit de paix.
Par l’article 435, il sonne aussi le glas de la zone neutre et de la zone franche en Savoie :
Les Hautes-Parties contractantes, tout en reconnaissant les garanties stipulées en faveur de la Suisse pour les traités de 1815 (…) constatent cependant que les stipulations de ces traités (…) relatifs à la zone neutralisée de la Savoie (…) ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En conséquence, les Hautes-Parties contractantes prennent acte de l’accord intervenu entre le gouvernement français et le gouvernement suisse pour l’abrogation des stipulations relatives à cette zone qui sont et demeurent abrogées. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent de même que les stipulations des traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles et qu’il appartient à la France et à la Suisse de régler entre elles d’un commun accord, le régime de ces territoires, dans les conditions jugées opportunes par les 2 pays.
Si la neutralité de la Suisse était la première des demandes fédérales, la suppression des zones neutres et franches, de toutes les zones, était la première des demandes françaises (…) maintien et garantie de la neutralité suisse contre neutralisation et franchises douanières ; donnant, donnant.
Victor Bérard. Genève et les Traités. Paris 1930.
Selon Lloyd George, il n’y avait rien à reprocher à cette paix parce qu’elle était bonne au point de vue de la justice, et, par conséquent, aussi raisonnable que juste. D’autres traités avaient été des traités politiques. Celui-là était un traité moral.
[…] Une paix trop douce pour ce qu’elle a de dur… le traité enlève tout à l’Allemagne, sauf le principal, sauf la puissance politique, génératrice de toutes les autres… Il croit supprimer les moyens de nuire que l’Allemagne possédait en 1914. Il lui accorde le premier de ces moyens, celui qui doit lui permettre de reconstituer les autres, l’État, un État central, qui dispose des ressources et des forces de 60 millions d’êtres humains et qui sera au service de leurs passions….
[…] Il n’est pas douteux que, dès la première heure, M. Lloyd George et M. Wilson avaient été en garde. Ils ne voulaient pas d’une dissociation de l’Allemagne. Ils n’en voulaient pas pour des raisons philosophiques et politiques. À ces raisons, les négociateurs français n’en opposaient pas parce qu’ils n’en avaient pas. Ils n’en avaient pas parce que leur philosophie était, au fond, la même que celle de leurs interlocuteurs anglo-saxons : le droit des nationalités d’abord, et la nationalité allemande devait avoir les mêmes droits qu’une autre ; l’évolution, et comme l’évolution interdit que l’on revienne en arrière, cinquante ans devaient avoir rendu l’unité allemande indestructible. En partant de là, on fit ce qu’on devait faire : on lui donna la consécration du droit public qui lui manquait, on aida les centralisateurs prussiens à compléter l’œuvre de Bismarck. On nous avait dit qu’une politique réaliste et pratique le voulait aussi, qu’une grande Allemagne aux rouages simplifiés, formant un tout économique, serait, pour nos réparations, un débiteur plus sûr qu’une Allemagne composée de petits États médiocrement prospères. Ce raisonnement commence à apparaître comme une des folies les plus remarquables de l’histoire moderne. Nous y avons gagné que 40 millions de Français sont créanciers d’une masse de 60 millions d’Allemands, et pour une créance recouvrable en trente ou quarante années.
[…] Ainsi, les Alliés ont reculé devant les dernières conséquences de leurs principes. Ils ont démembré l’Allemagne tout en l’unifiant. Par là leur œuvre est illogique et incohérente. Elle est fragile aussi.
[…] De même que la Pologne affranchie, de même qu’un État tchécoslovaque bourré d’Allemands, l’Autriche indépendante, pour durer sans péril, supposait en Allemagne des États allemands indépendants.
[…] Pour garder le Brenner et Trieste contre l’éternelle descente des Germains, l’Italie songera à la méthode par laquelle elle gardait autrefois la Vénétie. Pour ne pas avoir la guerre avec l’Autriche, elle était alliée de l’Autriche. Une situation semblable et seulement plus complexe lui suggère déjà l’idée d’entretenir de bons rapports avec le peuple allemand devenu son quasi voisin.
[…] Quant à une agression indirecte, celle dont serait victime un pays ami et solidaire du nôtre (pensons toujours à la Pologne, si découverte, si exposée), quant à une annexion, même sans violence (comme celle de l’Autriche), qui accroîtrait dangereusement le territoire et les forces de l’Allemagne : tous ces cas-là, dont nous aurions pourtant à supporter les répercussions si nous demeurions inertes, rentreraient dans la catégorie de ceux où, par notre intervention, nous serions considérés comme les provocateurs. Il ne nous resterait hardiment qu’à en prendre notre parti en expliquant au monde que, pour lui épargner un 1914, il ne faut pas répéter la faute de 1866 (la France n’avait alors rien fait pour secourir l’Autriche qui s’était fait étriller par les Prussiens à Sadowa).
Les futures difficultés, telles qu’elles se dessinent déjà, auront un double caractère. D’abord, elles seront d’une gravité croissante. Le danger, à l’origine, n’apparaîtra qu’à des yeux très exercés et à des hommes très perspicaces. Les foules y resteront insensibles et les gouvernements seront tentés de les nier. En second lieu, ces difficultés seront surtout terrestres et continentales.
[…] Mais, au milieu de ces orages européens, l’Allemagne elle-même n’échapperait sans doute pas à des secousses et à des crises. C’est là que la politique française devra pouvoir, sans entraves, aider à diriger les événements. Sa doctrine (et sans une doctrine on n’a pas de politique), sa doctrine fondée sur l’expérience est qu’il n’y a pas de repos ni de sécurité en Europe si l’Allemagne reste forte, et rien n’empêchera qu’elle redevienne forte tant qu’elle sera unie et centralisée. C’est ce dont convient le plus grand journal des financiers, des libéraux et des unitaires allemands, la Gazette de Francfort, lorsqu’elle dit des projets fédéralistes du docteur Heim, le chef du parti populaire bavarois : Une Allemagne fédérale selon la recette Heim aurait certainement du succès en France parce que ce serait une Allemagne impuissante. C’est admirablement dit. Il n’y a qu’à ne pas nous écarter de là. Et nous avons ce qu’il faut, moyens et idées, pour ramener alliés et ennemis à ce point de vue essentiel, à travers les prochains événements.
Jacques Bainville. 1920. Les Conséquences politiques de la paix.
Il n’aurait pas été correct de taire les propos de ce pilier de l’Action Française qu’a été Jacques Bainville, étonnants de lucidité. Toutefois, nul n’étant prophète en son pays, on se contentera de s’amuser de ces quelques lignes sur les Français, dans ce même ouvrage : Le Français n’est pas vindicatif. Il est éminemment sociable. C’est même un des traits de son caractère d’aimer à être aimé et d’être douloureusement surpris quand il s’aperçoit qu’il ne l’est pas.
Coté français, un des principaux auteurs de la nouvelle carte de l’Europe, bras droit de Clemenceau, est Emmanuel de Martonne qui va devenir la grande référence de la géographie en France. Il insiste pour que les frontières tiennent compte non seulement des regroupements ethniques, selon le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, mais également, d’un point de vue plus matériel, des infrastructures du territoire : c’est ce qu’il nomme le principe de viabilité. C’est ainsi qu’à l’encontre des délégués américains et italiens, Martonne obtient que la frontière Roumanie- Hongrie longe et englobe côté roumain une ligne de chemin de fer reliant les villes de Timisoara, Arad, Oradea et Satu Marc, et aussi la Yougoslavie à la Tchécoslovaquie, malgré la présence de nombreuses poches à majorité hongroise sur le tracé. Ce choix est dicté par la stratégie française de l’époque : renforcer la Petite Entente alliée à la France. Interdiction sera faite aussi à la Compagnie qui gère l’Orient Express de continuer à passer par le territoire allemand, difficulté qui sera contournée par l’ouverture récente du tunnel du Simplon en Suisse qui permettra à l’Orient Express de passer par l’Italie du Nord, Venise, Trieste. Emmanuel de Martonne contribue ainsi de manière décisive au dessin des frontières de l’entre-deux guerres, dont la plupart sont toujours en place.
Côté anglais, David Lloyd George parvint à convaincre Woodrow Wilson d’ignorer la question irlandaise en dépit de la présence d’une délégation qui, sera pour ce grand défenseur du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, l’exception qui vient confirmer la règle.
Deux questions étaient en jeu. Il y avait d’abord le problème mis en évidence par le jeune John Maynard Keynes, auteur d’une cinglante critique de la conférence de Versailles à laquelle il participa en qualité de membre de la délégation britannique : Les conséquences économiques de la paix (1920). Sans remise en état de l’économie allemande, plaidait-il, il était impossible de restaurer en Europe une civilisation et une économie libérale stables. Maintenir l’Allemagne dans un état de faiblesse au nom de la sécurité de la France, comme le voulait Paris, était une politique contre productive. En réalité, les Français étaient trop faibles pour imposer leur politique, alors même qu’ils occupèrent brièvement le cœur industriel de l’Allemagne occidentale en 1923 sous prétexte que les Allemands refusaient de payer. Finalement force leur fût de tolérer après 1924, une politique conciliante destinée à renforcer l’économie de l’Allemagne.
Mais se posait aussi la question de la forme que devaient prendre les réparations. Ceux qui souhaitaient une Allemagne faible préféraient des espèces plutôt que, comme le voulait la raison, des biens prélevés sur la production courante, ou tout au moins une partie des recettes d’exportation, puisque cela eût renforcé l’économie allemande contre ses concurrents. En fait, ils obligèrent l’Allemagne à emprunter lourdement, si bien que les réparations furent finalement financées par les prêts (américains) massifs du milieu des années 1920. Pour les rivaux de l’Allemagne, cela présentait l’avantage supplémentaire de l’obliger à s’endetter plutôt que d’exporter pour atteindre un équilibre extérieur. En fait, les importations allemandes augmentèrent en flèche. Mais ce dispositif eut pour résultat de rendre à la fois l’Allemagne et l’Europe éminemment sensibles au déclin des crédits américains, amorcé dès avant la crise et la fermeture du robinet à crédit, qui suivirent la crise de Wall Street en 1929. Tout ce château de cartes de réparations s’effondra au cours de la Crise.
La chute des trois empires multinationaux d’Autriche-Hongrie, de Russie et de Turquie eut pour effet de remplacer trois Etats supranationaux, dont les gouvernements étaient neutres vis-à-vis des nombreuses nationalités qu’ils avaient sous leur coupe, par un nombre beaucoup plus important d’États multinationaux, s’identifiant chacun à une, ou tout au plus à deux ou trois des communautés ethniques vivant à l’intérieur de ses frontières.
Eric J. Hobsbawm L’Age des Extrêmes 1994
Le radicalisme national préfère à un paradis avec les Habsbourg n’importe quel régime, même le plus tyrannique, pourvu qu’il soit exercé par un des siens
Tschuppik, historien allemand
La création de la Yougoslavie exigeait de franchir la ligne de faille de l’histoire européenne qui séparait les Empires romains d’Occident et d’Orient, les religions catholique et orthodoxe, les écritures latine et cyrillique, ligne de faille qui filait en gros entre la Croatie et la Serbie [2], deux pays n’ayant jamais appartenu à la même unité politique au cours de leur histoire complexe.
[…] Dans l’ensemble, presque autant d’individus vivaient sous un régime étranger qu’à l’époque de l’Empire austro-hongrois à ceci près qu’ils se répartissaient à présent dans des États-nations plus nombreux.
Henry Kissinger
Le bilan des traités est en demi-teinte avec des aspects positifs et des aspects négatifs. À l’actif, on peut citer les progrès de la démocratie, comme la libération et la reconnaissance étatique des nationalités pour les Polonais, les Tchèques, les Slovaques, les Yougoslaves, les Baltes, les Finlandais.
Mais au passif, de nouveaux problèmes apparaissent avec les revendications territoriales de l’Allemagne, de la Russie, de la Hongrie, ainsi qu’avec les minorités. Si celles-ci représentent 60 millions de personnes en Europe en 1914, soit 20 % de la population, ce chiffre est encore de 30 millions en 1920. Il n’est pas un pays d’Europe centrale et orientale qui ne s’estime lésé par les règlements territoriaux ou ne comporte sur son sol des minorités. On peut citer le cas paradoxal des Allemands des Sudètes en Tchécoslovaquie qui sont passés du statut de groupe dominant à celui de minorité.
Enfin il ne faut pas oublier la grave humiliation ressentie par l’Allemagne face au diktat : amputée, occupée partiellement, rendue responsable et contrainte à des réparations, elle est en fait dans une situation de puissance économique pratiquement intacte.
Yves Carsalade Les grandes étapes de l’histoire économique. Les éditions de l’Ecole polytechnique. 2009
L’article 22 de la charte de la Société des Nations interdit aux puissances victorieuses de fonder de nouvelles colonies : elles ne pourront se voir confiés que des mandats, qui ne seront rien d’autre qu’un temps d’accompagnement sur le chemin de l’indépendance.
La Chine, présente à Versailles, n’a pu obtenir des Grandes Puissances que le Japon – qui sort considérablement renforcé de la guerre – abandonne ses droits au Shandong, – le sud de la Mandchourie, aujourd’hui frontalier de la Corée du Nord – qui lui venaient de l’Allemagne : elle refuse de signer la paix… dès le 4 mai 1919, des manifestations d’étudiants à Pékin vont faire germer les graines de la révolution. Chen Duxiu, qui va fonder un an plus tard le parti communiste chinois, est au cœur de l’affaire.
En juin, un jeune aide-cuisinier du Ritz envoie une pétition aux chefs d’État assemblés à Paris, pour réclamer l’indépendance de l’Indochine française. Les revendications du peuple d’Annam sont adressées au président Wilson, qui ne donne pas suite. Un an plus tard, le jeune homme se laissera séduire par le bolchevisme : Ho Chi Minh, alias Nguyên Ai Quôc, dont la droite demandera plus tard la mort, pour avoir osé demander l’indépendance.
La première cause de la révolution communiste, c’est donc tout simplement l’échec de la révolution précédente, qui a remplacé l’empire par un régime encore plus démuni face aux menées impérialistes.
Lucien Bianco L’Histoire Juillet Août 2005
En matière militaire, l’Allemagne se voit interdire toute aviation et toute force blindée. Le traité de Rapallo viendra autoriser l’état-major allemand à s’exercer en Russie, et cela se fera de 1923 à 1933 : cela crée des liens.
Aux États-Unis, la Constitution ne simplifie pas les affaires :
Aux termes de la Constitution des États-Unis, les traités doivent être ratifiés par le Sénat. Les élections de novembre 1918 y ont amené une majorité républicaine aux tendances isolationnistes. Plusieurs éléments jouent contre le traité : le fait que le président n’ait invité qu’une seule personnalité républicaine à participer à la Conférence de Paris ; les concessions qu’il a dû faire pour obtenir certaines signatures, tout particulièrement celle du Japon ; le risque que le pacte de la SDN puisse conduire les États-Unis à intervenir dans un conflit où leurs intérêts ne sont pas directement en jeu ; la question des dettes de guerre. La majorité sénatoriale républicaine, poussée par Henry Cabot-Lodge, adversaire acharné de Wilson, refuse de ratifier un traité qui ne serait pas l’objet de modifications substantielles. Or le président préfère un rejet à des amendements pensant que les élections présidentielles de novembre 1920 seront un référendum en faveur du traité. En fait, le candidat qu’il soutient est battu par le républicain Warren Harding.
L’abandon par les États-Unis du système mondial qu’ils avaient inspiré, et qui de ce fait se retrouve déséquilibré, modifie de fond en comble les conditions de l’équilibre européen. La France avait renoncé à plusieurs revendications, sur la Rhénanie notamment, en échange du traité de garantie qui disparaît de lui-même et que la Grande-Bretagne s’empresse de dénoncer. Elle est donc conduite à trouver des bases nouvelles pour sa sécurité. Première puissance militaire, elle n’a pas les moyens démographiques, économiques et financiers de cette ambition. Fidèle au principe de la tenaille, elle se rapproche des nouveaux États satisfaits des règlements territoriaux, qui se placent logiquement sous sa protection. Elle va signer des accords avec la Pologne et les trois pays de la Petite Entente : Tchécoslovaquie, Roumanie et Yougoslavie. Mais la Grande-Bretagne va voir dans cette politique une menace d’hégémonie française sur le continent qui risque de compromettre l’équilibre européen.
Yves Carsalade Les grandes étapes de l’histoire économique. Les éditions de l’Ecole polytechnique. 2009
Il se glisse toujours des bizarreries dans ces grandes affaires, dont on ne sait comment elles ont pu arriver sur le tapis [c’est aujourd’hui l’histoire des lobbys à Bruxelles, au siège de l’Europe] : ainsi de cette autorisation pour les missions protestantes américaines d’exercer leur prosélytisme en Afrique Occidentale Française, et encore, celle du droit à l’autodétermination :
M. Dubois, un Noir américain, avait dans ce but précis été envoyé à Versailles par la National Association for the Advancement of the Coloured People (la future célèbre NAACP du Pasteur Martin Luther King). Il s’était heurté au refus véhément de deux députés français Noirs, Blaise Diagne du Sénégal et Gratien Candace de la Guadeloupe, fervents partisans de l’accession des Noirs à la citoyenneté française. Ainsi, la question du droit à l’autodétermination des peuples des colonies ne fut pas posée. Mais il en resta cependant une habitude de confrontation et d’échanges entre les Noirs de toutes origines et de toutes conditions. Dès l’année suivante en 1920 se constituait un Congrès panafricain qui dénoncera les concessions aux compagnies cotonnières et autres, et développera une tonalité porté vers l’assimilation, vers l’égalité des droits dans tout l’empire et immédiatement pour une garantie de plus d’équité.
Philippe San Marco. Sortir de l’impasse coloniale. Mon petit éditeur 2016
Hugo Junker a fait appel à Otto Reuter, son ingénieur en chef pour construire une avion entièrement métallique ; et c’est le premier vol du Junker F 13, premier avion commercial : 4 passagers. La puissance du moteur passera de 118 kW à 420 kW, augmentant ainsi la vitesse et le rayon d’action. Mais l’avion ne rencontrera pas le succès escompté en Allemagne et sera vendu aux États-Unis où se développera la production.

29 06 1919
Pour que le retour de la paix soit complet, il fallait que reprenne le Tour de France qui sera très patriotique, selon le souhait de son patron, Henri Desgranges, qui, dès le 18 novembre 1918, proclamait dans l’Aurore : Le prochain Tour de France, le treizième du nom, va se disputer l’an prochain, en juin-juillet, avec, cela va sans dire, une étape à Strasbourg… Même s’il doit se terminer avec un seul coureur devant ma porte, le Tour se fera.
*****
Peu lui importait l’état des routes, les pénuries de nourriture et de matériel, ou le peu d’hôtels prêts à accueillir le maigre peloton – ils furent soixante-neuf au départ – des forçats volontaires. C’était une question d’honneur et de fierté nationale. Retrouver par le tracé du Tour les contours de la France en grand, la France avec l’Alsace et la Lorraine revenues dans le giron de la Nation. Ce Tour 1919 sonnerait comme une première vengeance du coq à gros bec sur le casque à pointe. L’idée que le trace épouserait le chemin de ronde du pays était fortement ancrée dans l’esprit de Desgranges, comme en témoigne cette autre déclaration au patriotisme vibrant et suranné : Strasbourg ! Metz ! Et ce n’est pas un rêve ! Nous allons là-bas chez nous. Nous verrons, de Belfort à Haguenau, toute la ligne bleue des Vosges qu’avant la guerre nous contemplions à notre droite. Nous allons longer le Rhin. Je ne puis m’empêcher de songer à notre premier Tour de France, celui de 1903, avec son ridicule petit itinéraire : Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Paris. Du haut des Pyrénées, du haut des Alpes, du haut du Jura, des villes comme Lyon, comme Toulouse, comme Rennes, comme Nancy, nous apparaissent aujourd’hui ainsi que des points obscurs dans le fond d’une cuvette. Avec Strasbourg et Metz, nos ambitions sont repues ; le Tour de France est complet. Il nous fallait, après le patois normand, le dialecte breton, les cigales chantantes des idiomes méridionaux, les rudesses du flamand, il nous fallait la joie du parler alsacien : il nous manquait l’entrée triomphale à Strasbourg où vont nous accueillir les vols harmonieux des cigognes et les ailes de la coiffe de nos jolies fille d’Alsace ! Ce n’est donc pas un hasard si la torche jaune fut allumée pour ce Tour-là en forme de reconquête mais aussi de procession funèbre. L’édition 1919 fut sans doute une épreuve au sens plein du terme, la pire de l’Histoire. Départs de nuit, privations de toute sorte – c’est un peloton de crève-la-faim qui s’élance du Parc des Princes à 3 heures du matin, le 29 juin, pour rallier le Havre 388 kilomètres plus loin. De petits hommes gris à qui manque un graal qui les transcende. Ce sera ce fameux maillot jaune attribué à Grenoble à celui qu’on n’appelle pas encore le Vieux Gaulois : Eugène Christophe. Et lorsque la malchance de sa fourche brisée (décidément, aucune fourche ne résistait à cet homme ! … il avait déjà connu cette mésaventure en 1913. ndlr) lui ravira son trophées, il aura ce geste sportif de le donner lui-même au futur vainqueur Firmin Lambot. Un nom prédestiné pour une compétition impitoyable que seuls onze courageux termineront, après avoir enduré la grande chaleur comme le grand froid et des trombes d’eau sur la route de Dunkerque. Entre-temps, Christophe dit Cri-Cri aura traversé l’Alsace et la Lorraine revêtu du maillot de lumière, comme une consolation. Les pleurs viendront après ; dans la boue et les ornières où sombrera son pavillon jaune. Qui peut imaginer que dans l’étape dantesque Metz-Dunkerque, un long calvaire de quatre cent soixante-huit bornes en pleine tempête, Firmin Lambot l’emportera au bout de vingt et une heures de selle. Le lendemain, c’est au nom du clairon que le peloton des rescapés, un groupe minuscule de onze irréductibles, se présente dans un Parc des Princes survolté. Le maillot jaune entre dans la légende. Eugène Christophe aussi, qui bénéficie d’une collecte nationale lancé auprès des lecteurs de L’Auto bouleversés par son exploit, son malheur et son fair-play. Lorsque la Souscription Christophe est close, 13 310 francs ont été réunis pour le chouchou du peuple. Dans les vingt listes de donateurs, on lit ces mentions . Souscription à l’hôpital 83bis à Bidard, par un groupe de poilus tubards (tuberculeux. ndlr) (0,75F) ; Bellot Pierre, sergent-major ; 5° génie Armée d’Orient (5 F) ; des poilus d’un bataillon à fourragères rouges (5F). Et voilà comment le premier Maillot jaune de l’histoire empochera plus que le vainqueur final !
Éric Fottorino Mes maillots Jaunes Stock 2019
3 07 1919
Après avoir lancé un appel condamnant le gouvernement turque, Moustafa Kemal préside un congrès à Erzeroum et y fait voter une motion réclamant l’indépendance et l’unité de la Turquie dans ses frontières nationales, ce qui coupe l’herbe sous les pieds de revendications indépendantistes des minorités grecques et arméniennes et conforte sa popularité tant le thème entrait en résonance avec la sensibilité de la majorité des Turcs.
14 07 1919
La veille, le lorrain Raymond Poincaré, a remis à Joffre, Foch et Pétain leur épée de maréchal. Et c’est environ deux millions de personnes qui assistent au défilé : les héros, ceux qui se sont sacrifiés doivent passer sous l’Arc de Triomphe avant les vivants : donc, on avait placé un cénotaphe – un cercueil vide – frappé de l’inscription Aux morts pour la patrie sous l’arche triomphale dans la nuit du 13 au 14 juillet pour une veillée funèbre, ce qui avait suscité une ferveur populaire se traduisant par des dépôts de gerbes de fleurs pendant toute la nuit.
En tête du cortège, mille mutilés, suivis des corps de troupes alliés, le tout entouré d’urnes embrasés, des canons pris à l’ennemi, de coqs gaulois, de mats avec écussons et drapeaux, de guirlandes. L’armée française ferme la marche avec à sa tête le maréchal Pétain sur son blanc destrier. Socialistes et catholiques restent en retrait.




Le maréchal Foch


Sur le cheval noir, Foch, sur le blanc, Pétain.





Chars Renault FT 17
[…] La foule attend.
Car ils vont bientôt passer, les illustres et les anonymes, héros ceints de lauriers et héros obscurs, tous aussi splendides, tous aussi chéris : ceux qui, de 1914 à 1918, ont fait trembler le monde d’espérance douloureuse et sacrée.
L’Arc de triomphe semble attendre aussi.
Sur la place immense, vide et claire, débarrassé de ses chaînes tristes de vaincu, entouré de canons prisonniers, sous le ciel empli de soleil, il se dresse, majestueux et serein, ouvrant son porche de gloire.
Près de lui, on est tout isolé de la foule que contient la triple rangée de cavaliers porteurs de fanions frissonnants qui gardent la place.
Et dans cette enceinte déserte, dans cette oasis de silence, la rumeur qui vient de s’élever là-bas, la rumeur immense, violente et profonde comme une force de la nature, la rumeur qui croît, s’approche, balaye tous les sons, tous les sentiments, la rumeur qui monte du pavé, tombe des branches, des fenêtres, des toits – la rumeur d’une foule, d’un peuple qui crie sa joie délirante et verse des larmes de bonheur – prend un caractère plus auguste et plus poignant.
Tout à l’heure, quand les mutilés sont passés, il y a eu une contrainte, une pudeur dans les acclamations. Devant des martyrs, les cris n’osaient s’élever trop joyeux.
Mis à présent, la clameur est là, autour de nous, sur nous, avec nous.
Un peu de poussière…
De l‘avenue de la Grande Armée – avant-garde de toute la gloire qui vient – débouche, sabre au clair, un peloton de gardes républicains.
Le pas puissant et rythmé de leurs chevaux ébranle les dalles. Ils passent.
Et puis, deux képis brodés de chêne d’or, deux hommes qui chevauchent botte à botte, l’un en uniforme noir et rouge, l’autre en tenue grise. L’un est Joffre, l’autre est Foch. Chacun d’eux a son histoire, sa légende, son auréole ; chacun d’eux a son immortalité. Ils viennent lents, calmes, les yeux fixés droit et haut. Ils saluent de leur bâton étoilé. Ils entrent sous la voûte. La minute s’éternise.
Un vol d’oiseaux, à ce moment, s’élance de l’Arc de Triomphe.
Le canon gronde, la foule clame, les guerriers de toutes les nations défilent.
Américains, aux baïonnettes qui n’en font qu’une, coiffés de casques plats, matelots au petit chapeau blanc, aux cous athlétiques et nets, précédés d’un tambour-major colosse ; Belges dont les clairons de cuivre bruni sonnent comme ils ont sonné à Liège, à Ypres, à Passchendaele ; Britanniques dont les musiciens ont des peaux de léopard sur la poitrine, et parmi lesquels les hindous au profil brun et mystérieux voisinent avec les géants aux kilts écossais ; Italiens en uniforme gris-vert, sur lesquels les cravates rouges des Garibaldiens mettent des tâches de sang ; Japonais au teint d’ambre chaud et aux moustaches de jais, montés sur des chevaux nerveux ; evzones grecs aux longs bonnets et aux flûtes longues ; Polonais en bleu horizon, en chapskas carrés, ayant tous sur l’épaule l’aigle blanc ; Portugais vêtus de bleu ; Roumains en tenue de campagne, aux faces de médaille ; Serbes superbes, profils busqués et démarche souple ; Tchéco-Slovaques coiffés du béret hardi – toutes les nations et toutes les races, de la plaine et de la montagne, des continents et des îles, celles qui ont une histoire très vieille et celles qui la commencent, toutes celles qui ont lutté dans la mesure de leurs forces contre l’asservissement, toutes ont été acclamées, fêtées, toutes ont reçu leur part éclatante dans le triomphe, et les grands chefs qui précédaient leurs troupes, et l’armée sublime des étendards.
Mais voici que la clameur se fait délirante, que l’enthousiasme se gonfle d’émotion, de tendresse et d’amour. C’est que là-bas, avenue de la Grande Armée, derrière la musique qui sonne Sambre et Meuse, fier, simple et grand comme un triomphateur romain, le maréchal Pétain arrive à la tête de ses poilus.
Un frisson qui, de vague en vague, va se propager jusqu’au bout du parcours ébranle la foule. Les fleurs volent plus serrées, le rythme des cris se fait plus rapide ; la vibration des drapeaux plus ailée.
Et le peuple de France salue les généraux dont les noms rappellent les victoires : Castelnau, Debeney, Humbert, Nudant, Maistre, Degoutte, Fayolle et Gouraud, le mutilé superbe qui, il y a juste un an, arrêtait la dernière des ruées allemandes, et Mangin au sourire froid qui, le premier, porta le coup de boutoir à la grande offensive.
Et le peuple de France salue les étendards immortels, guenilles d’or et de pourpre, troués par les éclats d’obus, dentelés par les balles, portés à l’honneur par ceux qui les portèrent à la mort.
Et le peuple de France en extase crie son amour, sa reconnaissance infinie à ses soldats qui viennent, passent sous l’Arc de triomphe, s’engagent dans l’avenue triomphale ; à tous, aux fantassins à fourragère rouge, jaune ou verte, aux artilleurs, aux cavaliers, aux hommes des tanks comme à ceux des avions, dont Fonck porte le drapeau, aux fusiliers marins comme aux légionnaires, comme aux zouaves bronzés, comme aux Sénégalais d’ébène.
L’enthousiasme populaire enfle à chaque nouvelle troupe qui passe. Mais, admirable de calme et de compréhension, la foule immense, qui emporterait, si elle le voulait, les barrages comme un fétu, se plie à la consigne. D’ailleurs, elle a devant elle ceux-là mêmes pour qui monte sa clameur, les soldats qui portent tous fourragères et décorations. Ils assurent l’ordre d’une façon si aimable, si fraternelle. Et parfois, un cavalier, gentiment, hisse sur son cheval une jeune femme fatiguée et rieuse.
Les fleurs pleuvent, l’allégresse sacrée monte des cœurs et des bouches, la lumière dorée emplit l’air.
L’avenue des Champs Élysées, bordée de mâts où les drapeaux flottent comme des ailes, serrée dans l’armature vivante de la foule, rutilante de couleurs, éclatante de bruit, monte vers l’Arc de triomphe.
Et de là-haut, comme d’une source inépuisable, coule le fleuve glorieux. Au son des musiques claires, tandis que palpitent les étendards troués et chéris, dans un ondoiement grandiose de baïonnettes et de sabres, à travers la poussière ténue, marchent les légions du monde à qui Paris fait une apothéose.
Joseph Kessel
Déridant son front redoutable, voici Foch à l’œil sibyllin. Pourquoi n’est-il pas connétable notre moderne Du Guesclin ? Près de lui, Joffre, en qui s’incarne le miracle du premier jour, alors qu’il fixa sur la Marne son légendaire demi-tour ! Voici l’ex-généralissime, le vainqueur de Verdun, Pétain, complétant le trio sublime qui fixa, France, ton destin. […] Mais derrière eux brillent des armes : ce sont les poilus, taisons-nous… Et l’on sent que la foule, en larmes, est prête à tomber à genoux.
[…] Ceux de Champagne et du Mort-Homme, ceux de la Meuse et de l’Artois, des Dardanelles, de la Somme, des Effarges et du Vauquois, ceux du Vartard, ceux du Dickmud… vont passer sous le bras levé de la Marseillaise de Rude… Leur jour de gloire est arrivé !
Theodore Botrel
Seule,
Mon mari et mon frère sont morts là-bas, glorieusement.
Je les pleure et ma douleur est immense.
Un jour pourtant les autres viendront et ce jour est proche.
Ce jour-là, je veux être au premier rang pour acclamer les revenants sublimes.
Ce jour-là, mon voile de deuil ne recouvrira pas mon visage, afin que mon ombre noire n’attriste pas ceux qui passeront.
Ce jour-là, j’aurai pour eux des baisers et des fleurs.
C’est ainsi que je fêterai mes morts, car ils sont morts pour que ceux-là reviennent ainsi.
Ils passeront, beaux, immenses, au milieu des vivats et des clameurs.
Ils passeront.
Quand le dernier sera passé, je reviendrai dans ma maison vide, je remettrai mon voile et je pleurerai.
Anonyme. En première page du Figaro du 14 07 1919

Sur les Champs Élysées, un mutilé de guerre vend des insignes.

Jean Galtier‑Boissière, Fêtes de la Victoire : le défilé des mutilés, 1919, huile sur carton, 39 x 72 cm, musée d’Histoire contemporaine, Paris.

Avant les soldats vaillants marchaient le soldats brisés. Voilà ce qu’on avait fait aux hommes quand ils n’étaient pas morts. Les milliers d’âmes de la foule se serrèrent dès l’ébranlement du défilé. Mille mutilés partaient en tête, les gueules cassées, les unijambistes, les manchots, dans le frémissement du silence qu’ils semaient comme un nuage. Ceux qui avaient perdu un œil, une bouche, le nez, ceux qui avaient eu l’oreille ou la face arrachée, qui avaient passé des mois et des mois dans des bandages, loin du monde, ils étaient là, offerts à tous les regards. La victoire n’avait pas beau visage. L’enfer passé, et l’enfer à venir, à la lumière du jour, montraient leur figure détruite. C’était le prix épinglé sur la marchandise. Des femmes pleuraient et des enfants dans leur jupe se cachaient les yeux. Désolation irrémédiable devant l’oeuvre humaine. Et l’on tenait pourtant au secret ceux qui avaient perdu l’esprit, ceux qu’on avait soumis à l’électricité et soupçonnés de lâcheté, parce que quoi ! croire que la guerre rend fou n’était pas patriotique. On les avait renvoyé dans la boue, sans respect. Et ceux qui étaient revenus vivants et encore plus fous, ces blessés sans blessure, de grands murs les gardaient. Qui aurait pu prévoir, avant d’entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes ? allait écrire dans dix ans l’un de ces combattants que la guerre avait horrifiés. Il ne défilait pas, mais l’âme héroïque et épouvantée battait le pavé de Paris. Cela dura longtemps comme une image persistante. Les jeunes Alsaciennes en tenue traditionnelle avaient beau passer sous l’Arc de Triomphe, l’horreur des hommes fracassés étourdissait encore ceux qui les avaient regardés.
Alice Ferney. Les Bourgeois. Actes sud 2017
25 07 1919
Instauration d’une taxe d’apprentissage pour financer les cours professionnels gratuits et obligatoires destinés aux apprentis.
31 07 1919
Fondation de la Confédération générale de la production française, qui compte 21 groupements professionnels, ancêtre du CNPF : Confédération Nationale du Patronat Français.
07 1919
La Russie renonce à ses droits sur la Chine, se désolidarisant ainsi des décisions du Traité de Versailles. Elle aura ainsi plus de crédibilité pour peser, fortifier, orienter le parti communiste chinois qui ne va pas tarder à voir le jour.
2 08 1919
Instauration de la censure cinématographique, exercée par une commission de trente membres. La censure de la presse écrite sera supprimée, elle, le 12 octobre suivant.
1 09 1919
Didier Daurat emporte le premier courrier de l’Aéropostale, sur la ligne Toulouse Casablanca : 36 heures en été, 60 heures en hiver. Son fondateur, Pierre Latécoère, avait une usine de wagons, reconvertie pendant la guerre en usine d’avions : la paix venue, il vit là une source de développement importante. Les Anglais disent :
Il y avait un naïf qui ne savait pas que la chose était impossible… alors, il l’a faite.
Pierre Latécoère tint plus un discours d’ingénieur :
J’ai fait tous les calculs. Ils confirment l’opinion des spécialistes : notre idée est irréalisable. Il ne reste plus qu’une chose à faire : la réaliser.
7 09 1919
Mise en place des sanatoriums pour soigner les tuberculeux.
10 09 1919
Signature du traité de Saint Germain en Laye : c’est l’officialisation du démembrement de l’Empire des Habsbourg : l’Autriche-Hongrie.
Le traité de Saint-Germain-en-Laye, parfois appelé traité de Saint-Germain, […], établit la paix entre les Alliés et l’Autriche, et consacre la dislocation de la Cisleithanie, remplacée par sept États successeurs selon le principe, posé dans le 10° des 14 points du président américain Woodrow Wilson, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Le traité entre en vigueur le 16 juillet 1920.
[…] Les Autrichiens, considérés par les Alliés comme peuple vaincu, ne bénéficient pas du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et la délégation autrichienne est exclue des négociations de paix à Saint Germain en Laye, commencées en . Le traité est d’ailleurs rédigé en français, anglais, italien et russe, mais pas en allemand : il est précisé que le texte en français fera foi en cas de divergence. Des Autrichiens manifestèrent alors leur mécontentement en brûlant l’ambassade de France à Vienne, le .
Il est fait droit à l’aspiration des Polonais d’intégrer la Galicie dans l’État polonais restauré dans son existence et dans ses droits et à l’aspiration des Roumains d’intégrer la Bucovine dans l’État roumain agrandi des provinces à majorité roumanophone de l’ancien Empire Austro-Hongrois et de l’ancien Empire russe. En revanche, en Galicie, en Bucovine comme en Ruthénie, aucun droit n’est fait aux aspirations des Ukrainiens à constituer leur propre État.
La revendication des Tchèques et des Slovaques en vue de se doter d’un pays commun est reconnue, et l’existence de la Tchécoslovaquie est reconnue. Les Allemands des Sudètes sont, comme ceux d’Autriche, déboutés de leur demande à intégrer la République de Weimar et se retrouvent avec le statut de minorité linguistique au sein de la Tchécoslovaquie.
La revendication des Slovènes, des Croates et des Serbes de l’Empire austro-hongrois de se doter d’un pays commun, qui englobe également la Serbie et le Monténégro, et l’existence du (nouveau) royaume des Serbes, Croates et Slovènes sont reconnus. En dépit des vœux de leurs habitants, quelques zones germanophones de la Basse-Styrie, la vallée de Mieβ en Carinthie et plusieurs îles et villes italophones de Dalmatie font partie de ce nouvel État.
Dans le Haut-ADIGE, outre 90 000 Italiens, 200 000 Allemands sont aussi intégrés malgré eux à l’Italie, la délégation italienne ayant fait valoir que la ligne de partage des eaux sur le col du Brenner est une frontière naturelle de l’Italie. L’Italie annexe également Triste, l’Istrie, quatre îles (Cherso, Unia, Lussino et Lagosta et une ville ( Zara) de Dalmatie, territoires également revendiqués par les Slovènes, les Croates et les Serbes.
Comme l’exige Georges Clemenceau, la république d’Autriche allemande (en allemand Deutschösterreich) est renommée en Autriche (en allemand Österreich), et la revendication d’une partie de sa population de bénéficier du 10° point de Wilson, en intégrant la nouvelle république d’Allemagne, est formellement rejetée, le traité interdisant ce rattachement. En revanche, quatre districts germanophones de l’ancien royaume dse Hongrie sont rattachés à l’Autriche, sous le nom de Burgenland.
L’ Autriche est obligée de procéder à des réparations. Le service militaire obligatoire est interdit.
[…] L’établissement des nouvelles frontières désorganisa les anciens circuits économiques. L’Autriche connut une forte inflation et un fort chômage. Ignaz Seipel obtint l’intervention de la Société des nations pour un plan de sauvetage économique qui s’accompagna de la création d’une nouvelle unité monétaire, le Schilling autrichien. L’activité économique reprit. L’Autriche put donc payer les indemnités de guerre stipulées par le traité de Saint-Germain-en-Laye.
Wikipedia
12 09 1919
Les mouvements indépendantiste irlandais et le parlement de Dublin sont interdits.
L’Italie n’a pas témoigné beaucoup de considération pour ses anciens combattants… qui vont grossir les rangs de tous les mécontents, dont ceux de Gabriele d’Annunzio qui prend de force la ville de Fiume, 50 000 habitants majoritairement italophones, aujourd’hui Rijeka en Croatie, à l’est de la presqu’île d’Istra, avec 2 600 arditi, dans sa rutilante Fiat 501 décapotable, sans attendre que les autorités internationales aient statué sur son sort. Il la tiendra jusqu’en janvier 1921.
Puisses-tu voir un jour la mer lointaine se couvrir de carnage dans ta guerre et plier sous tes couronnes tes lauriers et tes myrtes, ô toujours renaissante, ô fleur de toutes les races, arôme de toute la terre, Italie, Italie…
*****
Nous n’entendrons plus aujourd’hui l’écho de la vive effervescence qui accueillit en 1921 le jugement de Salomon faisant deux parts de Rieka : Fiume à l’Italie, Sushak à la Yougoslavie. Nous seuls peut-être, qui grimpons la côte de Trsat en épongeant nos fronts, parlons encore du poète-condotierre D’Annunzio. Ses avions ont survolé ce paysage. Il a planté sur ces monuments le tricolore italien. Il a régenté cette population et inventé pour elle la constitution de la Régence du Quarnaro. Dans la mairie que voilà , il a fait des mariages, comme partout, et aussi des divorces, comme nulle part ailleurs en Italie.
Il y a encore parmi nous, en Italie, raconte l’Ulysside, des divorcés de Fiume, au temps de l’administration annunzienne.
Pas nombreux, sans doute, étant donné le petit nombre de Fiumains.
Plus nombreux que vous ne pensez. De toutes les régions de l’Italie, des couples venaient à Fiume profiter du divorce possible, et d’ailleurs facile et sans frais. La chose faite, monsieur prenait le bateau et madame, le train. D’Annunzio avait deux amis de plus. Mais, comme tout va très vite à notre époque, ces beaux jours sont finis.
Marie Louise Bercher. Dalmatie, invitation au voyage
[…] Cinq cents jours durant, du haut de son mètres soixante quatre, le dandy règne sur une contre société expérimentale qui attire futuristes, dadaïstes, patriotes, bolcheviques et mercenaires de tout poil. D’autres allient nudisme, végétarisme et psychotropes, un aigle sur l’épaule. Pour le ravitaillement, on pille les navires longeant la côte. À mesure que la situation s’enlise, D’Annunzio invite l’inventeur de la radiodiffusion, Guglielmo Marconi, ou le maestro Arturo Toscanini à amplifier ses harangues. Dans les Mémoires italiennes le Noël de sang la troupe de Victor Emmanuel III sifflera la fin de l’aventure, en décembre 1920. […]
Margherita Nasi, Aureliano Tonet. Le monde du 25 octobre 2019
09 1919
Les services secrets allemands recrutent le caporal Adolf Hitler pour surveiller un groupuscule extrémiste, le DAP – Deutsche Arbeiter Partei. Mais, presque dans le même temps, ce dernier adhère au NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, le parti nazi, successeur du premier et y fait sa première intervention publique le 19 septembre, son premier discours le 16 octobre.
16 10 1919
Un général que personne n’attendait est venu conforter le camp des Russes Blancs : Nikolaï Ioudenitch qui a constitué son armée en Estonie en recrutant ses troupes dans les camps de prisonniers allemands et en étant abondamment approvisionné en armes par les Alliés. Zinoviev est à Pétrograd et envoie rapports sur rapports à Lénine, tous plus alarmants les uns que les autres. Ioudenitch arrive à Tsarskoïe Selo, à 8 km de Petrograd. Lénine prend peur et se résout à l’abandonner. Trotski, occupé sur le front sud, l’apprend, vient vite à Pétrograd, et s’affronte violemment avec Lénine : Abandonner Petrograd ! Jamais ! Lénine cède.
Il se retrouve avec Staline pour monter un plan de défense de la ville, où la terreur prendra autant de place que la galvanisation des troupes par les chants de Demian Bendy : ils feront des boucliers humains avec des civils en les disposant en tête des troupes pour que Ioudenitch n’ose pas tirer. Ils exécuteront nombre de soit-disant coupables. Et le patriotisme arraché par la terreur fonctionnera si bien que Ioudenitch sera finalement mis en déroute. Trotski n’avait pas hésité à prendre la tête d’un régiment éparpillé en enfourchant le premier cheval venu. L’homme vouait une grande admiration à la Révolution Française, qu’il connaissait très bien, en particulier à Robespierre et à toute la période de la Terreur.
Automne 1919
Les Russes blancs sont au maximum de leur avance : Kharkov, Kiev Koursk, Orel sont en leur mains ; Moscou est menacé. Mais l’avantage que leur donne la compétence stratégique et technique est battu en brèche par leur divisions qui les rend incapables de fédérer toutes les oppositions et les paysans. Ils ne parviennent pas à combler le vide institutionnel laissé par le massacre de la famille impériale. Les Rouges vont contre attaquer, reprendre en décembre Kharkov et Kiev. Parmi les officiers, Toukhatchevski : un an plus tôt, à l’âge de 25 ans, il prenait le commandement de la I° armée, la première grande unité opérationnelle de l’armée rouge. Les Cosaques, qui s’étaient mis aux cotés des Russes Blancs, vont partager avec eux la répression des Bolcheviques.
___________________________________________________________________________
[1] lequel transitoire viendra en rejoindre bien d’autres dans le grand ensemble du provisoire qui dure : en 2009, ce régime particulier conservait encore toute sa particularité et personne ne parlait d’y mettre fin.
[2] La Croatie et la Slovénie sont catholiques et leur alphabet est latin ; elles sont plus riches que la Serbie orthodoxe et dont l’alphabet est cyrillique.


Laisser un commentaire