| Publié par (l.peltier) le 30 septembre 2008 | En savoir plus |
13 01 1898
Dans l’Aurore, tiré à 200 000 exemplaires, Zola[1] , par son J’accuse lance une importante campagne de révision du procès de Dreyfus. L’usage réserve à la rédaction du journal le choix du titre : en l’occurrence, il était de Clemenceau, alors directeur politique de l’Aurore.
Le mensonge a ceci contre lui qu’il ne peut pas durer toujours, tandis que la vérité a l’éternité pour elle.
Émile Zola
Lettre à M. Félix FAURE, Président de la République
Monsieur le Président,
Me permettez-vous, dans ma gratitude pour le bienveillant accueil que vous m’avez fait un jour, d’avoir le souci de votre juste gloire et de vous dire que votre étoile, si heureuse jusqu’ici, est menacée de la plus honteuse, de la plus ineffaçable des taches ?
Vous êtes sorti sain et sauf des basses calomnies, vous avez conquis les cœurs. Vous apparaissez rayonnant dans l’apothéose de cette fête patriotique que l’alliance russe a été pour la France, et vous vous préparez à présider au solennel triomphe de notre Exposition universelle, qui couronnera notre grand siècle de travail, de vérité et de liberté. Mais quelle tache de boue sur votre nom – j’allais dire sur votre règne – que cette abominable affaire Dreyfus ! Un conseil de guerre vient, par ordre, d’oser acquitter un Esterhazy, soufflet suprême à toute vérité, à toute justice. Et c’est fini, la France a sur la joue cette souillure, l’histoire écrira que c’est sous votre présidence qu’un tel crime social a pu être commis.
Puisqu’ils ont osé, j’oserai aussi, moi. La vérité, je la dirai, car j’ai promis de la dire, si la justice, régulièrement saisie, ne la faisait pas, pleine et entière. Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre de l’innocent qui expie là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu’il n’a pas commis.
Et c’est à vous, monsieur le Président, que je la crierai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d’honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l’ignorez. Et à qui donc dénoncerai-je la tourbe malfaisante des vrais coupables, si ce n’est à vous, le premier magistrat du pays ?
La vérité d’abord sur le procès et sur la condamnation de Dreyfus.
Un homme néfaste a tout mené, a tout fait, c’est le colonel du Paty de Clam, alors simple commandant. Il est l’affaire Dreyfus tout entière, on ne la connaîtra que lorsqu’une enquête loyale aura établi nettement ses actes et ses responsabilités. Il apparaît comme l’esprit le plus fumeux, le plus compliqué, hanté d’intrigues romanesques, se complaisant aux moyens des romans-feuilletons, les papiers volés, les lettres anonymes, les rendez-vous dans les endroits déserts, les femmes mystérieuses qui colportent, de nuit, des preuves accablantes. C’est lui qui imagina de dicter le bordereau à Dreyfus ; c’est lui qui rêva de l’étudier dans une pièce entièrement revêtue de glaces ; c’est lui que le commandant Forzinetti nous représente armé d’une lanterne sourde, voulant se faire introduire près de l’accusé endormi, pour projeter sur son visage un brusque flot de lumière et surprendre ainsi son crime, dans l’émoi du réveil. Et je n’ai pas à tout dire, qu’on cherche, on trouvera. Je déclare simplement que le commandant du Paty de Clam, chargé d’instruire l’affaire Dreyfus, comme officier judiciaire, est, dans l’ordre des dates et des responsabilités, le premier coupable de l’effroyable erreur judiciaire qui a été commise.
Le bordereau était depuis quelque temps déjà entre les mains du colonel Sandherr, directeur du bureau des renseignements, mort depuis de paralysie générale. Des fuites avaient lieu, des papiers disparaissaient, comme il en disparaît aujourd’hui encore ; et l’auteur du bordereau était recherché, lorsqu’un a priori se fit peu à peu que cet auteur ne pouvait être qu’un officier de l’état-major, et un officier d’artillerie : double erreur manifeste, qui montre avec quel esprit superficiel on avait étudié ce bordereau, car un examen raisonné démontre qu’il ne pouvait s’agir que d’un officier de troupe. On cherchait donc dans la maison, on examinait les écritures, c’était comme une affaire de famille, un traître à surprendre dans les bureaux mêmes, pour l’en expulser. Et, sans que je veuille refaire ici une histoire connue en partie, le commandant du Paty de Clam entre en scène, dès qu’un premier soupçon tombe sur Dreyfus. À partir de ce moment, c’est lui qui a inventé Dreyfus, l’affaire devient son affaire, il se fait fort de confondre le traître, de l’amener à des aveux complets. Il y a bien le ministre de la guerre, le général Mercier, dont l’intelligence semble médiocre ; il y a bien le chef de l’état-major, le général de Boisdeffre, qui paraît avoir cédé à sa passion cléricale, et le sous-chef de l’état-major, le général Gonse, dont la conscience a pu s’accommoder de beaucoup de choses. Mais, au fond, il n’y a d’abord que le commandant du Paty de Clam, qui les mène tous, qui les hypnotise, car il s’occupe aussi de spiritisme, d’occultisme, il converse avec les esprits. On ne croira jamais les expériences auxquelles il a soumis le malheureux Dreyfus, les pièges dans lesquels il a voulu le faire tomber, les enquêtes folles, les imaginations monstrueuses, toute une démence torturante.
Ah ! cette première affaire, elle est un cauchemar, pour qui la connaît dans ses détails vrais ! Le commandant du Paty de Clam arrête Dreyfus, le met au secret. Il court chez madame Dreyfus, la terrorise, lui dit que, si elle parle, son mari est perdu. Pendant ce temps, le malheureux s’arrachait la chair, hurlait son innocence. Et l’instruction a été faite ainsi, comme dans une chronique du quinzième siècle, au milieu du mystère, avec une complication d’expédients farouches, tout cela basé sur une seule charge enfantine, ce bordereau imbécile, qui n’était pas seulement une trahison vulgaire, qui était aussi la plus impudente des escroqueries, car les fameux secrets livrés se trouvaient presque tous sans valeur. Si j’insiste, c’est que l’œuf est ici, d’où va sortir plus tard le vrai crime, l’épouvantable déni de justice dont la France est malade. Je voudrais faire toucher du doigt comment l’erreur judiciaire a pu être possible, comment elle est née des machinations du commandant du Paty de Clam, comment le général Mercier, les généraux de Boisdeffre et Gonse ont pu s’y laisser prendre, engager peu à peu leur responsabilité dans cette erreur, qu’ils ont cru devoir, plus tard, imposer comme la vérité sainte, une vérité qui ne se discute même pas. Au début, il n’y a donc, de leur part, que de l’incurie et de l’inintelligence. Tout au plus, les sent on céder aux passions religieuses du milieu et aux préjugés de l’esprit de corps. Ils ont laissé faire la sottise.
Mais voici Dreyfus devant le conseil de guerre. Le huis clos le plus absolu est exigé. Un traître aurait ouvert la frontière à l’ennemi, pour conduire l’empereur allemand jusqu’à Notre-Dame, qu’on ne prendrait pas des mesures de silence et de mystère plus étroites. La nation est frappée de stupeur, on chuchote des faits terribles, de ces trahisons monstrueuses qui indignent l’Histoire, et naturellement la nation s’incline. Il n’y a pas de châtiment assez sévère, elle applaudira à la dégradation publique, elle voudra que le coupable reste sur son rocher d’infamie, dévoré par le remords. Est-ce donc vrai, les choses indicibles, les choses dangereuses, capables de mettre l’Europe en flammes, qu’on a dû enterrer soigneusement derrière ce huis clos ? Non ! il n’y a eu, derrière, que les imaginations romanesques et démentes du commandant du Paty de Clam. Tout cela n’a été fait que pour cacher le plus saugrenu des romans feuilletons. Et il suffit, pour s’en assurer, d’étudier attentivement l’acte d’accusation, lu devant le conseil de guerre.
Ah ! le néant de cet acte d’accusation ! Qu’un homme ait pu être condamné sur cet acte, c’est un prodige d’iniquité. Je défie les honnêtes gens de le lire, sans que leur cœur bondisse d’indignation et crie leur révolte, en pensant à l’expiation démesurée, là-bas, à l’île du Diable. Dreyfus sait plusieurs langues, crime ; on n’a trouvé chez lui aucun papier compromettant, crime ; il va parfois dans son pays d’origine, crime ; il est laborieux, il a le souci de tout savoir, crime ; il ne se trouble pas, crime ; il se trouble, crime. Et les naïvetés de rédaction, les formelles assertions dans le vide ! On nous avait parlé de quatorze chefs d’accusation : nous n’en trouvons qu’une seule en fin de compte, celle du bordereau ; et nous apprenons même que, les experts n’étaient pas d’accord, qu’un d’eux, M. Gobert, a été bousculé militairement, parce qu’il se permettait de ne pas conclure dans le sens désiré. On parlait aussi de vingt-trois officiers qui étaient venus accabler Dreyfus de leurs témoignages. Nous ignorons encore leurs interrogatoires, mais il est certain que tous ne l’avaient pas chargé ; et il est à remarquer, en outre, que tous appartenaient aux bureaux de la guerre. C’est un procès de famille, on est là entre soi, et il faut s’en souvenir : l’état-major a voulu le procès, l’a jugé, et il vient de le juger une seconde fois.
Donc, il ne restait que le bordereau, sur lequel les experts ne s’étaient pas entendus. On raconte que, dans la chambre du conseil, les juges allaient naturellement acquitter. Et, dès lors, comme l’on comprend l’obstination désespérée avec laquelle, pour justifier la condamnation, on affirme aujourd’hui l’existence d’une pièce secrète, accablante, la pièce qu’on ne peut montrer, qui légitime tout, devant laquelle nous devons nous incliner, le bon dieu invisible et inconnaissable. Je la nie, cette pièce, je la nie de toute ma puissance ! Une pièce ridicule, oui, peut-être la pièce où il est question de petites femmes, et où il est parlé d’un certain D… qui devient trop exigeant, quelque mari sans doute trouvant qu’on ne lui payait pas sa femme assez cher. Mais une pièce intéressant la défense nationale, qu’on ne saurait produire sans que la guerre fût déclarée demain, non, non ! C’est un mensonge ; et cela est d’autant plus odieux et cynique qu’ils mentent impunément sans qu’on puisse les en convaincre. Ils ameutent la France, ils se cachent derrière sa légitime émotion, ils ferment les bouches en troublant les cœurs, en pervertissant les esprits. Je ne connais pas de plus grand crime civique.
Voilà donc, monsieur le Président, les faits qui expliquent comment une erreur judiciaire a pu être commise ; et les preuves morales, la situation de fortune de Dreyfus, l’absence de motifs, son continuel cri d’innocence, achèvent de le montrer comme une victime des extraordinaires imaginations du commandant du Paty de Clam, du milieu clérical où il se trouvait, de la chasse aux sales juifs, qui déshonore notre époque.
Et nous arrivons à l’affaire Esterhazy. Trois ans se sont passés, beaucoup de consciences restent troublées profondément, s’inquiètent, cherchent, finissent par se convaincre de l’innocence de Dreyfus.
Je ne ferai pas l’historique des doutes, puis de la conviction de M. Scheuter-Kestner. Mais, pendant qu’il fouillait de son côté, il se passait des faits graves à l’état-major même. Le colonel Sandherr était mort, et le lieutenant-colonel Picquart lui avait succédé comme chef du bureau des renseignements. Et c’est à ce titre, dans l’exercice de ses fonctions, que ce dernier eut un jour entre les mains une lettre-télégramme, adressée au commandant Esterhazy, par un agent d’une puissance étrangère. Son devoir strict était d’ouvrir une enquête. La certitude est qu’il n’a jamais agi en dehors de la volonté de ses supérieurs. Il soumit donc ses soupçons à ses supérieurs hiérarchiques, le général Gonse, puis le général de Boisdeffre, puis le général Billot, qui avait succédé au général Mercier comme ministre de la guerre. Le fameux dossier Picquart, dont il a été tant parlé, n’a jamais été que le dossier Billot, j’entends le dossier fait par un subordonné pour son ministre, le dossier qui doit exister encore au ministère de la guerre. Les recherches durèrent de mai à septembre 1896, et ce qu’il faut affirmer bien haut, c’est que le général Gonse était convaincu de la culpabilité d’Esterhazy, c’est que le général de Boisdeffre et le général Billot ne mettaient pas en doute que le fameux bordereau fût de l’écriture d’Esterhazy. L’enquête du lieutenant-colonel Picquart avait abouti à cette constatation certaine. Mais l’émoi était grand, car la condamnation d’Esterhazy entraînait inévitablement la révision du procès Dreyfus ; et c’était ce que l’état-major ne voulait à aucun prix.
Il dut y avoir là une minute psychologique pleine d’angoisse. Remarquez que le général Billot n’était compromis dans rien, il arrivait tout frais, il pouvait faire la vérité. Il n’osa pas, dans la terreur sans doute de l’opinion publique, certainement aussi dans la crainte de livrer tout l’état-major, le général de Boisdeffre, le général Gonse, sans compter les sous-ordres. Puis, ce ne fut là qu’une minute de combat entre sa conscience et ce qu’il croyait être l’intérêt militaire. Quand cette minute fut passée, il était déjà trop tard. Il s’était engagé, il était compromis. Et, depuis lors, sa responsabilité n’a fait que grandir, il a pris à sa charge le crime des autres, il est aussi coupable que les autres, il est plus coupable qu’eux, car il a été le maître de faire justice, et il n’a rien fait. Comprenez-vous cela ! voici un an que le général Billot, que les généraux de Boisdeffre et Gonse savent que Dreyfus est innocent, et ils ont gardé pour eux cette effroyable chose ! Et ces gens-là dorment, et ils ont des femmes et des enfants qu’ils aiment !
Le colonel Picquart avait rempli son devoir d’honnête homme. Il insistait auprès de ses supérieurs, au nom de la justice. Il les suppliait même, il leur disait combien leurs délais étaient impolitiques, devant le terrible orage qui s’amoncelait, qui devait éclater, lorsque la vérité serait connue. Ce fut, plus tard, le langage que M. Scheurer-Kestner tint également au général Billot, l’adjurant par patriotisme de prendre en main l’affaire, de ne pas la laisser s’aggraver, au point de devenir un désastre public. Non ! le crime était commis, l’état-major ne pouvait plus avouer son crime. Et le lieutenant-colonel Picquart fut envoyé en mission, on l’éloigna de plus loin en plus loin, jusqu’en Tunisie, où l’on voulut même un jour honorer sa bravoure en le chargeant d’une mission qui l’aurait sûrement fait massacrer, dans les parages où le marquis de Morès a trouvé la mort. Il n’était pas en disgrâce, le général Gonse entretenait avec lui une correspondance amicale. Seulement, il est des secrets qu’il ne fait pas bon d’avoir surpris.
À Paris, la vérité marchait, irrésistible, et l’on sait de quelle façon l’orage attendu éclata. M. Mathieu Dreyfus dénonça le commandant Esterhazy comme le véritable auteur du bordereau, au moment où M. Scheurer-Kestner allait déposer, entre les mains du garde des sceaux, une demande en révision du procès. Et c’est ici que le commandant Esterhazy paraît. Des témoignages le montrent d’abord affolé, prêt au suicide ou à la fuite. Puis, tout d’un coup, il paye d’audace, il étonne Paris par la violence de son attitude. C’est que du secours lui était venu, il avait reçu une lettre anonyme l’avertissant des menées de ses ennemis, une dame mystérieuse s’était même dérangée de nuit pour lui remette une pièce volée à l’état-major, qui devait le sauver. Et je ne puis m’empêcher de retrouver là le lieutenant-colonel du Paty de Clam en reconnaissant les expédients de son imagination fertile. Son œuvre, la culpabilité de Dreyfus était en péril, et il a voulu sûrement défendre son œuvre. La révision du procès, mais c’était l’écroulement du roman-feuilleton si extravagant, si tragique, dont le dénouement abominable a lieu à l’île du Diable ! C’est ce qu’il ne pouvait permettre. Dès lors, le duel va avoir lieu entre le lieutenant-colonel Picquart et le lieutenant-colonel du Paty de Clam, l’un le visage découvert, l’autre masqué. On les retrouvera prochainement tous deux devant la justice civile. Au fond, c’est toujours l’état-major qui se défend, qui ne veut pas avouer son crime, dont l’abomination grandit d’heure en heure.
On s’est demandé avec stupeur quels étaient les protecteurs du commandant Esterhazy. C’est d’abord, dans l’ombre, le lieutenant-colonel du Paty de Clam qui a tout machiné, qui a tout conduit. Sa main se trahit aux moyens saugrenus. Puis, c’est le général de Boisdeffre, c’est le général Gonse, c’est le général Billot lui-même, qui sont bien obligés de faire acquitter le commandant, puisqu’ils ne peuvent laisser reconnaître l’innocence de Dreyfus, sans que les bureaux de la guerre croulent dans le mépris public. Et le beau résultat de cette situation prodigieuse est que l’honnête homme, là-dedans, le lieutenant-colonel Picquart, qui seul a fait son devoir, va être la victime, celui qu’on bafouera et qu’on punira. O justice, quelle affreuse désespérance serre le cœur ! On va jusqu’à dire que c’est lui le faussaire, qu’il a fabriqué la carte-télégramme pour perdre Esterhazy. Mais, grand Dieu ! pourquoi ? dans quel but ? Donnez un motif. Est-ce que celui-là aussi est payé par les juifs ? Le joli de l’histoire est qu’il était justement antisémite. Oui ! nous assistons à ce spectacle infâme, des hommes perdus de dettes et de crimes dont on proclame l’innocence, tandis qu’on frappe l’honneur même, un homme à la vie sans tache ! Quand une société en est là, elle tombe en décomposition.
Voilà donc, monsieur le Président, l’affaire Esterhazy : un coupable qu’il s’agissait d’innocenter. Depuis bientôt deux mois, nous pouvons suivre heure par heure la belle besogne. J’abrège, car ce n’est ici, en gros, que le résumé de l’histoire dont les brûlantes pages seront un jour écrites tout au long. Et nous avons donc vu le général de Pellieux, puis le commandant Ravary, conduire une enquête scélérate d’où les coquins sortent transfigurés et les honnêtes gens salis. Puis, on a convoqué le conseil de guerre.
Comment a-t-on pu espérer qu’un conseil de guerre déferait ce qu’un conseil de guerre avait fait ?
Je ne parle même pas du choix toujours possible des juges. L’idée supérieure de discipline, qui est dans le sang de ces soldats, ne suffit-elle à infirmer leur pouvoir même d’équité ? Qui dit discipline dit obéissance. Lorsque le ministre de la guerre, le grand chef a établi publiquement, aux acclamations de la représentation nationale, l’autorité absolue de la chose jugée, vous voulez qu’un conseil de guerre lui donne un formel démenti ? Hiérarchiquement, cela est impossible. Le général Billot a suggestionné les juges par sa déclaration, et ils ont jugé comme ils doivent aller au feu, sans raisonner. L’opinion préconçue qu’ils ont apportée sur leur siège, est évidemment celle-ci : Dreyfus a été condamné pour crime de trahison par un conseil de guerre ; il est donc coupable, et nous, conseil de guerre, nous ne pouvons le déclarer innocent : or nous savons que reconnaître la culpabilité d’Esterhazy, ce serait proclamer l’innocence de Dreyfus. Rien ne pouvait les faire sortir de là.
Ils ont rendu une sentence inique, qui à jamais pèsera sur nos conseils de guerre, qui entachera désormais de suspicion tous leurs arrêts. Le premier conseil de guerre a pu être inintelligent, le second est forcément criminel. Son excuse, je le répète, est que le chef suprême avait parlé, déclarant la chose jugée inattaquable, sainte et supérieure aux hommes, de sorte que des inférieurs ne pouvaient dire le contraire. On nous parle de l’honneur de l’armée, on veut que nous l’aimions, que nous la respections. Ah ! certes, oui, l’armée qui se lèverait à la première menace, qui défendrait la terre française, elle est tout le peuple et nous n’avons pour elle que tendresse et respect. Mais il ne s’agit pas d’elle, dont nous voulons justement la dignité, dans notre besoin de justice. Il s’agit du sabre, le maître qu’on nous donnera demain peut-être. Et baiser dévotement la poignée du sabre, le dieu, non !
Je l’ai démontré d’autre part : l’affaire Dreyfus était l’affaire des bureaux de la guerre, un officier de l’état-major, dénoncé par ses camarades de l’état-major, condamné sous la pression des chefs de l’état-major. Encore une fois, il ne peut revenir innocent sans que tout l’état-major soit coupable. Aussi les bureaux, par tous les moyens imaginables, par des campagnes de presse, par des communications, par des influences, n’ont-ils couvert Esterhazy que pour perdre une seconde fois Dreyfus. Quel coup de balai le gouvernement républicain devrait donner dans cette jésuitière, ainsi que les appelle le général Billot lui-même ! Où est-il, le ministère vraiment fort et d’un patriotisme sage, qui osera tout y refondre et tout y renouveler ? Que de gens je connais qui, devant une guerre possible, tremblent d’angoisse, en sachant dans quelles mains est la défense nationale ! et quel nid de basses intrigues, de commérages et de dilapidations, est devenu cet asile sacré, où se décide le sort de la patrie ! On s’épouvante devant le jour terrible que vient d’y jeter l’affaire Dreyfus, ce sacrifice humain d’un malheureux, d’un sale juif ! Ah ! tout ce qui s’est agité là de démence et de sottise, des imaginations folles, des pratiques de basse police, des mœurs d’inquisition et de tyrannies, le bon plaisir de quelques galonnés mettant leurs bottes sur la nation, lui rentrant dans la gorge son cri de vérité et de justice, sous le prétexte menteur et sacrilège de la raison d’État !
Et c’est un crime encore que de s’être appuyé sur la presse immonde, que de s’être laissé défendre par toute la fripouille de Paris, de sorte que voilà la fripouille qui triomphe insolemment, dans la défaite du droit et de la simple probité. C’est un crime d’avoir accusé de troubler la France ceux qui la veulent généreuse, à la tête des nations libres et justes, lorsqu’on ourdit soi-même l’impudent complot d’imposer l’erreur, devant le monde entier. C’est un crime d’égarer l’opinion, d’utiliser pour une besogne de mort cette opinion qu’on a pervertie jusqu’à la faire délirer. C’est un crime d’empoisonner les petits et les humbles, d’exaspérer les passions de réaction et d’intolérance, en s’abritant derrière l’odieux antisémitisme, dont la grande France libérale des droits de l’homme mourra, si elle n’en est pas guérie. C’est un crime que d’exploiter le patriotisme pour des œuvres de haine, et c’est un crime, enfin, que de faire du sabre le dieu moderne, lorsque toute la science humaine est au travail pour l’œuvre prochaine de vérité et de justice.
Cette vérité, cette justice, que nous avons si passionnément voulues, quelle détresse à les voir ainsi souffletées, plus méconnues et plus obscurcies ! Je me doute de l’écroulement qui doit avoir lieu dans l’âme de M. Scheurer-Kestner, et je crois bien qu’il finira par éprouver un remords, celui de n’avoir pas agi révolutionnairement, le jour de l’interpellation au Sénat, en lâchant tout le paquet, pour tout jeter à bas. Il a été le grand honnête homme, l’homme de sa vie loyale, il a cru que la vérité se suffisait à elle-même, surtout lorsqu’elle lui apparaissait éclatante comme le plein jour. À quoi bon tout bouleverser, puisque bientôt le soleil allait luire ? Et c’est de cette sérénité confiante dont il est si cruellement puni. De même pour le lieutenant-colonel Picquart, qui, par un sentiment de haute dignité, n’a pas voulu publier les lettres du général Gonse. Ces scrupules l’honorent d’autant plus que, pendant qu’il restait respectueux de la discipline, ses supérieurs le faisaient couvrir de boue, instruisaient eux-mêmes son procès, de la façon la plus inattendue et la plus outrageante. Il y a deux victimes, deux braves gens, deux cœurs simples, qui ont laissé faire Dieu, tandis que le diable agissait. Et l’on a même vu, pour le lieutenant colonel Picquart, cette chose ignoble : un tribunal français, après avoir laissé le rapporteur charger publiquement un témoin, l’accuser de toutes les fautes, a fait le huis clos, lorsque ce témoin a été introduit pour s’expliquer et se défendre. Je dis que cela est un crime de plus et que ce crime soulèvera la conscience universelle. Décidément, les tribunaux militaires se font une singulière idée de la justice. [après un éloignement en Tunisie, le lieutenant colonel Picquart fera 331 jours de prison, puis sera mis en réforme. Il sera ministre en 1906 et mourra d’un accident de cheval en 1914. ndlr].
Telle est donc la simple vérité, monsieur le Président, et elle est effroyable, elle restera pour votre présidence une souillure. Je me doute bien que vous n’avez aucun pouvoir en cette affaire, que vous êtes le prisonnier de la Constitution et de votre entourage. Vous n’en avez pas moins un devoir d’homme, auquel vous songerez, et que vous remplirez. Ce n’est pas, d’ailleurs, que je désespère le moins du monde du triomphe. Je le répète avec une certitude plus véhémente : la vérité est en marche et rien ne l’arrêtera. C’est aujourd’hui seulement que l’affaire commence, puisque aujourd’hui seulement les positions sont nettes : d’une part, les coupables qui ne veulent pas que la lumière se fasse ; de l’autre, les justiciers qui donneront leur vie pour qu’elle soit faite. Quand on enferme la vérité sous terre, elle s’y amasse, elle y prend une force telle d’explosion que, le jour où elle éclate, elle fait tout sauter avec elle. On verra bien si l’on ne vient pas de préparer, pour plus tard, le plus retentissant des désastres.
Mais cette lettre est longue, monsieur le Président, et il est temps de conclure.
J’accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d’avoir été l’ouvrier diabolique de l’erreur judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d’avoir ensuite défendu son œuvre néfaste, depuis trois ans, par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables.
J’accuse le général Mercier de s’être rendu complice, tout au moins par faiblesse d’esprit, d’une des plus grandes iniquités du siècle.
J’accuse le général Billot d’avoir eu entre les mains les preuves certaines de l’innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s’être rendu coupable de ce crime de lèse-humanité et de lèse-justice, dans un but politique, et pour sauver l’état-major compromis.
J’accuse le général de Boisdeffre et le général Gonse de s’être rendus complices du même crime, l’un sans doute par passion cléricale, l’autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des bureaux de la guerre l’arche sainte, inattaquable.
J’accuse le général de Pellieux et le commandant Ravary d’avoir fait une enquête scélérate, j’entends par là une enquête de la plus monstrueuse partialité, dont nous avons, dans le rapport du second, un impérissable monument de naïve audace.
J’accuse les trois experts en écritures, les sieurs Belhomme, Varinard et Couard, d’avoir fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu’un examen médical ne les déclare atteints d’une maladie de la vue et du jugement.
J’accuse les bureaux de la guerre d’avoir mené dans la presse, particulièrement dans L’Éclair et dans L’Écho de Paris, une campagne abominable, pour égarer l’opinion et couvrir leur faute.
J’accuse enfin le premier conseil de guerre d’avoir violé le droit, en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète, et j’accuse le second conseil de guerre d’avoir couvert cette illégalité, par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d’acquitter sciemment un coupable.
En portant ces accusations, je n’ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit les délits de diffamation. Et c’est volontairement que je m’expose.
Quant aux gens que j’accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n’ai contre eux ni rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l’acte que j’accomplis ici n’est qu’un moyen révolutionnaire pour hâter l’explosion de la vérité et de la justice.
Je n’ai qu’une passion, celle de la lumière, au nom de l’humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n’est que le cri de mon âme. Qu’on ose donc me traduire en cour d’assises et que l’enquête ait lieu au grand jour !
J’attends.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de mon profond respect.
Émile Zola

L’article va servir d’étincelle à cinq jours d’émeutes à Alger où Maximilien Régis Milano, installé dans le fauteuil de maire après avoir été responsable étudiant, a pris la tête d’une croisade antijuif, conjuguant revendication pour l’autonomie d’une Algérie française et antidreyfusisme : cela ressemblera presque à un pogrom : magasins dévastés, parfois incendiés. Quelques juifs seront lynchés. À Paris, il se vendit entre 200 et 300 000 exemplaires de l’ Aurore. Il faut dire au demeurant que 4 grands quotidiens populaires – Le Journal, Le Petit Journal, Le Matin, Le Petit Parisien -, avaient à eux seuls 40 % du marché en totalisant 4.5 millions d’exemplaires par jour ! Cette presse, soucieuse de ratisser large était de ce fait contrainte à la prudence voire à une certaine fluctuation. Les journaux dont la première clientèle était la bourgeoisie, tels Le Temps, Le journal des débats, le Figaro, observaient encore la même prudence et, quand ils s’en démarquaient, payaient cher leur prise de position : ainsi du Figaro quand il prit la défense de Dreyfus. Les journaux politiques – l’Aurore, l’Humanité – dont la raison d’être était au contraire l’engagement étaient loin de faire de tel tirages.
Il n’est pas inutile de dire ce qu’était alors la bourgeoisie française, économiquement parlant – car, on le pense bien, ce n’est pas la classe ouvrière qui s’est enflammée sur l’affaire Dreyfus – : La bourgeoisie de l’âge industrielle avait sans doute mis au pinacle le travail, mais gardons-cous cependant des idées reçues. Certes, une bourgeoisie commerciale, marchande, en cours d’ascension sociale, se donne alors du mal pour faire fortune. Mais ce qui consacre la réussite sociale, c’est de pouvoir se dispenser de travailler. La bonne société est au-dessus des réalités alimentaires. Le travail, c’est pour les autres. Pour citer l’ancien directeur de l’enseignement primaire Buisson, en 1899, il y a deux classes en France, ceux qui possèdent sans travailler et ceux qui travaillent sans posséder. Ceux qui possèdent vivent de leurs rentes, loyers de leurs immeubles ou de leurs fermes, revenus de leurs placements. Au recensement de 1906, on dénombre 560 000 rentiers en France. C’est la Belle Époque de la bourgeoisie : ses fortunes s’accroissent de génération en génération sans qu’elle ait besoin de travailler. Classe du loisir, elle favorise la sociabilité, les clubs, la conversation, l’été à la campagne avec les amis, la culture – fille du loisir – comme disait Valéry. Nous sommes dans le monde des Petites filles modèles de la comtesse de Ségur : la bourgeoisie imite le mode de vie de l’aristocratie de l’Ancien Régime.
Il est certes des travaux honorables, pour les bourgeois qui n’ont pas encore hérité de leurs parents. Des professions qui leur laissent beaucoup de liberté dans l’usage de leur temps. Trente et un mille officiers, malgré la caserne, mènent une vie assez libre (il y a les sous-officiers pour faire les marches de nuit). Il en est de même pour les 6 000 à 7 000 avocats qui ne sont liés que par les séances du tribunal. C’est moins vrai pour les 8 500 notaires, les 21 000 médecins, et les 13 000 pharmaciens. Mais ils n’ont guère de comptes à rendre à des supérieurs : ce sont des professions libérales.
Beaucoup cessent de travailler quand l’héritage de leurs parents s’ajoute à la dot de leur femme. Si des magistrats ont démissionné quand l’État est devenu républicain, et des officiers après l’affaire Dreyfus, c’est aussi parce qu’ils n’avaient pas besoin de leur traitement pour vivre. Et l’État le savait, qui payait chichement les juges et exigeait des officiers que leur femme ait une dot représentant dix années de traitement d’un sous-lieutenant.
Antoine Prost. L’Histoire n° 368. Octobre 2011
On reste stupéfait, pantois devant cette schizophrénie française, qui consiste à faire des tonnes de lois qui vont toujours dans le sens de plus de justice, plus d’égalité, restant au demeurant de plus en plus souvent lettre morte faute de décrets d’application et à continuer en même temps à vivre dans l’Ancien Régime, avec des privilèges ahurissants : ainsi, on pouvait interdire à une officier d’épouser une femme sans dot ! ! mais comment l’institution militaire a-t-elle été en droit de pondre pareil règlement, beaucoup plus proche de l’apartheid alors en vigueur en Afrique du sud, que des principes républicains ! et si aujourd’hui la bourgeoisie a bien dû abandonner ce way of life, il n’a par contre pas encore déserté le palais de l’Élysée, où le président continue à être tenu pour un monarque – voir le succès en salle des Saveurs du Palais. Schizophrénie encore que cette aptitude devenue quasiment une deuxième nature à être heureux dans sa vie privée, et angoissé, déprimé dans sa vie publique, bureau des pleurs ouvert 24 h/24, 7 jours/7. Le double langage, la mauvaise foi sont en première ligne en permanence, arcboutés sur la défense corporatiste sans que jamais n’apparaisse le souci du bien commun.
14 01 1898
Sarah Bernhardt écrit à Emile Zola : Laissez-moi vous dire, cher Grand Maître, l’émotion indicible que m’a fait éprouver votre cri de justice. Je ne suis qu’une femme et je ne puis rien dire moi, mais je suis angoissée, je suis hantée, et votre belle page d’hier a été pour ma réelle souffrance un réel soulagement. Je voulais écrire à Scheurer-Kestner [2] pour le remercier au nom de l’humanité, mais sachant que tout est crime en ce moment pour cet homme admirable je me suis dit que si une artiste, que dis-je, une actrice était surprise en dévotion de son acte si courageux, on se servirait de cette découverte pour l’accabler. À vous que j’aime depuis si longtemps, je dis merci, merci de toutes les forces de mon intention douloureuse, qui me crie il y a un crime, il y a un crime ! Merci Émile Zola, merci Maître aimé. Merci, merci au nom de l’éternelle justice.
*****
C’est la France qui se jugera elle-même. Elle dira si elle veut redevenir un grand peuple de justice et de lumière ou si elle veut s’enfoncer à jamais dans une sauvage stupidité.
Jean Jaurès
01 1898
Lev Bronstein a 19 ans, – il se fera connaitre plus tard sous le nom de Léon Trotski : il s’est senti très tôt une vocation pour la propagation des idées subversives, et comme ce n’est pas très original en Russie, la police secrète – l’Okhranah – veille au grain et cela l’amène à tâter de la prison, lui et tout son groupe d’apprentis révolutionnaires d’abord à Nikolaïev puis à Kherson puis à Odessa. Il se mit à devenir amoureux d’Alexandra Sokolovskaïa qu’il n’avait su qu’écraser du temps de leur liberté, du haut d’une arrogance aussi précoce que son goût pour la révolution. En novembre de la même année, l’ensemble du groupe apprendra qu’il était condamné à un exil administratif de quatre ans, qui commença par la tour Pougatchev à Moscou, où il parvint à épouser officiellement Alexandra : il fallait faire vite, non qu’elle ait été enceinte, mais seulement parce qu’en Sibérie, on ne séparait pas les couples mariés, ce qui leur permettra d’avoir deux filles dans le premier lieu de déportation, Oust Kout, 57° N, à l’ouest du lac Baïkal, puis Verkhoïansk, la capitale du froid. Le statut de ces déportés administratifs n’avait que très peu à voir avec ce que sera le goulag sous Staline ; ils étaient payés… peu, mais suffisamment pour vivre, ils pouvaient aller et venir dans les villages alentour, ils pouvaient trouver un travail rémunéré etc… ce que fit Trotski en écrivant abondamment dans la presse locale… jusqu’à ce qu’il reçoive durant l’été 1902 les journaux marxistes publiés à l’étranger et se dise alors : je ne peux pas continuer à moisir ici, mon avenir est aux cotés de ceux qui font cette presse. Et de s’évader le 21 août 1902, plaquant là femme et enfants. Ce n’était pas bien compliqué alors de s’évader : il suffisait d’avoir l’argent nécessaire pour graisser la patte des policiers et contrôleurs divers tout au long du trajet, ce qui le mènera à Vienne, puis Paris et Londres. Pour voyager, il avait tout simplement acheté un passeport à un habitant d’Irkoutsk, nommé Trotski. Il se fera vite sa place au soleil dans les milieux dirigeants révolutionnaires, Lénine bien sur, mais encore Martov, Plekhanov, Parvus. Un jour qu’une admiratrice disait de lui à Plekhanov qu’il était un génie, ce dernier avait répondu : C’est précisément ce que je ne lui pardonne pas.
14 02 1898
Emmanuel Poiré est le petit fils rapatrié d’un soldat français demeuré en Russie après la défaite de Napoléon en 1812. C’est l’un des plus brillants dessinateurs de l’époque ; il a pris le pseudonyme de Caran d’Ache, qui signifie crayon en russe – karandache – : il publie 2 caricatures dans le Figaro : la première représente un dîner bourgeois qui met en valeur le coté bien convenable des agapes avec une admonition du maître de maison : surtout ne parlons pas de l’affaire Dreyfus. Le second dessin représente une scène de bataille dans le même lieu, quelques heures plus tard : tout est sens dessus dessous, tout le monde tape sur tout le monde et la légende dit : Ils en ont parlé.

1 – Surtout, ne parlons pas de l’Affaire Dreyfus. 2- Ils en ont parlé
15 02 1898
Le Maine, un navire de guerre de la marine américaine qui mouillait dans le port de la Havane est détruit par une mystérieuse explosion et coule avec 268 hommes d’équipage : ce soir-là, tous les officiers étaient à une réception en ville.
20 02 1898
Le sénateur Ludovic Trarieux, défenseur de Zola, voulant donner un statut à sa volonté de défense des libertés, crée la Ligue des Droits de l’homme.
22 02 1898
Louise Ménard, 22 ans, a un enfant de 2 ans. Elle partage avec sa mère, veuve, le bon d’alimentation hebdomadaire – 2 kilos de pain et 2 livres de viande – accordé par le bureau de bienfaisance du village. Ce jour-là, les deux femmes n’avaient pas mangé depuis 36 heures : Louise vole un pain de 6 livres dans la boulangerie de son cousin Pierre, qui porte plainte. Le procureur Vialatte demande la condamnation de la voleuse et le tribunal se retire pour délibérer.
Le président Magnaud a cinquante ans. Il en avait 14 lorsque Victor Hugo publiait Les Misérables ; il serait très étonnant qu’il ne l’ait pas lu tant le fond de cet homme sent par tous les pores de la peau une filiation directe avec notre géant. Mais après tout peut-être cette humanisation de la justice était-elle dans l’air ?
Il rend son jugement : Attendu qu’il est regrettable que, dans une société bien organisée, un des membres de cette société, surtout une mère de famille, puisse manquer de pain autrement que par sa faute. Que, lorsqu’une pareille situation se présente, le juge peut et doit interpréter humainement les inflexibles prescriptions de la loi. Attendu que la faim est susceptible d’enlever à tout être humain une partie de son libre arbitre et d’amoindrir en lui la notion du bien et du mal. Qu’un acte, ordinairement répréhensible, perd beaucoup de son caractère frauduleux lorsque celui qui le commet n’agit que poussé par l’impérieux besoin de se procurer un aliment de première nécessité. (…) Que l’irresponsabilité doit être admise en faveur de ceux qui n’ont agi que sous l’irrésistible impulsion de la faim. Qu’il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, sans dépens.
Louise Ménard est relaxée. Son nom vient d’entrer dans l’histoire du droit, accolé à celui du juge de Château-Thierry, qui a inventé pour elle l’état de nécessité : n’est pas pénalement responsable celui qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, accomplit un acte défendu par la loi. Dès le lendemain, le jugement de Magnaud est publié en première page du quotidien radical L’Avenir de l’Aisne. Quelques jours plus tard, la presse nationale s’empare de l’affaire. Le 14 mars, L’Aurore publie en une un court billet sous le titre Un bon juge, signé Georges Clemenceau. Les lecteurs s’émeuvent, une souscription est lancée en faveur de Louise Ménard. Le photographe Nadar envoie quarante francs, la princesse de Rohan, cinquante. Aux hommages adressés au juge Magnaud par Courteline et la journaliste Séverine se mêlent des mots d’anonymes : Je suis sûr que si le grand Victor Hugo était encore de ce monde, il se fût déplacé pour vous serrer la main
Un an plus tard, le juge Magnaud récidivera. Auréolé de sa nouvelle popularité, Paul Magnaud décide de défier sa hiérarchie. Non seulement il prononce la relaxe de l’accusé, mais il saisit l’occasion pour dire tout le mal qu’il pense d’une loi trop rigoureuse. Attendu que la société, dont le premier devoir est de venir en aide à ceux de ses membres réellement malheureux, est particulièrement mal venue à requérir contre l’un d’eux, il appelle tout juge à oublier, pour un instant, le bien-être dont il jouit généralement afin de s’identifier, autant que possible, avec la situation lamentable de l’être abandonné de tous qui, en haillons, sans argent, exposé à toutes les intempéries, court les routes et ne parvient le plus souvent qu’à éveiller la défiance de ceux auxquels il s’adresse pour obtenir quelque travail.
Le parquet fait appel, la Chambre des députés s’enflamme. L’avocat et député socialiste René Viviani annonce qu’il viendra lui-même défendre le vagabond devant la cour d’appel. Cinq mois plus tard, le garde des sceaux rédige une circulaire dans laquelle il reprend, sans le citer, plusieurs des arguments de Paul Magnaud, en demandant aux magistrats du parquet de mûrement réfléchir avant de renvoyer devant le tribunal des mendiants ou des vagabonds et de ne le faire que lorsqu’ils ont acquis la conviction qu’ils sont en présence d’un incorrigible et invétéré fainéant. Il faudra attendre soixante-dix ans pour que les délits de mendicité et de vagabondage soient abolis.
À Château-Thierry, le bon juge poursuit sa fronde. Le 24 août 1900, il voit comparaître devant lui Marie-Julie Véret, accusée d’avoir laissé mourir son enfant à la suite d’un accouchement clandestin. Paul Magnaud prend la plume : Marie-Julie Véret n’a agi que par crainte de la sourde hostilité et de la stupide et cruelle réprobation dont, en général, sont l’objet les filles-mères. C’est donc à la société contemptrice des filles-mères et si pleine d’indulgence pour leurs séducteurs qu’incombe la plus large part des responsabilités dans les conséquences, si souvent fatales pour l’enfant, des grossesses et accouchements clandestins. Autant de circonstances atténuantes qui justifient, de prononcer contre Marie-Julie Véret une simple amende de seize francs, dont il suspend aussitôt l’exécution.
Dans la petite maison à un étage que longe la Marne, au lieu-dit La Levée, une femme guette avec fierté le retour de Paul Magnaud. Marie-Thérèse Beineix, épouse Magnaud, est une fille naturelle. Elle est aussi la filleule de George Sand. Dix ans plus tôt, le juge a renoncé pour elle à sa vie de célibataire endurci. En l’épousant, il a aussi épousé son féminisme.
En ce XX° siècle naissant, les choses commencent à bouger. Deux femmes ont été autorisées à prêter le serment d’avocat. C’est devant le tribunal de Château-Thierry que l’une d’elles, Maitre Jeanne Chauvin, prononce sa première plaidoirie. Le président Magnaud lui réserve un accueil chaleureux et profite de l’occasion pour appeler l’institution judiciaire à s’ouvrir elle aussi aux femmes. En attendant, il mène combat pour elles. Les déboires conjugaux de ses concitoyens lui fournissent une belle occasion de dénoncer l’injustice faite aux épouses adultères, qui encourent alors une peine comprise entre trois mois et deux ans d’emprisonnement alors que l’époux volage, lui, risque au mieux une amende et seulement s’il commet son forfait au domicile conjugal.
Voilà justement que se présente devant Magnaud le cas d’une amoureuse surprise en flagrant délit chez son amant par les gendarmes, à la requête d’un mari furieux. Pour justifier la relaxe de l’épouse, le juge commence par observer que la maréchaussée a mieux à faire que de dresser la constatation de certains secrets d’alcôve, surtout si l’on songe que l’adultère ne trouble la liberté ou la propriété de personne, ni la paix publique. Puis il ajoute que face à des faits de cette nature, d’ordre tellement privé et intime que l’intérêt social n’en exige en aucune façon la répression, ni surtout la divulgation scandaleuse, le devoir du juge est de laisser tomber en désuétude, jusqu’à son abrogation inévitable, une loi si partiale et d’un autre âge. Le délit d’adultère ne sera définitivement abrogé qu’en… 1975.
Paul Magnaud décide d’innover aussi en matière de divorce. Sous la pression de l’Eglise catholique, la loi a fixé des conditions très strictes – adultère, condamnation infamante de l’un ou de l’autre époux, injures graves et répétées – à son acceptation. Convaincu que deux êtres ne peuvent être malgré eux enchaînés à perpétuité l’un à l’autre, l’anticlérical Magnaud prononce, le 12 décembre 1900, le premier divorce par consentement mutuel, avec là encore soixante-quinze ans d’avance sur la loi ! Deux ans plus tard, il franchit un nouveau pas en imposant aux époux Tisserot la garde alternée de leurs deux enfants de 6 et 9 ans, au motif que le père s’il a pu se montrer faible, n’en est pas moins un homme laborieux, économe et sobre et qu’il n’a donc en rien mérité cette sorte de déchéance de la puissance paternelle qui découle de la garde des enfants lorsqu’elle est confiée exclusivement à la mère.
Mais c’est une jeune ouvrière qui va offrir à Paul Magnaud l’occasion d’écrire l’un de ses plus cinglants jugements. Eulalie Michaud, employée dans un atelier de passementerie, a cédé aux avances du fils de l’un des principaux industriels de la région. De leur liaison est né un enfant. Le jeune homme de bonne famille promet le mariage à son amante, se montre un père attentionné pendant quelque temps, subvient aux besoins de la mère puis se lasse et l’abandonne pour une autre. Un jour de mai 1898, Eulalie Michaud le croise dans les rues de Château-Thierry au bras de sa rivale. Folle de colère, elle ramasse une pierre et la lance contre son amant, le blessant à l’œil. Il porte plainte, Eulalie Michaud est renvoyée devant le tribunal correctionnel pour violences légères, elle encourt entre six mois et deux ans de prison. Le juge Magnaud l’écoute avec attention raconter le désespoir dans lequel l’abandon l’a laissée, puis entend le jeune homme qui se montre particulièrement désobligeant, et enfin Monsieur le maire qui atteste de la bonne conduite de l’ouvrière.
Rentré chez lui, Paul Magnaud s’attelle à la rédaction de sa décision. Il rend hommage à l’excellente attitude de la prévenue qui s’est excusée de son emportement et s’en prend au plaignant, ce Don Juan du village, qui ose tirer profit de cette lacune de notre organisation sociale, laissant à une fille-mère toute la charge de l’enfant qu’elle a conçu, alors que celui qui, sans aucun doute, le lui a fait concevoir, peut se dégager allègrement de toute responsabilité matérielle. Un tel état de choses, poursuit le juge, qui met souvent la femme abandonnée dans la terrible alternative du crime ou du désespoir, est bien fait pour excuser dans la plus large mesure les mouvements et les actes violents auxquels elle peut se laisser aller contre celui dont le cœur est assez sec et le niveau moral assez bas pour lui laisser supporter, malgré sa situation aisée, toutes les charges de la maternité. Eulalie Michaud est condamnée à un franc d’amende.
Les journalistes de la presse nationale décident de venir voir de plus près ce singulier personnage, né en 1848 à Bergerac, décoré de la Légion d’honneur pour sa participation à la guerre de 1870, capitaine d’état-major dans l’armée de réserve, entré dans la magistrature à 33 ans après une modeste carrière d’avocat, qui est devenu sur le tard ce juge dynamiteur. En décembre 1900, Le Figaro dépêche l’un de ses rédacteurs, Jules Huret, à Château-Thierry. Invité au domicile du juge, le reporter découvre les centaines de lettres serrées par liasses qui dressent de fragiles colonnes autour de sa table de travail. Cursives soignées, anglaises fines écritures titubantes de pauvres gens, elles venaient de tous les coins de France et de tous les pays note-t-il. L’une d’elles s’adresse au juge de justice.
Devant Jules Huret, Paul Magnaud précise sa pensée : Tant qu’un esprit régénérateur n’aura pas pénétré cette sorte de caste féodale, le peuple sera réduit à une justice juridique, faite de discussions byzantines et d’interprétations pharisaïques. Cela n’est pas de la vraie justice ! Le président Magnaud s’enflamme : Pourquoi la justice a-t-elle deux plateaux, si le juge n’a le droit de se servir que d’un seul ? Il faut faire comprendre aux juges qu’il est bien meilleur d’absoudre. Quelle joie de découvrir, dans un prévenu, un innocent ! Quelle délicieuse sensation de démêler, au milieu des apparences, les véritables causes d’un crime ou d’un délit, de dégager les responsabilités complexes de la société, de l’atavisme, de l’éducation, de l’ignorance et de l’erreur, et de pouvoir, à l’abri des lois, tenir compte de ces éléments si divers pour une répression équitable ou pour la miséricorde.
Au journaliste qui lui fait alors remarquer que ses jugements sont souvent brisés par la cour d’appel, Magnaud répond d’un sourire : Je m’en console aisément en pensant que Galilée aussi a vu infirmer ses théories par le pape. La réprobation de ses pairs réjouit plutôt celui qui refuse obstinément tout avancement et pousse l’insolence jusqu’à enjoindre aux juges de paix qui dépendent de son autorité de supprimer désormais de leurs courriers à la hiérarchie judiciaire toutes les formules de politesse plus ou moins serviles et obséquieuses, qui n’ont d’autres résultats que d’abaisser la dignité humaine.
Paul Magnaud paiera cher le prix de cette irrévérence. En 1906, cédant à l’appel pressant de Clemenceau, le bon juge se présentera aux élections législatives sous l’étiquette des radicaux pour sauver une circonscription menacée par la droite. Il a accepté, en échange de la promesse de voir voter au Parlement la loi sur le pardon judiciaire qu’il a rédigée et qui doit permettre au juge d’absoudre un coupable lorsqu’il considère que la clémence est plus efficace que la répression.
Mais à l’Assemblée, Paul Magnaud n’est qu’un obscur député parmi 585 autres et la majorité de gauche a d’autres priorités. Déçu, amer, il décidera de ne pas se représenter et demandera sa réintégration dans la magistrature. La Chancellerie ne sera guère empressée de reprendre dans ses rangs un juge aussi rebelle à l’autorité. Elle finira par lui concéder un poste dans une juridiction de la Seine, en veillant à ce qu’il ne préside plus les audiences. Sur sa feuille de notation, son supérieur hiérarchique écrit en 1912 : Monsieur Magnaud est resté le bon juge, c’est-à-dire un magistrat pitoyable qui n’entend rien du devoir social du magistrat et qui ignore tout de la loi qu’il a reçu mission d’appliquer.
Paul Magnaud mourra le 27 juillet 1926, à l’âge de 78 ans. En 1994, le code pénal reconnaîtra officiellement l’état de nécessité inventé un siècle plus tôt par le bon juge de Château-Thierry.
Pascale Robert-Diard. Le Monde du 2 août 2016
23 02 1898
Zola est condamné à un an de prison et 3 000 Francs d’amende, Perrenx, gérant du journal, à 4 mois et 3 000 Francs. Ils se pourvoient en cassation, où l’arrêt est cassé. Mais l’affaire repart en assises, où la défense plaide l’incompétence de la cour, et l’on repart en cassation, où le pourvoi sera rejeté : Zola s’exilera en Angleterre.
31 03 1898
Éleonor Marx, quatrième fille de Karl Marx, a eu une vie compliquée : une première liaison à 17 ans avec Prosper Olivier Lissagaray, un journaliste français plus âgé qu’elle, qui a tenu tant que le père la désapprouvait, puis, quand il l’a admise, s’est rompue ; une autre liaison avec un homme marié, Edward Aveling qu’elle accompagnera quand il tombera malade en janvier 1898 : une fois mort, elle découvre qu’il s’est remarié l’année précédente avec une actrice… elle se suicide… en s’empoisonnant comme Madame Bovary qu’elle a traduit en anglais.
1 04 1898
Loi instaurant le principe de la mutualité : c’est la naissance des sociétés de secours mutuel.
9 04 1898
Loi instituant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail : l’indemnisation du travailleur est effective lorsque l’arrêt de travail est supérieur à 4 jours.
21 04 1898
Mac Kinley, président des États-Unis décide de l’intervention américaine à Cuba – ce sera en juin à Guantanamo – pour contraindre l’Espagne à un armistice avec les insurgés cubains, en lutte depuis trois ans pour leur indépendance. Le poète José Marti, père de l’insurrection, avait été tué dès le début des hostilités, en 1895, dans une charge de cavalerie à la bataille de Dos Rios : Le pays qui achète commande, le pays qui vend est à son service ; il faut équilibrer le commerce pour assurer la liberté ; le pays qui veut mourir vend à une seule nation, celui qui veut vivre vend à plusieurs nations. [propos repris par Che Guevara à la conférence de l’O.E.A. à Punta del Este en 1961].
04 1898
Henri Vaugeois et Maurice Pujo fondent l’Action Française. Charles Maurras en deviendra le maître à penser 7 mois plus tard.
1 05 1895
Il y a de cela bien longtemps, le bon sens disait Descartes, est la chose du monde la mieux partagée ; aujourd’hui il semblerait que l’antisémitisme lui dispute cette place : Dans les villes, ce qui exaspère le gros de la population française contre les Juifs, c’est que, par l’usure, par l’infatigable activité commerciale et par l’abus des influences politiques, ils accaparent peu à peu la fortune, le commerce, les emplois lucratifs, les fonctions administratives, la puissance publique . (…) En France, l’influence politique des Juifs est énorme mais elle est, si je puis dire, indirecte. Elle ne s’exerce pas par la puissance du nombre, mais par la puissance de l’argent. Ils tiennent une grande partie de de la presse, les grandes institutions financières, et, quand ils n’ont pu agir sur les électeurs, ils agissent sur les élus. Ici, ils ont, en plus d’un point, la double force de l’argent et du nombre.
Jean Jaurès. La question juive en Algérie, publié dans La Dépêche du 1° mai 1895.
et encore quelques semaines plus tard … en juin 1898 : Nous savons bien que la race juive, concentrée, passionnée, subtile, toujours dévorée par une sorte de fièvre du gain (…) manie avec une particulière habileté le mécanisme capitaliste, mécanisme de rapine, de mensonge, de corset, d’extorsion.
Jean Jaurès. Discours au Tivoli.
6 au 10 05 1898
En Italie, quelques jours plus tôt, un étudiant, fils de député radical très populaire, est mort dans un affrontement avec la police à Pavie, trois ouvriers de l’usine Pirelli ont été arrêtés pour avoir distribué des tracts socialistes : une foule en armes se rend maîtresse de plusieurs quartiers de Milan où ils décident de la grève générale. Le général Bava Beccaris fait arrêter les meneurs et bombarder au mortier et au canon les quartiers rebelles, faisant au moins quatre-vingt morts et des blessés par centaines.
2 06 1898
Le Docteur Paul Louis Simon, français installé à Karachi, découvre que les vecteurs qui transmettent la peste sont le rat et la puce. Le fléau a disparu d’Europe vers 1720, probablement à cause du remplacement progressif du bois par le ciment dans la construction : le rat noir, porteur de la puce tueuse se plait dans les maisons en bois mais pas dans l’habitat en maçonnerie où on ne voit que du rat gris, qui ne transmet pas la peste. La généralisation du port de sous-vêtements de coton, facilement lavable, contribua aussi à la disparition du fléau en Europe occidentale. Elle continue épisodiquement à faire des ravages en Inde.
12 06 1898
Les Philippines proclament leur indépendance, mais les Américains, qui ont besoin d’écouler leur surproduction en Chine, maintenant qu’est achevée leur chemin de fer transcontinental, ne l’entendent pas ainsi.
27 06 1898
À 54 ans, l’Américain Joshua Slocum jette l’ancre du Spray à Newport, Nouvelle Écosse : il boucle le premier tour du monde en solitaire à la voile : 46 000 milles. Il était parti le 1° juillet 1895, 2 ans, 11 mois et 26 jours plus tôt, après avoir reconstruit entièrement une vieille coque de 11 m. don d’un ami. Il écrira Seul autour du monde sur un voilier de onze mètres, qui rencontrera le succès plutôt tard, mais ne le mettra pas à l’abri du besoin. Le récit de sa vie ressemble plus à une continuelle galère qu’à une partie de farniente sous les cocotiers ; il connut la vie avec son cortège de joies et de peines tant que vécut son épouse aimée et… embarquée. Après sa mort prématurée, ce furent une suite d’épreuves sans fin. Il avait connu les dernières grandes heures de la marine à voile ; matelot à 16 ans, second à 18, capitaine à 25, il avait commandé le Northern Light, alors le plus grand voilier américain.
De passage à San Francisco en 1864, Slocum, devenu américain, entend exercer sa seconde profession : la construction navale. Le premier voilier à voir le jour est un bateau de pêche au saumon, avec lequel il part chasser la loutre de mer au large de Vancouver. L’intérêt et les gains sont limités ; Joshua ambitionne de commander un voilier. Il se voit d’abord confier un petit caboteur reliant San Francisco à Seattle, puis, l’année d’après, le Washington, un trois-mâts barque qui l’amène à Sydney, où il rencontre l’amour et épouse Virginia Walker, une riche héritière américaine de vingt et un ans. Leur voyage de noces les mène jusqu’aux confins de l’Alaska où le bateau – en pleine pêche aux saumons – fait naufrage. Pas question de perdre toute une campagne ! Fort de ses talents de charpentier, Joshua construit avec les débris de l’épave une baleinière de onze mètres, qu’il utilise pour transférer sa cargaison sur deux phoquiers arrivés à la rescousse. Pour avoir tout sauvé, ses armateurs ne lui tiennent pas rigueur de la perte de leur bateau ; ils lui confient une goélette qui assure le trafic passager entre San Francisco et Honolulu. Un an après leur mariage, Virginia accouche à bord d’un premier garçon, Victor, puis l’année suivante d’un deuxième garçon, auquel Joshua donne le nom de sa nouvelle embarcation, Benjamin Aymar. En juin 1875 naîtra au large des Philippines une petite Jessie. À Manille, Slocum renoue avec la construction navale. Aucun travail ne le rebute : de l’abattage des arbres à leur débardage jusqu’à la grève et leur équarrissage à la hache. Entre serpents et scorpions, humidité et touffeur tropicales, complot et tentative de destruction du chantier, Slocum s’acharne. Il livre au bout d’un an la coque commandée et reçoit en échange une goélette de quatre-vingts tonnes. Quatre ans plus tard, Joshua acquiert à Hong Kong le Northern Light, un trois-mâts carré de soixante-six mètres de long. Cet événement heureux en précède un autre : l’arrivée d’un quatrième enfant, James Abraham Garfield, le nom du président des États-Unis. Slocum peut savourer son bonheur : il parcourt le monde sur le plus beau voilier américain à flot, sa famille l’entoure, l’argent afflue. Les articles élogieux abondent sur cette famille yankee qui vit sur l’eau dans le plus beau des homes américains. Pourtant, comme le note un reporter venu à bord, un tour sur le pont suggère deux idées assez mélancoliques : les grands voiliers américains sont en train de tomber en désuétude ; il est bien difficile de trouver des marins américains. La première alerte vient de l’équipage, des rats de quai prompts à la mutinerie. Peu après New York, le Northern Light perd son gouvernail et doit relâcher dans un port du Connecticut. Les matelots refusent de ferler les voiles, coups et insultes pleuvent, le second, en tentant de s’emparer du meneur, est mortellement poignardé. Virginia Slocum, un revolver dans chaque main, ramène l’équipage à la raison. L’assassin est arrêté, mais Joshua, convaincu que ses poings suffiront à assurer le calme, s’obstine à poursuivre son tour du monde.
Nouvelle avarie au large de Bonne-Espérance, nouvelle escale forcée, nouvelle mutinerie, menée cette fois par un ancien forçat dénommé Slater, qui passe le trajet retour aux fers. À terre, Slocum est poursuivi devant la justice fédérale pour avoir faussement et cruellement emprisonné Slater. Il écope d’une amende de cinq cents dollars. À un journaliste venu l’interviewer, il répond avec une franchise déconcertante : Je ne suis pas une brute galonnée, mais j’ai mes idées personnelles sur la façon de commander un navire… Les anciens capitaines traitaient leurs matelots comme des êtres humains, sans les souquer ; mais en cas de nécessité, ils les tenaient avec une poigne de fer. Voilà ma manière.
Commence alors pour Joshua Slocum une longue descente aux enfers. À l’heure où vapeurs et coques en acier s’imposent, il s’entête, rassemble ses économies et achète comptant un petit trois-mâts barque désarmé, l’Aquineck, qu’il juge capable par vent favorable de se mesurer avec n’importe quel coursier à vapeur. Mais le 25 juillet 1885, Victoria, sa si jolie épouse, décède en baie de Buenos Aires, terrassée à trente-cinq ans par un mal mystérieux. Joshua ne s’en remettra jamais. Il était désemparé comme un navire dont le gouvernail est brisé, racontera son fils Garfield.
À compter de ce jour funeste, déboires et fortunes de mer s’enchaînent : son navire démâte puis connaît une voie d’eau, son chargement de foin est sujet à une quarantaine variable, Slocum – en état de légitime défense – tue un membre de son équipage et se retrouve en prison, sa cargaison de pianos se fracasse contre la coque et, pour finir, l’Aquineck s’échoue sur un banc de sable avant de se disloquer contre les rouleaux. Slocum n’est pas assuré, le voilà ruiné.
Avec les restes de l’épave, il construit un canot à voile de 10.67 mètres, baptisé Libertade, sur lequel il ramène sa famille aux États-Unis. Entretemps, il a épousé pour s’occuper de ses enfants, sa cousine germaine, Henriette Elliot. Elle n’aime pas la mer, ils ne s’aimeront jamais, et vivront le plus souvent séparés. Sa carrière de capitaine au long cours s’achève sur un échec. Pour subvenir à ses besoins, Slocum – sans instruction mais fort de ses lectures, de Don Quichotte à David Copperfield, de Darwin à Aldous Huxley – se lance dans la rédaction de cette traversée épique. Faute d’éditeur, il publie le Voyage du Libertade à compte d’auteur. Au bout du rouleau et sans commandement, il accepte à contrecœur de convoyer jusqu’au Brésil le Destroyer, un semi-sous-marin à vapeur. Il ne sera jamais payé.
Slocum touche le fond : il a perdu la femme et le bateau qu’il aimait, son livre est un échec, ses poches sont vides. La rencontre à Boston d’un ancien camarade le sauve du désespoir. Eben Pierce lui fait don du Spray, un dragueur d’huîtres qui croupit depuis sept ans dans une prairie de Fairhaven. Pas vraiment un cadeau, mais suffisant en tout cas pour que Slocum s’en entiche et se persuade que la vieille baille est capable d’effectuer le tour du monde.
Pendant treize mois, il reconstruit la coque avec un chêne de prairie qu’il abat lui-même. Sans moyens, il opte pour la simplicité : le gréement d’un sloop, un mât en spruce, une barre à roue, deux cabines – une au pied du mat pour la cuisine, l’autre à l’arrière dotée d’un hublot pour l’habitat. Le tout mesure 11,20 mètres de long pour une jauge de treize tonneaux. Son coût : 553,62 $.
Slocum appareille le 1° juillet 1895 avec 1,86 $ en poche, cap sur les Açores. Bien équilibré, le Spray se gouverne tout seul, dispensant Joshua de longues nuits à la barre.
[…] La présence de pirates dissuade Slocum d’emprunter le canal de Suez. Il rebrousse chemin et rejoint l’Atlantique où une felouque arabe le prend en chasse. Mais l’Océan est bonne mère : au moment où les pillards s’apprêtent à l’aborder, un coup de vent salvateur démâte leur embarcation. Après une escale aux Canaries puis une autre au Cap-Vert, le Spray cingle vers le Brésil qu’il atteint à la fin d’octobre 1895. Nouvelle émotion : en serrant de trop près la côte, le Spray s’échoue sur un haut-fond, et Slocum, qui ne sait toujours pas nager, manque se noyer. Trois mois plus tard, il embouque le détroit de Magellan et fait escale à Punta Arenas. Dans les redoutables canaux de Patagonie, deux dangers menacent le Spray : les williwaws – de furieux coups de vent venus du Pacifique – et la présence de sauvages ayant à leur tête Pedro le Noir, un métis renégat accusé de nombreux meurtres.
Slocum rencontre les uns et les autres. Les premiers l’obligent à faire demi-tour, les seconds s’enfuient après avoir marché sur les clous de tapissier que le capitaine a répandus sur le pont. Dix-neuf jours de lutte sont nécessaires pour atteindre le Pacifique. Après une halte à Juan Fernandez – l’île de Robinson Crusoe -, Slocum met le cap sur les Marquises, puis gagne les îles Samoa où il croise avec émotion Fanny Stevenson, qui lui fait cadeau des Instructions nautiques de son défunt époux.
Slocum enchaîne les milles : l’Australie d’abord, puis le détroit de Torres qui lui ouvre les portes de l’océan Indien. À Coco Keeling, il découvre le paradis ; au large de Bonne Espérance, il connaît l’enfer, puis les calmes plats. La remontée de l’Atlantique jusqu’aux abords du Gulf Stream s’effectue en 123 sans véritable problème.
La mer l’avait ménagé, le retour à la vie citadine ne l’épargne pas. Slocum attend que son exploit lui rapporte gloire et reconnaissance ; il n’a droit qu’à un accueil poli et un retour à la précarité. Pour vivre, il renoue avec l’écriture et les conférences. Le récit de son périple, d’abord publié en feuilleton dans le Century Magazine, sort le 24 mars 1900 en un seul volume, avant d’être régulièrement réédité. Slocum se morfond à terre. En décembre 1909, il décide de gagner avec son Spray vieillissant les îles Caïman. La mer, qui lui avait tout donné, lui prend la vie. Slocum disparaît au large du cap Hatteras ; nul ne le reverra plus.
Laurent Maréchaux. Écrivains voyageurs. Arthaud 2011
Joshua Slocum n’est pas le plus ancien des navigateurs solitaires et nous en connaissons qui ont réussi des expéditions notoires près de cinquante ans avant lui. Mais il est le premier qui soit revenu à son point de départ après avoir fait le tour de la terre, seul, sur un petit bateau.
Quelle bonne idée a eu le club des Libraires de France en rééditant l’admirable bouquin de Slocum, Sailing alone around the world, qui s’intitule en français Seul autour du monde sur un voiler de onze mètres. Tous ceux qui tiennent encore la barre d’un voilier reconnaissent leur maître en Slocum, l’homme qui croyait que la mer avait été spécialement créée pour qu’on navigue dessus.
Mais si l’enfant de la Nouvelle-Écosse, né dans le vent du large comme il le dit lui-même, demeure dans son genre le meilleur des marins, il faut lui donner la première place parmi ceux qui ont écrit, plus tard, le récit de leurs longs voyages. Son livre, si merveilleusement simple, est plein de saveur et de vie, et dans les pires tempêtes comme sous la menace des sauvages, il garde le mérite de ne jamais se voir déserter par l’humour.
Depuis des années, nous faisons le gros dos pendant les fêtes, incapables de regilbocher à jour fixes, stupéfaits par ces gens qui se dérident ou, au contraire, font triste mine selon les injonctions du calendrier. La maison, prise dans le vent d’autan, tangue un peu sur la colline et nous nous enfonçons dans les nuits de fin d’année comme le capitaine sur la mer.
Slocum, qui représente pour tout le monde le sérieux, l’expérience, la sagesse, la prudence même, et le bon sens inébranlable, n’est pas insensible aux mirages. Il a vu des phoques gros comme des baleines, un albatros aussi grand qu’un navire et, le lendemain, il naviguait entre des objets minuscules dans un monde en réduction. Nous le sentons prêtes à croire qu’au large du cap de Bonne espérance, le « Hollandais volant » croise toujours et à sentir la poésie des îles Keeling, qui se révèlent aux marins par la visite d’un oiseau blanc.
Une nuit, entre les Açores et Gibraltar, Slocum vit un homme à la barre de son bateau: il était vêtu comme un marin étranger, et portait un grand bonnet rouge incliné sur l’oreille gauche ; sa figure était toute recouverte d’une épaisse barbe noire en broussaille ; dans n’importe quelle partie du monde, on l’aurait immédiatement pris pour un pirate.
Slocum oublia la tempête dont le pilote semblait sortir et crut qu’on venait lui couper la gorge. Mais l’homme, enlevant poliment son bonnet, dit avec un faible sourire: Señor, je ne suis pas venu vous faire du mal. Après quoi, il explique placidement qu’il était un marin de Christophe Colomb, le pilote même de la Pinta, et qu’il était là pour sauver le Spray des vagues. Puis il coupa de ses dents une grosse chique de tabac noir et se mit à chanter des chansons sauvages.
Par la suite, Slocum pensa souvent au vieux visiteur et à la façon dont le Spray était sorti de la tempête, parcourant quatre-vingt dix milles en une seule nuit sur une mer démontée et sans perdre un instant le cap que son maître, la veille, lui avait donné.
Il en parla même à un loup de mer du cap Cod, le capitaine Howard, qui lui tenait compagnie, entre Montevideo et Buenos Aires, pendant la traversée du Rio de la Plata. Évoquant le pilote de la Pinta qui gouverna le Spray au large des Açores, Slocum ajouta que, dans un coup de vent comme celui qu’ils étaient précisément en train de subir, il s’attendait toujours à le voir prendre la barre.
Howard ne dit rien. Mais lorsque Slocum lui proposa de le reconduire à Montevideo, il secoua négativement la tête et prit un bateau à vapeur. Peut-être savait-il que la Pinta, la rapide et jolie caravelle avait eu de sérieuses difficultés avec son gouvernail dès le début du premier voyage de Colomb. Peut-être avait-il entendu parler du redoutable Gomez Rascon qui sabota le gouvernail. L’histoire vraie de la Pinta se trouve dans les Œuvres de Christophe Colomb.
Joshua Slocum est parti de Boston le 24 avril 1895 et il a touché Newport (U.S.A.) le 27 juin 1898, après avoir franchi le détroit de Magellan et doublé le cap de Bonne Espérance. Son voyage a duré trois ans, deux mois et deux jours. Ce qui l’a le plus surpris pendant ces année magiques où il répétait pour lui-même la complainte de la solitude, ce n’est pas le marin fantôme ou l’albatros géant.
En décembre 1897 Slocum arrivait en Afrique du Sud, à Durban. C’est là qu’il reçut la visite de trois savants géographes qui composaient, avec l’appui du gouvernement, un mémoire où ils expliquaient au monde que la terre était plate. Les trois hommes de science demandèrent à Slocum si son expérience ne pouvait rien apporter en faveur de leur thèse. Le capitaine leur fit part de son impuissance et, dit-il, ils en parurent désolés.
Trois plus tard, à Prétoria, Slocum fut présenté au président Krüger qui sursauta lorsqu’on lui dit que le Spray faisait un voyage autour du monde. Vous voulez dire sur le monde dit l’homme du Transvaal qui savait bien que la terre était plate. Hitler, lui, croyait que la terre était creuse et que nous vivions, sans le savoir, sur les parois internes d’une grosse boule. J’ai connu un homme bien élevé, mais convaincu, comme Krüger, que la terre était plate. Ce qui le distinguait des autres esprits de sa famille, c’est qu’il n’était pas chef d’État.
Le voyage du Spray est le chant de l’amour du monde, c’est l’émerveillement de la vie que le petit sloop américain inscrit à jamais sur les eaux. Au mois de mai 1897, le capitaine Slocum était à Juan Fernandez, l’île de Robinson Crusoé, ou plutôt l’île d’Alexandre Selkirk, ce matelot écossais dont le séjour de quatre ans et quatre mois dans une île déserte inspira à Daniel Defoe son livre. Mais l’île de Crusoé se trouve devant l’embouchure de l’Orénoque, tandis que Juan Fernandez est au large de Valparaiso.
De Juan Fernandez, Slocum a gardé le souvenir d’une escale ravissante, ce sont ses mots, avec des collines boisées, des vallées fertiles, des ruisseaux d’eau claire, des chèvres et des fruits sauvages. L’idée que Selkirk a pu quitter cette île dépasse, dit-il, son entendement.
Cependant, il la quittera, lui aussi, peut-être parce qu’elle n’est plus déserte, et reviendra vers les États-Unis, avant de trouver en mer, une fin mystérieuse. Slocum s’est souvent répété la petite phrase que lui a dit Mme Stevenson, rencontrée aux iles Samon. Parlant de Robert Louis, qui était mort trois ans plus tôt, elle dit simplement ; nos goûts étaient les mêmes. Nous regardons alors passer une ombre dans les rêveries du capitaine. J’ai sous les yeux en ce moment-même la photographie de la belle Virginia-Albertina épousée en Australie et qui mourut à Buenos-Aires. N’est-ce pas dans ces yeux noirs qu’il faut chercher l’explication du fabuleux voyage ?
Le vent souffle sur la colline. Je songe à la mer, aux îles, aux femmes qui ont le cœur de nous suivre. Le Spray avait 11.20 m. sur 4.32 m. et 1.27 m. de creux. Slocum le tira d’un rafiot échoué qui avait fait, cent ans plus tôt, la pêche aux huîtres sur la côte du Delaware. Le capitaine avait cinquante et un ans quand il partit pour le tour du monde et, après trois ans deux mois et deux jours des plus dures épreuves, il constata qu’il se sentait plus jeune que jamais et qu’il avait grossi d’une livre. Encore un détail pour finir. La capitaine Slocum ne savait pas nager.
Kleber Haedens L’air du pays Albin Michel 1963




10 07 1898
Sous l’impulsion décisive de Cecil Rhodes [3], directeur de la compagnie concessionnaire des Rhodésies, Chartered British South Africa Company, les Anglais entreprennent de réaliser leur rêve colonial : une liaison sous influence anglaise du Cap au Caire : elle ne sera effective qu’en 1918. La France, elle, rêve encore plus large : une liaison d’Alger au Congo par le Tchad, et une autre du Congo au Nil, puis Djibouti, sur la Mer Rouge, par l’Oubangui, et c’est la mission de Marchand. Les deux rêves vont se heurter à Fachoda.
Parti de Loango, au sud de l’embouchure du Congo en mars 1897 avec 8 officiers et 154 tirailleurs sénégalais, le capitaine Marchand avait remonté l’Oubangui, l’Ouellé, franchit les monts Bomou et descendu le Soueth, puis le Bahr-el-Ghazal, affluent rive gauche du Nil pour arriver le 10 juillet 1898 à la confluence du Bahr el-Ghazal avec le Nil, au petit village de Fachoda, dans le sud Soudan, à la croisée de deux axes perpendiculaires traversant l’Afrique du nord au sud et d’est en ouest : les Anglais comme les Français se sont mis en tête que celui qui tiendrait la place, tiendrait l’Afrique.
Après avoir mis en déroute le 1° septembre les Ansar – les troupes du Madhi ou derviches – à Omdurman, et dispersé ses cendres dans le Nil, lord Kitchener y arrivera le 18 septembre, à la tête d’une armée anglo-égyptienne de 25 000 hommes, dont près de 10 000 britanniques, disposant du télégraphe, sous le drapeau égyptien, ordonnant le départ des Français : Marchand n’évacuera Fachoda que le 7 novembre, après en avoir reçu l’ordre de son gouvernement : Le gouvernement, seul juge sous sa responsabilité devant le parlement des intérêts généraux de la France, estime qu’ils ne doivent pas être liés à ce point au Nil […] Le commandant Marchand comprendra que l’amour de la patrie se mesure […] à ce qu’on lui sacrifie. Rien de plus portatif qu’un drapeau… Heureusement qu’il n’engagea pas de bataille : elle aurait été perdue d’avance. Il traversera alors l’Éthiopie jusqu’à Djibouti et sera triomphalement accueilli à son retour à Paris. Lord Kitchener y arrivera le 18 septembre, à la tête d’une armée anglo-égyptienne de 20 000 hommes, sous le drapeau égyptien, ordonnant le départ des Français.
A l’est de l’Afrique, la France n’aura que la Côte française des Somalis.
07 1898
Pierre et Marie Curie annoncent avoir isolé de la pechblende – un minerai riche en uranium – deux nouveaux éléments, beaucoup plus radioactifs que l’uranium : le polonium et le radium.
La duchesse d’Uzès est la première femme à avoir obtenue son certificat de capacité à conduire une automobile – le permis de conduire d’alors – . Elle roule à 15 km/h sur l’avenue du bois de Boulogne à Paris dans sa Delahaye Type 1, au lieu des 12 km/h autorisés : elle écope d’une amende de 5 Francs : elle est ainsi la première femme verbalisée pour excès de vitesse.
4 08 1898
Il y a déjà une bonne paire d’années que Guglielmo Marconi, 24 ans, s’est découvert une vocation pour la transmission sans fil. L’homme n’est pas un scientifique, mais un bricoleur génial qui avance dans son domaine vista de naso, parvenant à des résultats souvent beaucoup plus étonnants que ses collègues, scientifiques reconnus et patentés. Il n’a pas cru devoir soumettre ses travaux au gouvernement italien et a choisi d’aller en Angleterre, où il a un peu de parenté : sa mère est irlandaise. Et l’Angleterre est encore pour un temps la première puissance mondiale. Mais il n’est pas habile négociateur et maintient jalousement le secret autour de ses découvertes, chose qui ne passe pas bien dans l’Angleterre victorienne et, mais là il n’invente rien , il est grand adepte du tout à l’égo ; [vingt-cinq ans plus tard, il n’aura pas changé de tempérament et donc adhérera de tout cœur au fascisme de Mussolini]. Chance, ce jour-là ce sont ses appareils qui ont été choisis pour que puissent communiquer l’impératrice Victoria et son fils, au repos sur son yacht à trois km d’Osbourne House, où résidait Victoria :
Tous ceux qui lisaient le journal savaient qu’en ce moment le prince de Galles était en convalescence à bord du yacht royal pour se remettre de ses blessures à la jambe causées par une chute dans un escalier durant un bal donné à Paris. Sa mère, la Reine Victoria, aurait aimé qu’il passe cette période dans le domaine royal d’Osbourne House où elle séjournait, mais Edouard préférait le yacht… et un peu de distance. Le bateau était amarré à quelques trois kilomètres dans le Solent, ce bras de mer qui sépare l’île de Wight de l’Angleterre. Jusqu’à très peu de temps auparavant, cette distance aurait protégé l’intimité du prince, mais sa mère avait lu des articles sur Marconi et elle venait de lui demander d’assurer une liaison sans fil entre le château et l’Osbourne.
Toujours désireux d’attirer l’attention de la presse, Marconi accepta. Sur ses indications, les ouvriers allongèrent le mât du yacht et firent courir un fil électrique sur toute la longueur, produisant ainsi une antenne qui s’élevait à environ vingt-cinq mètres au-dessus du pont. Il installa un émetteur qui inonda de lumière le poste d’envoi et provoque un claquement de tonnerre miniature qui le força à se boucher les oreilles avec du coton. À Osbourne House, dans une dépendance appelée Ladywood cottage, Marconi supervisa la construction d’un autre mât, d’une hauteur de trente mètres.
À un certain moment, pour ajuster ses équipements, Marconi tenta de traverser les jardins alors que la reine s’y promenait dans son fauteuil roulant. Victoria tenait beaucoup au respect de son intimité et demandait à son personnel de veiller à prévenir toute intrusion. Un jardinier arrêta Marconi et lui ordonna de rebrousser chemin et de faire le tour.
Marconi, du haut de ses vingt-quatre ans, refusa tout net, et annonça au jardinier qu’il traverserait ce parc ou abandonnerait le projet. Il fit demi-tour et rentra à l’hôtel.
Un domestique rapporta la réaction de Marconi à la reine. De son ton à la fois doux et impérieux, elle dit : Trouvez un autre électricien
Hélas, votre Majesté, répondit le domestique. L’Angleterre n’a pas d’autre Marconi.
La reine réfléchit, puis fit envoyer une calèche royale à l’hôtel de Marconi pour le ramener. Ils se rencontrèrent et discutèrent. Elle avait soixante-dix-neuf ans, lui émergeait à peine de l’adolescence, mais il parlait avec l’assurance d’un Lord Salisbury et elle tomba sous le charme. Elle loua son travail et lui souhaita une belle réussite.
Avant peu, la reine et son fils communiquaient régulièrement grâce à la télégraphie sans fil. Au cours des deux semaines suivantes, Victoria, Edouard, Sir James Reid, le médecin du prince, échangèrent environ cent-cinquante messages, dont la nature suffit à prouver que, quelle que soit l’innovation technologique employée pour l’acheminement de leurs messages, les hommes et les femmes trouveront toujours le moyen de les rendre insipides : Le 4 août 1898, Sir James à Victoria : SAR le Prince de Galles a passé une excellente nuit, il est de très belle humeur et en parfaite santé. Son genou ne donne aucun signe d’inquiétude.
Le 5 août 1898, Sir James à Victoria : SAR le Prince de Galles a passé une excellente nuit et son genou est au mieux. On trouve aussi trace d’un échange passionnant entre une invitée du prince, à bord de l’Osbourne, et une autre femme qui séjournait au château : Pourriez-vous venir prendre le thé avec nous demain ?
Et la réponse qui fendit l’air immédiatement : Impossible, désolée…
Erik Larson. Les passagers de la foudre. Le cherche-midi 2006
29 08 1898
Les capitaines Gouraud et Gaden mettent fin à la guérilla que menait depuis dix ans contre les troupes coloniales le roi Samory, descendant de marchands dioula, dans le sud Soudan, actuellement sud Mali, nord Côte d’Ivoire, nord Guinée. Fait prisonnier, il mourra en exil au Gabon en 1900.
10 09 1898
À Genève, l’anarchiste italien Luigi Lucheni assassine Sissi, impératrice d’Autriche, épouse de François Joseph. Elle avait 61 ans. Il a porté son choix sur elle, par dépit, tout simplement parce que la veille, il avait manqué Henri d’Orléans. Dans sa trousse de toilette, on trouvera une seringue à cocaïne : elle souffrait épisodiquement d’une bien méchante sciatique. Par bien des aspects de sa personnalité complexe, elle était en avance sur son temps – salle de gymnastique, marche à pied quasi quotidienne, installation d’un générateur dans son palais de Corfoue, etc… – : lorsqu’on est de la classe moyenne, on se fait classer dans ces cas dans la rubrique original ; mais quand on est l’épouse de l’empereur d’Autriche, on est sur et certain de se mettre à dos toute la cour, avec au premier rang la belle-mère. Et il en alla ainsi.
Romy Schneider sera Sissi à l’écran, avec une vérité que l’on n’aurait osé souhaiter, dans un film d’Ernst Marischka en 1955. La tragédie qui ne quittera jamais le cœur de la vie de ces deux femmes ne pouvait que favoriser cette fusion entre un personnage historique et son rôle interprété près de soixante ans plus tard.

le jour du couronnement à Budapest le 8 juin 1867

15 09 1898
Depuis la promulgation en date du 11 juin d’un édit impérial, c’est à un festival de réformes que s’invite la Chine – les Cent jours – dont la principale est la suppression du pa-kou wen-tchang, l’examen d’accès au statut de fonctionnaire : cela venait déranger les habitudes de centaines de milliers d’étudiants ; un nouveau système d’instruction à l’occidentale est institué, l’armée elle aussi sera instruite à l’occidentale, on crée des écoles techniques pour la médecine, l’architecture, les mines. L’empereur Guangxu, âgé de 27 ans, a voulu mettre en œuvre le programme d’un lettré cantonnais, Kang Youwei, et il ne cesse de déclarer : Les nations étrangères cernent notre empire ; si nous ne consentons pas à adopter leurs méthodes, notre ruine est irrémédiable. Kang Youwei était pressé : Nous ferons en trois ans ce que le Japon a accompli en trente ! Dans ses ouvrages de théoricien il cherchait à relire Confucius en le traduisant dans la modernité, et non en voyant en lui un pur amoureux du passé. Il prépare le seul grand saut en avant qui, à ses yeux, sauvera l’empire : le faire évoluer vers une monarchie constitutionnelle… quasiment un sacrilège pour Cixi et ses mandarins.
Cela vient profondément perturber les titulaires de charges aussi lucratives qu’inutiles lesquels se regroupent autour de l’impératrice Cixi qui somme son neveu l’empereur, de congédier ses conseillers ; celui-ci tente de la prendre de vitesse en demandant son arrestation, mais, trahi par un de ses généraux, déclaré faible d’esprit, il est interné à leng gong – le palais froid – une résidence à l’écart de la Cité interdite où étaient traditionnellement recluses les concubines en disgrâce. Quelques conseillers peuvent s’échapper, mais six d’entre eux sont décapités sans autre forme de procès. Kang Youwei parvient à s’exiler au Japon. Toutes les mesures des Cent Jours sont rapportées, mais pour moins longtemps que ne le pensent les conservateurs.
10 1898
Il a beaucoup plu sur toute l’Europe.

Quai Saint Bernard. Paris 5°.
11 12 1898
Le traité de Paris met fin au conflit hispano-américain à Cuba. La bataille n’avait pas été acharnée : les officiers espagnols avaient vendu les vivres et les équipements de leurs soldats : la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu’elle a et les pauvres soldats n’avaient plus rien, et surtout pas de courage.
Un gouvernement militaire d’occupation américaine est mis en place, qui durera jusqu’en 1902. Une merveilleuse petite guerre, dira le secrétaire d’État John Hay. Théodore Roosevelt, ministre-adjoint à la Marine, avait démissionné au début du conflit, pensant qu’il aurait plus à gagner à la tête d’une unité de cavalerie qu’il avait recruté dans l’ouest : les Rough Riders, qui se tailla un franc succès dans cette guerre, succès dont il bénéficia évidemment.
Aux Philippines, les anciens colonisateurs espagnols, n’avaient pas non plus reconnu leur indépendance : il les vendent aux États-Unis pour 20 millions $ , Guam et Porto Rico inclus ! Les Américains reprendront les Philippines par les armes que les Philippins déposeront deux ans plus tard. Mais en fait une guerre de guérilla se poursuivra jusqu’en 1913. On parle de 5 000 à 20 000 militaires philippins tués dans ce conflit mais surtout de 200 000 à 1 500 000 morts chez les civils !
Nous étions supposés les délivrer de la tyrannie espagnole afin qu’ils puissent mettre en place leur propre gouvernement et nous devions rester à proximité afin de vérifier qu’il avait toutes ses chances. Cela ne devait pas être un gouvernement conforme à nos idées mais un gouvernement qui représentait les sentiments de la majorité des Philippins, un gouvernement conforme aux idées philippines. Ce qui aurait été une mission digne des États-Unis. Mais maintenant – eh bien, nous avons mis notre doigt dans l’engrenage, dans un bourbier où à chaque nouveau pas il devient plus difficile encore de nous extirper (6 octobre 1900).
Je n’étais pas anti-impérialiste il y a un an. Je pensais qu’il était magnifique de donner beaucoup de liberté aux Philippins, mais je pense maintenant qu’il vaudrait mieux qu’ils se la donnent eux-mêmes. (15 octobre 1900).
[…] Nous avons pacifié des milliers d’insulaires et les avons enterrés. Nous avons détruit leurs champs, incendié leurs villages et expulsé leurs veuves et leurs enfants. Nous avons mécontenté quelques douzaines de patriotes désagréables en les exilant ; soumis la dizaine de millions qui restait par une bienveillante assimilation (pieux euphémisme pour parler des fusils). Nous avons acquis des parts dans les trois cents concubines et autres esclaves de notre partenaire en affaire, le sultan de Sulu, et finalement hissé notre drapeau protecteur sur ce butin. Et ainsi, par la providence de Dieu – l’expression est du gouvernement, non de moi – nous sommes une puissance mondiale.
Mark Twain. (1835-1910)
Les Philippines sont nôtres pour toujours… Et juste au-delà des Philippines sont les marchés illimités de la Chine. Nous ne nous retirerons ni des unes ni des autres. Notre plus grand commerce doit être avec l’Asie. Le Pacifique est notre océan. La Chine est notre client naturel… Les Philippines nous donnent une base au seuil de tout l’Extrême-Orient.
Beveridge, sénateur. Déclaration du parti impérialiste.
The White Man’s Burden
The United States and The Philippine Islands (1899)
Take up the White Man’s burden, Send forth the best ye breed
Go bind your sons to exile, to serve your captives’ need;
To wait in heavy harness, On fluttered folk and wild
Your new-caught, sullen peoples, Half-devil and half-child.
Take up the White Man’s burden, In patience to abide,
To veil the threat of terror And check the show of pride;
By open speech and simple, An hundred times made plain
To seek another’s profit, And work another’s gain.
Take up the White Man’s burden, No tawdry rule of kings,
But toil of serf and sweeper, The tale of common things.
The ports ye shall not enter, The roads ye shall not tread,
Go make them with your living, And mark them with your dead.
Take up the White Man’s burden And reap his old reward:
The blame of those ye better, The hate of those ye guard
The cry of hosts ye humour (Ah, slowly!) toward the light :
« Why brought he us from bondage, Our loved Egyptian night ? »
Take up the White Man’s burden, Ye dare not stoop to less
Nor call too loud on Freedom To cloak your weariness;
By all ye cry or whisper, By all ye leave or do,
The silent, sullen peoples Shall weigh your gods and you.
Take up the White Man’s burden, Have done with childish days—
The lightly proferred laurel, The easy, ungrudged praise.
Comes now, to search your manhood, through all the thankless years
Cold, edged with dear-bought wisdom, The judgment of your peers !
*****
O Blanc, reprends ton lourd fardeau :
Envoie au loin ta plus forte race,
Jette tes fils dans l’exil
Pour servir les besoins de tes captifs ;
Pour – lourdement équipé – veiller
Sur les races sauvages et agitées,
Sur vos peuples récemment conquis,
Mi-diables, mi-enfants.
O Blanc, reprends ton lourd fardeau :
Non pas quelque œuvre royale,
Mais un travail de serf, de tâcheron,
Un labeur commun et banal.
Les ports où nul ne t’invite,
La route où nul ne t’assiste,
Va, construis-les avec ta vie,
Marque-les de tes morts !
O Blanc, reprends ton lourd fardeau
Tes récompenses sont dérisoires
Le blâme de celui qui veut ton cadeau,
La haine de ceux-là que tu surveilles.
La foule des grondements funèbres
Que tu guides vers la lumière :
Pourquoi dissiper nos ténèbres,
Nous offrir la liberté ?
Rudyard Kipling. Le Fardeau de l’homme blanc, Poème, 1899
18 12 1898
Le comte Gaston de Chasseloup-Laubat établit le premier record du monde de vitesse terrestre en atteignant la vitesse de 63,15 km/h au volant d’une Jeantaud électrique, modèle Duc à Achères, dans les Yvelines. D’autres suivront : Blue Bird en 1935 avec 484 km/h pilotée par Malcolm Campbell, Blue Flame avec 1 074 km/h en 1970, avec aux manettes Gary Gabelish, Thrust SSC en 1997, avec 1 228 km/h, avec aux manettes Andy Green, Bloodhound SSC avec 1 609 km/h – 1 000 miles – avec aux manettes le même Andy Green, annoncé pour 2016… Les conquérants de l’inutile.
L’année suivante, Camille Jenatzy, un ingénieur belge, inventeur de la meilleure voiture du monde, aux dires de la Presse, la qualifiera lui-même de Jamais contente, bien qu’électrique et parvenant à 105.8 km/h. En fait c’était sa femme qui n’était jamais contente. Et pourtant, à l’aube du XX° siècle, le parc automobile américain était à 40 % à énergie électrique. Mais le pétrole, bon marché, abondant, se mettra à couler à flot des derricks américains et du Moyen-Orient, reléguant dans l’oubli la fée électricité.
c’est vrai qu’elle a pas l’air contente

Celle-là, elle a l’air contente, donc ce n’est pas sa femme, c’est la chanteuse et actrice Florelle.
L’automobile n’est pas née avec un moteur à essence sous le capot. Avant de s’en remettre quasi exclusivement à la technologie de la combustion interne, les constructeurs ont mis à l’épreuve d’autres options. Le premier vrai véhicule routier est animé par une chaudière à charbon. L’Obéissante, lancée en 1873 par Amédée Bollée, un fondeur de cloches installé au Mans, ressemble à une diligence à vapeur. Elle pèse 4,8 tonnes et peut transporter douze personnes, est autorisée à circuler dans Paris, mais ne sera produite qu’à un unique exemplaire. Dans la dernière décennie du XIX° siècle émergent d’autres pistes beaucoup plus prometteuses : le moteur à explosion, perfectionné par Daimler en 1883 et adopté par Panhard Levassor, mais aussi la traction électrique. L’invention de la batterie rechargeable au plomb acide par Gaston Planté stimule l’imagination des ingénieurs. Elle permet de produire des véhicules lourds mais faciles à démarrer, techniquement plus simples et donc plus fiables que ceux utilisant des moteurs à pétrole. Accessoirement, on apprécie qu’ils soient silencieux et n’empestent pas autour d’eux. Pour l’heure, la notion de voiture propre s’en tient à ce genre de considérations. C’est surtout aux États Unis que l’on s’intéresse à l’électrique. A Cleveland (Ohio), Baker Electrics, qui équipe ses automobiles d’une batterie conçue par Thomas Edison, s’engage avec quelque succès dans la production industrielle. D’autres se lancent : Morrison, Ryker, Anderson, ou encore Columbia dont l’Electric Coach embarque une batterie de 44 cellules délivrant une puissance de 1,49 kW (2 chevaux vapeur) pour une autonomie de 48 kilomètres. En 1897, on installe une flottille de taxis tout électriques à New York. Ces modèles se posent comme une alternative au moteur à combustion interne et leur diffusion n’a rien de marginal. Outre Atlantique, on estime qu’entre 1900 et 1910, les voitures électriques pèsent un bon tiers du marché automobile naissant.
En Europe aussi l’issue de la bataille va, un temps, rester incertaine. Les tenants de l’électrique, conscients que la dimension spectaculaire du moteur à pétrole leur fait défaut, investissent le champ de la performance. En 1899, le Belge Camille Jenatzy est le premier à dépasser le seuil des 100 km/h. L’exploit à lieu à Achères, à l’ouest de Paris, à bord de la Jamais Contente (ainsi dénommée, dit-on, en référence à l’épouse du pilote). Une espèce de torpille montée de pneus Michelin, dotée de deux moteurs électriques, qui atteint la vitesse inouïe de 105,9 km/h. La même année, l’Automobile Club de France récompense une inédite colonne de charge pour automobile électrique, ancêtre des stations de recharge qui fonctionne avec des jetons. Pourtant, il est déjà trop tard.
Dès les premières années du XX° siècle, la cause est entendue. Trop pesante, trop chère et incapable de suivre le train d’enfer imposé par les améliorations apportées au moteur à combustion interne (rapidement équipé d’un très utile démarreur… électrique), la voiture à Watts est progressivement envoyée aux oubliettes. La Ford T, apparue en 1908 et qui sera fabriquée à plus de 16 millions d’unités jusqu’en 1927, consacre l’hégémonie absolue des modèles alimentés aux hydrocarbures. Une domination sans partage qui perdure depuis plus d’un siècle et dont la remise en cause apparaît encore balbutiante. Repartie à la conquête de l’automobile, la solution de l’électrique connaîtra-t-elle un nouveau feu de paille ? Pas forcément. Deux raisons plaident en sa faveur : la prise de conscience environnementale fait désormais peser, par le biais des normes antipollution, une très forte pression sur les constructeurs et la technologie de la voiture propre, outre qu’elle a progressé, s’est aussi diversifiée.
Jean-Michel Normand. Le Monde du 4 09 2019
24 12 1898
Louis Renault a 21 ans : il va réveillonner à Montmartre au volant de la Voiturette qu’il a assemblée dans son atelier de Billancourt. Au petit matin, il a 12 commandes : c’est le début d’une grande aventure industrielle.
1898
Aux élections législatives à Narbonne, dans la circonscription du Dr Ferroul, maire de la ville et candidat à la députation, le nombre de suffrages se trouve être supérieur à celui des votants : il perdra les élections au second tour. Mais une aussi banale fraude n’était pas à même de déboulonner pareil notable.
Emmanuel Laurens, jeune bourgeois de la ville d’Agde, étudiant en médecine a hérité un an plus tôt, d’un lointain cousin une colossale fortune – des terres, des entreprises, des rentes, un quai au port de Marseille, des magasins en Afrique et à Ceylan, l’équivalent de 350 millions € -. Il s’est mis à voyager quand la mort de son père le ramène à Agde, héritant du domaine de Belle Îsle, entre l’Hérault, le canal du Midi et le chemin de fer, construit quelques années plus tôt. Il entreprend d’y construire le château de Belle Isle que les Agathois préféreront nommer Château Laurens : beaucoup plus qu’architecte, il endossa les habits d’un décorateur à qui l’on demande de construire un pavillon sur l’ensemble des arts à la mode pour une exposition universelle : c’est un patchwork que l’on peut, si l’on tient à classer, mettre dans le tiroir Art Nouveau, une résultante d’un goût certain pour la mise en œuvre des techniques les plus récentes : béton armé, électricité, chauffage par le sol… Indépendamment de la participation de nombreux artistes connus d’alors, l’ensemble est d’un orientalisme prononcé, au sein duquel il ne fait preuve d’aucune répulsion pour le faux : les charpentes ne sont qu’un décor, sans toiture à supporter, les cheminées sont fausses, sans conduit, les défenses d’éléphant porteuses de lampes dans la chambre de musique sont fausses elles aussi etc etc… Une construction tout à côté de la voie ferrée ? L’idée n’est incongrue que pour nous avec nos perceptions d’aujourd’hui : à cette époque c’est le progrès que l’on portait au pinacle, c’était lui qui allait libérer l’ensemble de la population de l’ insupportable pollution qu’est le crottin de cheval.
Il y mènera grande vie jusqu’à la crise de 1929 qui le mettra presque sur la paille. Il vendra le tout en viager à des gens qui n’avaient pas l’argent pour entretenir pareil château… qui sera pratiquement laissé à l’abandon, le tout aggravé par l’occupation allemande de 1942 à 1945. Racheté par la ville d’Agde en 1994, les collectivités locales mettront sur la table 3 millions € pour une très belle restauration, récupérant du mieux possible le mobilier qu’Emmanuel Laurens avait vendu pour assurer le quotidien et le Château Laurens ouvrira ses portes au public en 2023.


La première loi sur les accidents de travail crée un droit à la réparation à la charge de l’employeur.
Premier salon de l’automobile à Paris : il lui manque encore une boite de vitesse qui arrivera en 1899 chez Panhard, un démarreur électrique, en 1905, des amortisseurs, en 1906, un éclairage électrique, en 1912, un klaxon en 1913.
Maurice Leblanc chante la Petite Reine dans Voici des ailes : Nous avons des ailes, Madeleine ! N’est-ce pas que vous avez comme moi cette vision affolante que l’homme a des ailes maintenant ? Qu’il les ouvre donc toutes grandes, et qu’il vole enfin puisqu’il lui est permis de ne plus ramper. Voici des ailes qui nous poussent, encore inhabiles et imparfaites, mais des ailes tout de même. C’est l’ébauche qui s’améliorera jusqu’au jour où nous planerons dans les airs comme de grands oiseaux tranquilles.
Emile Zola célèbre les délices que de s’en aller ainsi, d’un vol d’hirondelle qui rase le sol.
Au large des côtes canadiennes le naufrage de La Bourgogne fait 500 morts.
Eugène Ducretet et Ernest Roger réalisent la première liaison mondiale sans fil entre la Tour Eiffel et le Panthéon. Le train arrive au Fayet, en aval de Chamonix.
Face aux États-Unis, l’Espagne a perdu Cuba et s’affaiblit ; la Catalogne et le Pays Basque demandent leur autonomie. Le mouvement anarchiste se développe en même temps que la pauvreté.
Les Américains étaient majoritaires depuis un certain temps à Hawaï, ils détenaient tous les leviers, avaient proclamé une république blanche en 1893-1894 sous l’autorité de Sanford B. Dole missionnaire et fermier : ils déposent le roi polynésien et l’île devient américaine.
C’est d’un poids énorme que les États-Unis vont peser de plus en plus sur les destinées du monde… La richesse et la puissance des États-Unis sont un quart de la richesse et de la puissance du globe.
[…] Briser les nations, ce serait renverser les foyers de lumière…Ce serait supprimer aussi les centres d’action distincte et rapide, pour ne plus laisser subsister que l’incohérente lenteur de l’effort universel. Ou plutôt, ce serait supprimer toute liberté, car l’humanité, ne condensant plus son action en nations autonomes, demanderait l’unité à un vaste despotisme asiatique.
Jean Jaurès
À la base de cette puissance américaine, il y aura un fantastique effort de scolarisation de la jeunesse : C’est bien aux Etats-Unis qu’eut lieu, entre 1900 et 1940, le premier développement de masse de l’éducation secondaire, c’est-à-dire d’un enseignement allant au-delà de l’apprentissage de la lecture et de la capacité de compter. Et c’est alors que l’Amérique prit la tête du développement mondial. Le taux d’enrôlement dans le secondaire (high school) n’y était encore que de 10 % vers 1900 ; il atteindra 70 % vers 1940. Le taux d’obtention du diplôme de fin d’études était passé entre ces deux dates de 6 % à 50 %. (…) Lorsque l’Amérique entrera en guerre en 1941, la moitié de ses jeunes auront déjà bénéficié d’une éducation secondaire complète.
Emmanuel Todd. Le Monde 1 09 2017
Deux ans plus tôt, les Jeux Olympiques d’Athènes ont bien participé à agrandir le trou des finances publiques de la Grèce, qui se retrouve mise sous tutelle par la Commission financière internationale : elle s’installe à Athènes et prend le contrôle d’une large partie du budget grec, dès lors consacré au remboursement de la dette : droits de douanes perçus dans les principaux ports du pays, revenus issus des monopoles d’État sur la vente de kérosène, sel, papier à cigarettes. Le gouvernement n’a pas le droit de modifier l’usage de ces recettes ni la fiscalité sans accord de la commission.
Celle-ci reste à Athènes jusqu’en 1936 – et n’empêche pas un nouveau défaut de paiement en 1932, à la suite de la crise de 1929. Son bilan est malgré tout loin d’être négatif : elle aide la jeune Grèce à prendre le contrôle de ses recettes fiscales et limite le détournement des capitaux étrangers par l’élite locale. Elle contribue également à l’instauration de réformes indispensables à la modernisation du pays, comme la création de l’impôt sur le revenu. Mais son ingérence ne sera jamais totalement acceptée par les gouvernements successifs.
Marie Charrel. Le Monde 14 juillet 2015
Le sous-marin Argonaut, conçu par l’américain Lake, effectue le premier grand voyage sous l’eau, recevant les félicitations de Jules Verne (20 000 lieux sous les mers a été écrit en 1869)
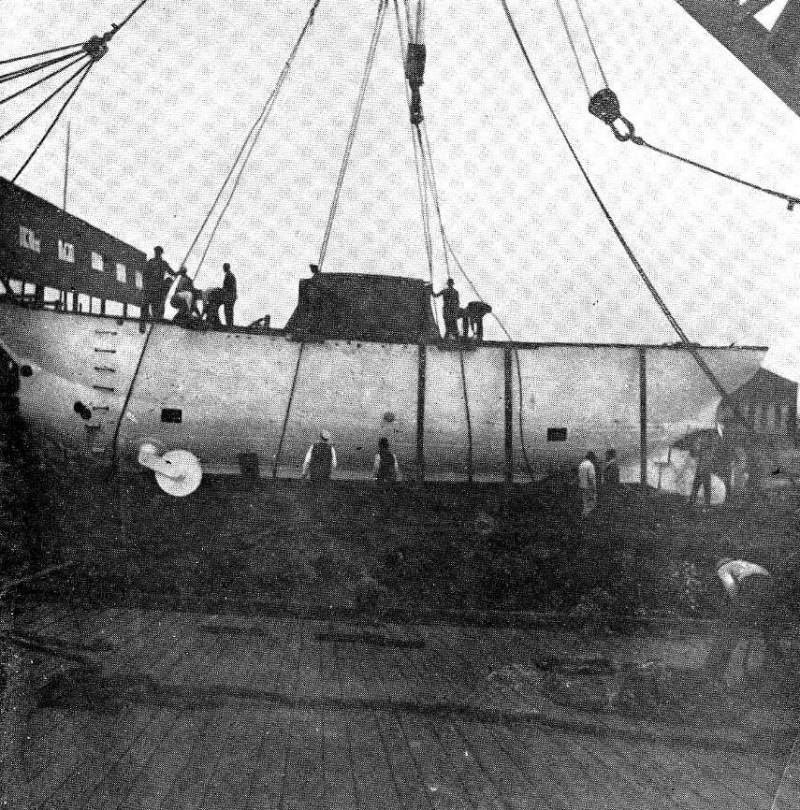
Argonaut II sous-marin en construction. Vous pouvez voir la propulsion des roues et la superstructure légère sous la forme d’un bateau. Photo Navsource.org
Guillaume II, empereur d’Allemagne, se lance dans une très ambitieuse entreprise de séduction au Moyen Orient, s’y faisant passer pour le nouveau protecteur des chrétiens, ce qui, bien sur, rend furieux Français et Russes. Il voyage en train, en bateau, à cheval, va en pèlerinage à Jérusalem, y fait reconstruire en partie la mosquée, en fait autant pour celle de Damas, brûlée en 1893, retrouve le tombeau de Saladin, campe dans les ruines de Baalbek. La maison Krupp entreprend la construction d’un chemin de fer Bagdad-Berlin : le Bagdadbahn. Et surtout, il confie à un architecte, Robert Koldewey, la direction des fouilles de Babylone, lequel s’entourera d’architectes qui, contrairement aux archéologues classiques, sauront lire la brique, base indispensable pour travailler sur les ruines de Babylone. Les fouilles seront bien faites, bien relevées, sans interruption de 1899 à 1917.
Susie Carson Rijnhart, médecin de l’Ontario (Canada) et son mari Petrus Rijnhart, missionnaire hollandais, sont installés depuis 3 ans à Huanggyuan, à l’est du lac Koko Nor, sud du désert de Gobi. Ils tiennent un dispensaire attaché au grand monastère de Kumbum, où s’ajoutent aux maladies habituelles, variole, diphtérie, les blessés du soulèvement musulman qui a troublé la région en 1894. Ils parlent déjà le chinois, le tibétain et apprennent le mongol. Ils montent une expédition pour Lhassa, quittant Tankar, leur dernier domicile le 20 mai 1898, emmenant leur petit Charlie qui n’a pas encore un an, leur chien Topsy, 3 hommes, dont un guide, 5 animaux de selle et 12 bêtes de somme ; ils ont pris de la nourriture pour deux ans. Les malheurs et les drames se succédèrent alors en cascade : le premier, le pire, la mort de leur enfant, dont les poumons n’ont probablement pas supporté l’altitude, dont la moyenne flirte avec les 5 000 m. ; deux guides s’enfuient avec une partie des vivres, des voleurs les délestent de 5 bêtes. À Nagpu, les autorités leur interdisent de poursuivre, et leur fournissent une escorte pour les mener à Ta Chien Lu, en Chine, dans le Si Chuan. L’escorte les abandonne et ils se retrouvent avec quantité de bagages sans animal pour les transporter ; ils abandonnent donc leur bagages et poursuivent à pied, cherchant à atteindre le monastère de Tashi Gompa, rive gauche de la Za Qu [nom du cours supérieur du Mékong] ; Petrus se met à longer la rive pour chercher un passage – gué ou pont – : Susie ne le reverra jamais plus. Elle découvrira que sur la même rive se trouve un campement qui leur était masqué par une crête, occupé probablement par les bandits qui leur avaient volé les chevaux. Voyant arriver Petrus, ils ont pris peur et s’en sont probablement débarrassé en le jetant dans la rivière. Elle va marcher seule, deux mois durant, se défendant des voleurs, de la faim, de l’épuisement, pour atteindre finalement Ta Chien Lu où elle a l’adresse d’une mission protestante. Deux hommes sont dans la cour : Comme ils avaient l’air impeccable dans leurs costumes chinois, et comme leurs visages étaient pâles ! Je savais que je n’étais pas très propre, j’avais bien conscience de mes haillons et de ma saleté, et je suis restée ainsi, en leur présence, attendant qu’on m’adresse la parole. Mais non, il fallait que je parle la première. J’ai donc dit, en anglais : Suis-je chez Monsieur Turner ? Et Monsieur Moyse me répondit : Oui.
Susie attendit en vain, pendant six mois, des nouvelles de Petrus, puis repartit au Canada, revint à Ta Chien Lu en 1902, épousa le docteur James Moyes en 1905, donna naissance à un autre garçon et mourut trois semaines plus tard. L’histoire sera moins médiatisée que le fameux : Dr Livingstone, I Presume ? de Stanley, et pourtant elle aussi fit preuve d’une époustouflante rage de vivre.
En Égypte, à l’initiative de l’occupant anglais, construction du premier barrage d’Assouan : il sera terminé quatre ans plus tard. Édifié en aval de la première cataracte, – la supprimant donc par noyade – il sera exhaussé entre 1907-1912, et à nouveau en 1929-1934, tout cela pour accroître et irriguer le coton. En amont d’Assouan, l’île de Philæ offre un ensemble de temples dédiés à Isis et de monuments dont les plus anciens remontent au IV° siècle av. J.C. La construction de ce barrage submergera en partie ces édifices, qui ne réapparaîtront que 2 mois par an – août et septembre -, lorsqu’on videra le réservoir. Ce n’était pas le premier barrage sur le Nil : Muhammad Ali avait fait construire un barrage dès 1835 en aval du Caire ; avaient suivi ceux d’Asyut, de Nag Hamamdi et d’Esna.
01 1899
La France a perdu l’occupation de la vallée du Nil au profit de l’Angleterre, et l’humiliation de Fachoda attise le désir d’agrandir l’empire colonial là où cela se peut encore : l’unification de l’empire français en Afrique de l’Ouest est décidée, et cela passe par la conquête du Tchad. Par l’ouest, c’est à dire par le bassin du fleuve Niger, la mission est confiée aux capitaines Voulet et Chanoine. Ce n’était pas une petite affaire : 1 700 personnes qui demandaient 30 m³ d’eau par jour, et bien sur la nourriture en quantité suffisante. Or les deux officiers avaient sous-estimé ces besoins, et pour avoir de l’eau, s’orientèrent vers le sud, en zone anglaise dans le secteur de la rivière Sokoto. Très rapidement les deux capitaines vont se mettre à agir pour leur propre compte : le chef de Birni N’koni refuse de ravitailler la colonne et Voulet donne l’assaut et se livre à un massacre : incendies, viols, décapitations vont bon train. Le lieutenant Peteau qui s’en indigne est relevé de ses fonctions et renvoyé sur Tombouctou. Mais, très rapidement ceux-ci vont se mettre à agir pour leur propre compte, massacrant, à la tête de leurs troupes noires, les populations rencontrées. Chanoine écrit à son père, ministre de la Défense : Trêve de diplomatie et de conciliation avec ces barbares qui ne comprennent que la force. […] Il ne faut pas hésiter à imposer des corvées aux habitants, à les forcer enfin à travailler.
D’autres informations plus proches de la réalité alertent Paris et fin avril, le colonel Arsène Klobb, en poste à Tombouctou (à proximité du fleuve Niger, dans sa boucle nord, aujourd’hui au Mali) se lance à leur poursuite à travers le désert avec mission de les arrêter. Il les rejoint après avoir parcouru 2 000 kilomètres, le 14 juillet, aux portes de Zinder – actuellement au Niger – : Voulet fait ouvrir le feu : Klobb est tué. Ses troupes noires refuseront d’aller au-delà dans la folie, elles tueront Chanoine le 16 juillet et Voulet le 17, près du village de Maygiri. Mais, poursuivie sous le commandement de Joaland et de Meynier, la mission fera sa jonction avec les missions Foureau-Lamy et Gentil au Tchad le 11 avril 1900.

Klobb tué par les troupes de Voulet. Couverture illustrée du journal Corriere Illustrato della Domenica, Milan, 3 septembre 1899.
Des chercheurs d’or dans le désert du Taklamakane, entre le désert de Gobi à l’est et les régions musulmanes de la Russie à l’ouest, découvrent dans un stupa – monument bouddhique – proche de Koucha, sur la bordure nord de ce désert, un manuscrit de 55 feuilles d’écorce de bouleau : il s’agit de sept textes de médecine et de nécromancie en sanskrit écrit dans l’un des plus vieux alphabets de l’Inde, le brahmi, utilisé à l’époque de Bouddha : au tout début de notre ère existait donc une civilisation bouddhique florissante en ces régions qui seront islamisés à partir du IX° siècle.
16 02 1899
Félix Faure, président de la République, souffre de tachycardie violente à la moindre émotion. Dès le matin, au cours du conseil qu’il avait présidé, il avait donné des signes de fatigue et de nervosité. Dans l’après-midi, il reçoit Mgr Richard qui témoignera: Je fus frappé par l’état de surexcitation anormale dans lequel il se trouvait. Vers 16 heures, il reçoit la visite inopinée du prince Albert 1° de Monaco : dreyfusard convaincu, celui-ci serait venu plaider la révision du procès après une entrevue avec l’empereur Guillaume II, proposant à Félix Faure d’organiser une rencontre avec l’empereur d’Allemagne, ce dernier venant lui donner l’assurance de l’innocence de Dreyfus ! Il est vrai qu’il y a de quoi piquer une rogne. Il va se débarrasser presto du prince de Monaco, puis va retrouver Marguerite Steinheil dans le petit salon bleu, avec sortie dérobée. Mais se rendant compte que ce jour là était un jour où Cupidon s’en fout, il alla s’allonger sur le canapé de son bureau, où le rejoignirent sa femme, sa fille Lucie, ses fidèles et le docteur Humbert. De nombreux et éminents professeurs d’université suivirent qui ne purent que constater l’état désespéré du malade puis sa mort.
Donc exit la version grand public selon laquelle il aurait été victime de drogues virilisantes, fournies par sa maîtresse Marguerite Steinheil, dite Meg -, dans les bras de laquelle il serait mort. On peut à la rigueur estimer véridique l’histoire du prêtre qui arrive rapidement sur les lieux et demande au planton de l’Elysée :
Le président a-t-il encore sa connaissance ?
Non, répond le planton, elle est partie par l’escalier.
Mais tout le reste n’est que bobards frivoles lancées par une presse sachant que ses lecteurs vont en faire leur miel : mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose, avait lancé Voltaire.
Clemenceau enfoncera le clou : Félix Faure vient de mourir. Cela ne fait pas un homme de moins en France… en entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui !
La presse enchaînera ; pour elle : Pompe funèbre, pour lui : Il voulait être César, il est mort Pompée… pour Gil Blas, plus digne, Félix Faure a disparu en pleine santé par le fait de l’excès de santé.
5 03 1899
La plus ancienne poudrière de l’Arsenal de Toulon, construite sous Louis XIV explose, dégageant un immense nuage de fumée noire et fétide ; on entendra le vacarme jusqu’à Barcelonnette ! Dans ses magasins étaient stockés les deux types de charges en usage à la fin du XIX° siècle : l’antique poudre noire ou poudre à canon (environ 100 tonnes), et l’innovante poudre B, dite poudre sans fumée, inventée 15 ans plus tôt par l’ingénieur Paul Vieille (environ 80 tonnes). Des substances non altérées et considérées stables par les analystes et la hiérarchie militaire.
Ce fut la ruine dans un rayon de trois kilomètres autour de la poudrière. Outre un village détruit [Lagoubran], une vie économique réduite à néant, les effets de l’explosion ont été tels que des blocs de pierre furent projetés. Le Petit Var du 6 mars 1899 donne l’exemple d’un bloc de 200 kilos retrouvé à 2 kilomètres de l’endroit de l’explosion. Également, autre fait frappant : l’eau du canal qui entourait la poudrière a débordé sur la route de la Seyne en raison du souffle de l’explosion. Les routes furent recouvertes de débris. De l’arsenal principal de Toulon à la poudrière, la route fut jonchée de pierres, il en va de même pour la route conduisant à la Seyne qui est bordée d’immeubles détruits et jonchée de blocs de pierre.
On dénombre 55 morts. Des souscriptions sont ouvertes pour venir en aide aux familles et à la commune sinistrées.
L’émotion produite par l’explosion de Lagoubran n’est pas prête de se calmer. La catastrophe est lamentable. Nous espérons bien que l’on va soumettre à un examen attentif toutes nos poudrières. Il en est encore quelques-unes, peut-être, qu’il faudra déplacer. La leçon est dure, mais il faut qu’elle nous profite. Le magasin à poudre de la marine de Lagoubran situé entre la Seyne et Toulon avait été réfectionné en 1884 ; on l’avait construit loin de toute agglomération ; peu à peu, des maisons se sont élevées dans son voisinage et le mal a été précisément de laisser bâtir dans la zone dangereuse. On est d’habitude plus sévère. Une enquête rapide devra éclairer le pays sur les poudrières qui pourraient offrir des dangers. La cause de l’explosion est et restera sans doute indéterminée. Nos poudres jouissent cependant d’une stabilité plus grande qu’on ne le pense généralement. Mais enfin, il est certain, malheureusement, que les explosions sans cause apparente se sont produites à plusieurs reprises. Ce qui est survenu peut donc se produire encore. Et l’on ne saurait trop multiplier les précautions.
La Nature, revue des sciences et de leurs applications aux arts et à l’industrie.
Trois enquêtes seront diligentées. La première vise à établir les causes techniques de la catastrophe. Elle est déléguée à un militaire de haut rang, directeur de l’artillerie au ministère de la Marine. Résultats : l’explosion ne peut pas venir d’une imprudence des techniciens de la poudrière, ni d’une combustion spontanée. La Grande muette, jamais responsable de quoi que ce soit, as usual, réfute ainsi toute responsabilité et émet l’hypothèse d’un acte criminel. La seconde enquête est d’ordre judiciaire et confiée au préfet maritime. Pour lui, ni responsabilité humaine ni acte criminel : plutôt une combustion spontanée. Enfin, une commission postérieure sera chargée de revenir sur l’origine du drame. Parmi les experts : Paul Vieille, inventeur de la fameuse poudre B. Une étude supplémentaire pour pas grand-chose, sans conclusion affirmée… Malgré les témoignages d’un ouvrier et d’un garde, selon lesquels, quelques mois avant le désastre, deux caisses contenant de la poudre B ont été noyées car elles dégageaient des vapeurs rougeâtres. Un rapport a dû informer les chefs, mais ils n’ont rien fait. Il faudra attendre huit ans et une nouvelle catastrophe, l’explosion du cuirassé Iena en carénage au bassin de Missiessy, pour qu’on remette la responsabilité de la poudre B sur le tapis.
10 03 1899
Création du Certificat de capacité valable pour la conduite d’automobiles à pétrole : il deviendra le Permis de conduire en 1920. Jusque là, seule la préfecture de Paris avait réglementé la conduite d’un automobile. (le nom se féminisera en 1901).
22 06 1899
Pierre Waldeck Rousseau, républicain modéré, constitue un gouvernement de défense républicaine.
Il y fit entrer non seulement ses amis modérés et leurs frères ennemis radicaux mais aussi deux personnalités aussi clivantes qu’incompatibles : d’un côté, le général et marquis Gaston de Galliffet (1831-1909), honni par la gauche pour avoir joué un rôle majeur dans la répression de la Commune ; de l’autre, Alexandre Millerand (1859-1943), proche de Jean Jaurès, qui devint ainsi le premier ministre socialiste de notre histoire. Sa présence dans un gouvernement bourgeois, et qui plus est aux côtés du massacreur des communards, suscita l’indignation des socialistes les plus extrêmes, notamment de Jules Guesde (1845-1922), qui considérait ce ralliement comme une trahison.
Jaurès, au contraire, approuva cette démarche, considérant que l’urgence était au maintien de l’ordre face à la menace que l’extrême droite antidreyfusarde faisait peser sur la République. L’histoire lui donna raison car le gouvernement de défense républicaine, appuyé sur l’autorité militaire de Galliffet, mit non seulement fin à la crise politique née de l’affaire Dreyfus mais battit ensuite le record de longévité d’un gouvernement sous la III° République, permettant au passage à Millerand, ministre du commerce et de l’industrie, de faire voter plusieurs lois sociales qui marquaient l’inflexion vers la gauche de la politique française.
Jean Garrigues Le Monde du 16 juillet 2024
1 07 1899
La FIAT n’est pas encore née, mais cela ne va pas tarder : le comte Emanuele Cacherano di Bricherasio, est un passionné de la machina : quatre ans plus tôt il a organisé la première course automobile d’Italie : Turin-Asti-Turin, puis, en 1898 le premier Salon consacré, dans le pays, aux véhicules à moteur et l’Automobile Club de Turin. La même année, il finance la création d’une société, Ceirano ; un premier modèle sort des ateliers l’année d’après. Le succès est inespéré, les commandes excèdent largement les capacités du petit atelier. Le patron, Giovanni Battista Ceirano, semble dépassé. Le comte Cacherano réunit alors plusieurs notables turinois avec l’idée de créer un grand constructeur automobile italien.
11 07 1899
Giovanni Agnelli rejoint ce groupe pour signer les statuts de la Società Anonima Fabbrica Italiana Automobili Torino, acte de naissance de Fiat.
Giovanni Agnelli n’est pas un novice ; il commercialise depuis trois ans des tricycles français, de la marque Prunello, équipés d’un moteur De Dion-Bouton. Plutôt que de partir vers l’inconnu, la société rachète les brevets de Ceirano et reprend son personnel. La production peut démarrer. C’est un triomphe. En 1900, les 120 salariés produisent 24 voitures. Trois ans après, 500 ouvriers en fabriquent 150. À la tête de Fiat en 1902, il se révélera un redoutable dirigeant.
Comme nombre de ses rivaux européens, Fiat bénéficie aussi des commandes militaires de l’État pendant le premier conflit mondial. L’Allemagne est également un partenaire commercial important. La firme turinoise dépend fortement de la Banca Commerciale, un établissement contrôlé… par des capitaux allemands. L’Italie est certes neutre, mais Rome pèse en faveur d’une intervention militaire du côté des Alliés. En 1915, la France commande à Fiat des véhicules de transport de troupes. La perspective de juteux profits va faire changer d’avis M. Agnelli : il parviendra à se passer des services de la Banca Commerciale.
Résumé de Jacques-Marie Vaslin. Le Monde du 8 mars 2014

1899 Fiat 3 ½ HP ©Stellantis Le premier modèle de Fiat était suspendu à des ressorts à lames doubles sur tout le pourtour et fabriqué par le carrossier Marcello Alessio. D’un poids étonnamment élevé de 680 kg, la Fiat était propulsée par un moteur à deux cylindres en ligne de 0,7 litre, qui lui permettait d’atteindre une vitesse de pointe de 34 km/h. Sur les 26 voitures produites, quatre subsistent aujourd’hui.

1912 Fiat Zero ©Brightwells La Zero a été la première Fiat à être fabriquée en grand nombre, avec plus de 2000 voitures produites à l’usine de Turin. Presque toutes les Zéro avaient une carrosserie à quatre places, bien que quelques versions à deux places aient été construites par Farina. Propulsée par un moteur à quatre soupapes en ligne de 1,8 litre, la Zero pouvait atteindre une vitesse maximale de 80 km/h.
12 08 1899
Fort Chabrol en pleine affaire Dreyfus.
On est au cœur des passions dans l’affaire Dreyfus : le 3 juin précédant les cours de cassation avaient cassé le 1° jugement de Dreyfus de 1894, renvoyant le procès devant le conseil de guerre de Rennes : les conséquences avaient été immédiates : Zola, exilé en Angleterre, était revenu en France, Picquart libéré, et Mercier, accusé de communication illégale de pièces ; et surtout, Dreyfus avait quitté l’île du Diable pour débarquer à Port Haliguen à Quiberon le 30 juin. Le procès en révision s’était ouvert cinq jours plus tôt, le 7 août.
Le camp des antidreyfusards s’agite comme jamais : Pierre Waldeck Rousseau, président du conseil estime qu’il y a complot contre la sureté de l’État et fait arrêter Paul Déroulède, les dirigeants de la Ligue des Patriotes, les chefs des Jeunesses royalistes et de la Ligue antisémite ; Mais Jules Guérin, président de la Ligue antisémite et directeur de l’Antijuif, refuse d’obtempérer et se retranche dans ce qu’il nomme Le grand Occident de France, au 51, rue de Chabrol, à Paris. Assiégé, l’immeuble sera ravitaillé par les toits depuis un logement au 114, rue Lafayette. Les insurgés se rendront le 20 septembre, après 38 jours de résistance. Le Sénat se constituera en Haute Cour de justice pour juger Déroulède, Guérin et 65 de leurs partisans, accusés de complot contre la sûreté de l’État. Le 20 août 1899 de violentes bagarres éclateront entre antisémites et révolutionnaires, aux abords de fort Chabrol. Tous seront refoulés par la police… des anarchistes saccageront l’église Saint Joseph. Déroulède et André Buffet seront condamnés à dix ans de bannissement, Eugène de Lur-Saluces à cinq ans de bannissement, Guérin à dix ans de détention. Tous les autres accusés seront acquittés.
9 09 1899
À Rennes, lors de son second procès, dans une atmosphère passionnée, Dreyfus est condamné à 10 ans de déportation : il sera gracié par le président Loubet le 19 09, mais non réhabilité et la campagne pour sa réhabilitation continuera. Georges Méliès lui consacre un film, et Roman Polanski aussi, en 2019 : J’accuse, avec, au cœur de l’affaire un commandant Picquart, joué par Jean Dujardin, auquel il donne une place sans doute un peu plus importante que celle qu’il a eu dans la réalité.
Afin de marquer publiquement son engagement, Sarah Bernhardt décide, après avoir signé la protestation en faveur de Picquart (3e liste), au moment du procès de Rennes, de ne pas donner la représentation prévue à Rennes, montrant ainsi clairement sa position et aussi son refus de risquer de créer une diversion. Comme le souligne Jules Claretie : C’est très beau ce qu’elle fait là ; elle perd une fort belle recette, et une ovation certaine. (Chincholle. La journée de Rennes, le Figaro, 18 août).
15 09 1899
Rouen s’offre le deuxième pont transbordeur d’Europe, après celui de Portugalete, au Portugal. Elle le doit à Ferdinand Arnodin, brillant ingénieur mais piètre gestionnaire : il avait établi la gratuité du passage. Il sera très utile pendant la I° guerre mondiale, puis à la seconde, le 9 juin 1940, l’armée française le fera sauter, sans prévenir personne, et surtout pas le remorqueur Houdon, qui passait dessous, qui coula en emportant ses passagers-réfugiés par le fond !

21 09 1899
Cixi, la vieille impératrice douairière de Chine, ne se berce pas d’illusions sur les motivations des pays étrangers présents en Chine : Les différentes Puissances jettent sur nous un regard de tigre, d’une voracité qui enfièvre les unes et les autres.
9 10 1899
Le président Boer du Transvaal, Paul Krüger, exige que les troupes anglaises se retirent des frontières de son pays ; l’affaire avait commencé en décembre 1895 par un raid qui avait les apparences d’une initiative privée du Dr Leander Starr Jameson, et qui avait rapidement tourné au fiasco ; cet ultimatum est en fait une déclaration de guerre : les Anglais vont s’engager massivement : jusqu’à 450 000 hommes, trouvant en face d’eux des forces beaucoup mieux organisées et armées qu’ils ne l’avaient prévu – très souvent les armes sont françaises -: à leur tête, le vieux général Piet Joubert qui ne saura pas bien exploiter sa victoire, en cherchant à réduire les poches anglaises plutôt que de foncer sur l’océan indien pour s’y emparer de Durban. Les Boers compteront 22 000 morts dans leurs rangs. Nombre d’étrangers viendront combattre l’Anglais aux cotés des Boers : Français, Irlandais, Allemands, Russes… Winston Churchill est envoyé par le Morning Post pour couvrir l’événement : fait prisonnier par les Boers, il s’échappe et fait près de 500 km avant d’arriver en territoire ami. Les Anglais finiront par l’emporter, – paix du 31 mai 1902 à Vereeniging – : ils avaient envoyé des renforts très importants, et aussi parce qu’ils avaient obtenu de l’Allemagne qu’elle retire son soutien à Krüger. Les Boers n’avaient pas l’expérience d’une guerre moderne : déplacement coordonné de lourdes unités, utilisation rationnelle de l’artillerie, le tout mis en œuvre par un nouveau commandant en chef anglais : le général Horatio Kitchener. Puis les jeunes Boers déjouèrent la stratégie anglaise qui finit par pratiquer la politique de la terre brûlée : villages rasés, fermes incendiées, civils enfermés dans des camps dans des conditions telles que la mortalité infantile atteignit 80 % : rougeole, dysenterie, furonculose, pneumonie, bronchite, coqueluche. Les Anglais auront perdu 22 000 hommes et dépensé 222 millions £.
Les Boers avaient tout perdu, leurs pays – l’État libre d’Orange et le Transvaal – leur biens, leur liberté : ils migrèrent alors vers les villes où ils se retrouvèrent sur le marché du travail en concurrence avec les Noirs, mineurs dans les grandes entreprises. Pour survivre ils imposèrent de haute lutte aux magnats des mines – les Randlords – les premières lois racistes, le Colour Bar, qui réservaient les emplois qualifiés aux seuls Blancs : c’est là qu’il faut chercher l’origine de l’apartheid.
30 10 1899
Maurice Barrès tient à mettre ses lecteurs au courant du grand danger que court la France : démographie en baisse et immigration en hausse. Philippe de Villiers et Marine Le Pen n’ont rien inventé : Ceux qui ont un peu réfléchi sur l’évolution des nationalités et qui savent que tous les peuples ont leurs jours comptés et se rendront bien compte du germe de destruction que notre nation porte en soi. Le décroissement de notre natalité, l’épuisement de notre énergie depuis cent ans que nos compatriotes les plus actifs se sont détruits dans les guerres et les révolutions ont amené l’envahissement de notre territoire et de notre sang par des éléments étrangers qui travaillent à nous soumettre Jadis, nous vivions sous la direction d’idées communes et avec des instincts (bon ou mauvais) qui étaient universellement acceptés comme bons dans toute l’étendue de notre territoire ; aujourd’hui, parmi nous se sont glissés un grand nombre de nouveaux colons, de formations variées, que nous n’avons pas la force de nous assimiler, qui ne sont peut-être pas assimilables, auxquels il faudrait au moins fixer un rang, et qui veulent nous imposer leur façon de sentir. […] Rien n’est plus pressant que des efforts méthodiques pour créer une discipline nationaliste.
Le Journal. L’éducation nationale
8 11 1899
Le Belgica est de retour à Anvers d’où il était parti en août 1897 : il revient de loin, dans tous les sens du terme. Adrien Victor Joseph de Gerlache de Gomery, officier de marine, était parti pour reconnaître l’Antarctique, avec pour but de reconnaître la mer de Weddell, puis laisser 3 hommes sur la terre Victoria pour hiberner et les récupérer au printemps suivant. Il a emmené du beau monde, dont Roald Amundsen, norvégien, second capitaine, Frederick Cook, américain, chirurgien, anthropologue et photographe, Hjalmar Johansen : norvégien, matelot ; et d’autres encore, hydrographe, océanographe, botaniste, physicien, géologue… Avant même d’atteindre les côtes de l’Antarctique, les dissensions ont provoqué le départ de plusieurs hommes d’équipage, dès Ostende, puis à Montevideo et Punta Arenas ; en février 1898 un homme plongeait dans les eaux glacées pour en recueillir un autre tombé à la mer : sous la violence des vagues, il le relâche. Le Belgica va être pris par les glaces et dériver avec elles pendant 13 mois dans la mer de Bellingshausen. Le scorbut se mêlera de la partie : Il n’a fallu qu’une nuit ininterrompue de 1 600 heures pour faire de nous des vieillards, écrira Lecointe. Le scorbut sera contré avec efficacité par la viande crue de phoque et de manchot que Cook avait ordonné de consommer. Le 6 juin 1898 Émile Danco succombera à une affection cardiaque. La bonne entente n’a pas été la règle… certains récits parlent de difficultés psychologiques, Jared Diamond, dans Effondrement, parle, lui, de folie.
12 12 1899
Prisonnier des Boers à la suite d’une rocambolesque histoire de train blindé stoppé par une embuscade des Boers, Winston Churchill, reporter de guerre du Morning Post, s’évade de la prison de Pretoria. Ils auraient dû être trois mais les deux derniers se sont faits repérer par des gardiens, et Winston Churchill se retrouve seul de l’autre coté du mur, muni de 75 £, 4 tablettes de chocolat, quelques biscuits, mais sans carte, ni boussole : il est à 480 km du Mozambique voisin et ami. Il monte dans le premier train de marchandises venu, et, 120 km plus loin, en descend : il est à Balmoral, une bourgade minière où il frappe à la porte de la première maison : chance ! c’est celle du directeur anglais des houillères, qui le cache … dans la mine, jusqu’au 19 décembre où il l’envoie vers le Mozambique, caché dans une cargaison de laine ! Il arrive le 21 décembre à Lourenço Marques, où il prendra un bateau pour Durban : il y est reçu en héros, porté en triomphe jusqu’à la mairie, et se laisse persuader de faire un discours ! Il aura encore des hauts et des bas dans sa très longue carrière, mais de ce moment-là date sa célébrité.
Cette même année était publié The River War dans lequel il faisait le récit de la conquête du Soudan par les Anglais un an plus tôt, à laquelle il avait pris part comme lieutenant de cavalerie :
Si un jour notre pays devait connaître le malheur, s’il devait voir s’effondrer dans la débâcle la dernière armée que l’Empire aux abois pût interposer entre l’envahisseur et Londres, alors j’espère qu’il resterait quelques hommes… pour ne pas accepter l’ordre nouveau et pour refuser de survivre au désastre au prix de la servitude.
Quarante ans plus tard, il sera cet homme. Prescience ?
19 12 1899
À la tête de ses goumiers, le capitaine Pein, menant une mission géologique commandée par Flamand, enlève In Salah aux Ksouriens. Les batailles à venir de Tit et F’guirira consacreront la supériorité des armes du colonisateur.
Une poignée de nos bons soldats de France vient d’accomplir un fait de guerre d’une haute importance dans le désert. On se souvient de l’horrible fin de la mission Flatters et de tant d’autres qui portaient la civilisation dans les plis de notre drapeau. Les Touaregs, ces sauvages au voile noir, massacraient sans pitié ceux qui voulaient agrandir notre sphère d’influence. Ils sont désormais réduits à l’impuissance, car nos soldats se sont emparés d’In Salah, leur repaire, leur nid farouche où ils s’approvisionnaient et d’où ils s’élançaient comme des bêtes fauves. […] Les Touaregs ne retrouveront pas l’occasion de réparer cet affront cet immense désastre. Gloire au capitaine Pein et à ses admirables compagnons !
Le Petit Journal. 1900
Lord Salsbury ironisera quelques mois plus tard : Nous avons donné au coq gaulois du sable sans compter. Laissons l’y gratter à son aise.
1899
L’ingénieur allemand Ferdinand Porsche met au point sa première voiture 100 % électrique, l’Egger-Lohner C.2 Phaeton, alias la P1. Alimenté par un moteur électrique octogonal fixé sur l’essieu arrière d’un châssis Lohner, ce tout premier véhicule électrique pouvait atteindre une vitesse de pointe de 26 km/h, prouesse inédite pour l’époque. Impressionnée par cette invention, la société Lohner cherche aussitôt à recruter le jeune génie de l’ingénierie. Porsche démissionne de chez Béla Egger au début de l’année 1899 et rejoint directement Jacob Lohner & Company, alors fournisseur officiel de la double monarchie austro-hongroise et de plusieurs autres familles royales européennes.
René Bazin dans La terre qui meurt, se fait l’écho des jeunes qui commencent à refuser d’être esclave de leur ferme :
Reste là au chaud, dit-il à Mathurin. Toi, François, conduis bien droit tes bœufs. C’est un beau jour de labour. Ohé ! Noblet, Cavalier, Paladin, Matelot !
Un coup de fouet fit plier les reins à la jument de flèche ; les quatre bœufs baissèrent les cornes et tendirent les jarrets ; le soc, avec un bruit de faux qu’on aiguise, s’enfonça ; la terre s’ouvrit, brune, formant un haut remblai qui se brisait en montant et croulait sur lui-même, comme les eaux divisées par l’étrave d’un navire…
François, disait le métayer, réjoui de sentir battre dans ses mains les bras de la charrue, François, prends garde à Noblet qui mollit : Touche, Matelot ! … La jument gagne à gauche ! … Veille, mon gars, tu as l’air endormi !
Le cadet, en effet, ne prenait aucun goût à conduire les harnais. Il songeait qu’il fallait parler, et la peur de commencer lui tenait le front baissé. Ils tournèrent au bas du champ, et remontèrent, traçant un second sillon près du premier. Les cornes des bœufs, l’aiguillon de François commencèrent à reparaître au ras des herbes qu’observait Mathurin. Celui-ci, pour saluer le retour du harnais, se mit à noter, à chanter, de toute sa voix la lente mélopée que chacun varie et termine comme il veut. Les notes s’envolaient, puissantes, avec des fioritures d’un art ancien comme le laboureur même. Elles soutenaient le pas des bêtes qui en connaissaient le rythme; elles accompagnaient la plainte des roues des moyeux; elle s’en allaient au loin, par dessus les haies, apprendre à ceux de la paroisse qui travaillaient dehors que la charrue soulevait enfin la jachère dans la cailletterie des Lumineau. Elles réjouissaient aussi le cœur du métayer. Mais François demeurait sombre.
Une lumière ardente et voilée enveloppait bêtes et gens. Tous les flancs battaient. Les mouches criblaient l’air. Des tourterelles gorgées de ramberge (mercuriale annuelle) se posaient dans les ormes, fuyant les chaumes embrasés.
Comme l’infirme ne chantait plus, le métayer dit, vers la moitié du champs :
À ton tour de noter, François ! Chante mon garçon, ça t’éjouira le cœur.
Le jeune homme continuait une dizaine de pas, puis il essayait de noter : Oh ! Oh ! les valets, oh ! oh ! oh ! Sa voix, qu’il avait plus haute que Mathurin, fit dresser l’oreille des bœufs et s’en alla tremblante. Mais, tout à coup, elle s’arrêta, brisée par le peur dont il n’était pas maître. Il se raidit, leva le menton vers le Marais, s’efforça encore de chanter, et trois notes jaillirent. Puis un sanglot termina la chanson, et rouge de honte, le garçon se remit à marcher en silence, le visage tourné vers la jachère, devant le vieux métayer qui par-dessus la croupe des bœufs, le regardait.
Pas un mot ne fut dit, de part ni d’autre, tant que le père n’eut pas achevé le sillon. Alors, au bas du champ, Toussaint Lumineau demanda, troublé jusqu’au fond de l’âme :
Tu as du nouveau, François, qu’y-a-t-il donc ?
Ils étaient à trois pas de distance le père au ras de la haie, le fils de l’autre coté de l’attelage, à la tête des premiers bœufs.
Il y a, père, que je m’en vais !
Que dis-tu François ?… Le chaud du jour t’a touché l’esprit … Tu es malade ?
Mais il reconnut aussitôt, à l’expression des yeux de son fils, qu’il se trompait, et qu’il y avait bien autre chose qu’un malaise : un malheur. François s’était décidé à parler. Une main passé sur l’échine de Noblet, comme pour se retenir, si nerveux et enfiévré qu’il fléchissait sur ses jambes, le regard dur et insolant, il cria :
J’an ai assez ! C’est fini !
Assez de quoi mon gars ?
Je ne veux plus remuer la terre ; je ne veux plus soigner les bêtes ; je ne veux plus m’éreinter, à vingt-sept ans, pour gagner de l’argent qui passe à payer la ferme: voilà ! Je veux être mon maître et gagner pour moi. Ils m’ont accepté dans les chemins de fer. Je commence demain ; demain, vous entendez ?
L’aspirine est fabriquée en Allemagne par les Ets Bayer : cela soulage avec efficacité les maux de tête, cela fluidifie le sang ; on connaît donc le comment, mais toujours pas le pourquoi. Le château du Haut Kœnigsbourg a connu la guerre de Trente ans et depuis, n’est plus que ruine. La commune de Sélestat, qui n’a pas les moyens de le restaurer, en fait don à l’empereur Guillaume II de Hohenzollern, pour qui cela s’avère être une aubaine politique quant à la puissance symbolique qu’il contient : ainsi pourront s’affirmer la domination et le pouvoir germanique sur l’Alsace, légitimant la dynastie des Hohenzollern. L’affaire ne va pas traîner : il en confie la restauration à l’architecte Bobo Ebhardt, le Viollet le Duc allemand : moins de 10 ans plus tard, les travaux seront terminés et l’inauguration sera faite en 1908.
Maxime Laubeuf construit le Narval, premier sous-marin français à même de naviguer en haute mer.
Le Grand Orient de France élimine les loges antisémites.
La revue américaine Scientific American recense 6 546 voitures en France, 688 aux États-Unis, 434 en Allemagne et 412 en Grande Bretagne.
Sir Arthur Evans, archéologue anglais entreprend les travaux de fouille du Palais de Cnossos, chef d’œuvre de la civilisation minoenne, en Crète. Prudent, il a acheté le site – 13 000 m² – au gouvernement de l’île. Il lui faudra 35 ans pour mettre à jour ce palais, au plan très complexe, construit sur plusieurs étages. Mais la mariée n’étant probablement pas assez belle pour lui, il donna libre cours à une imagination fertile, au détriment de la plus élémentaire rigueur scientifique : je trouve quelques éléments du corps d’un homme peints sur un mur : je vais le compléter en empruntant ailleurs les éléments qui manquent ; les colonnes de ce que je pense être le palais du roi sont quasiment inexistantes : je les refais en béton armé ; et mes petits dauphins, sont-ils pas mignons ? Pareil travail susciterait aujourd’hui une condamnation unanime… mais il faut croire qu’à cette époque on n’était pas si difficile…
Cnossos, le faux et le kitsch
Le jeune prince avec sa couronne marchant dans un champ de lis, Les cinq dauphins bleus, Les trois dames en bleu : les fresques du temple crétois de Cnossos ont été crées de toutes pièces dans les années 1920 sous l’impulsion de l’archéologue Arthur Evans. Aucune des colonnes du célèbre temple, qui attire chaque année des millions de visiteurs, n’est ancienne. L’histoire culturelle de la fabrication du mythe Cnossos est explorée pour la première fois dans toutes ses dimensions par l’historienne américaine Cathy Gere dans son livre Cnossos et les prophètes du modernisme (non traduit en français). Où l’on retrouve l’influence de Chririco et des couvertures de Vogue.
Olivier Postel-Vinay. Books n° 12, mars-avril 2010 L’Histoire n°351. mars 2010

mais si, mais si, Sir Evans, ils sont très mignons vos dauphins !
Andrew Carnegie, célèbre magnat de l’acier, publie L’Évangile de la richesse, texte fondateur de la philanthropie américaine.
Au XIX° siècle, après la guerre de Sécession, l’Etat fédéral a beaucoup investi dans la création d’écoles publiques pour alphabétiser les anciens esclaves. Mais les députés et sénateurs du Sud ont tout fait pour s’opposer à cette politique.
Pour contourner cet obstacle, John D. Rockefeller, l’un des pères de la grande philanthropie américaine, créera d’abord plusieurs écoles baptistes. Rejointe par d’autres industriels, la famille Rockefeller financera, en 1902, le Conseil général de l’éducation avec l’espoir que l’éducation finirait par abolir la ségrégation. Ensemble, ils ont aussi investi dans la santé publique et la modernisation de l’agriculture.
Universalistes, les philanthropes américains ont ensuite élargi leur action à d’autres pays comme le Brésil, le Mexique ou Ceylan (aujourd’hui le Sri Lanka). Ils partagent l’idée qu’une grande fortune n’appartient pas à celui qui l’a faite mais doit revenir à la société. Ils s’éloignent cependant de la charité classique – l’aumône -, qu’ils considèrent comme de l’argent jeté par les fenêtres, et investissent dans la recherche des grandes causes de la pauvreté.
Ils créent pour cela des d’universités – Johns Hopkins à Baltimore… – et lancent d’ambitieux programmes de recherche s’intéressant à des maladies comme la tuberculose, le paludisme et la fièvre jaune. Plus tard, la Fondation Ford innove, en utilisant le prêt plutôt que les dons comme levier de philanthropie, et la Fondation Rockefeller, en finançant le développement d’OGM. La Fondation Gates sera l’héritière de cette tradition.
Aux États-Unis, les fondations ont précédé l’impôt sur le revenu. Lors de son instauration, en 1913, son montant était symbolique, et l’exemption fiscale accordée aux fondations ne changeait pas vraiment la donne pour les riches industriels, qui œuvraient pour le bien de l’humanité.
En revanche, la mise en place, en 1936, de droits de succession allant jusqu’à 70 % a été décisive dans la création de la Fondation Ford, la plus riche des fondations américaines avant la création de la Fondation Gates. C’était le seul moyen pour la famille de garder le contrôle sur l’entreprise, tout en échappant à des droits de succession estimés à plus de 320 millions $. Les héritiers du constructeur automobile ont joué le jeu : cet argent a été investi dans de grandes causes.
Des fondations n’ont été créées que pour échapper au fisc, accumulant du capital en finançant peu de programmes. Cette évasion fiscale a suscité de vives critiques. Des politiques, dans les années 1960, ont envisagé de supprimer les fondations. Un juste milieu a été trouvé : le code fiscal leur impose de dépenser chaque année au moins 5 % de leur capital dans de bonnes œuvres, sous peine de perdre leur statut.
En théorie, la loi leur interdit de se mêler de politique : c’est la contrepartie de l’exemption d’impôt dont elles bénéficient. Dans les faits, les philanthropes se mêlent des affaires de l’État.
En 1966, le premier maire noir d’une grande ville américaine, Cleveland, a été élu grâce à une campagne financée par la Fondation Ford. Aujourd’hui, les fondations ne peuvent plus soutenir de la sorte un candidat, mais leurs campagnes d’éducation influencent l’opinion publique, tout comme les recherches menées par leurs think tanks. C’est un lobbying qui ne dit pas son nom.
En dehors des frontières des États-Unis, les actions financées par les fondations ont contribué à ce qu’on a appelé la pax americana. Il arrive qu’elles ne soient pas en ligne avec la politique étrangère américaine. Au milieu des années 1980, les philanthropes ont aidé à l’Éthiopie, ravagée par la famine, alors que l’administration Reagan était opposée à une intervention.
Les Américains ont donné, en 2014, près de 360 milliards $ (318 milliards € au cours actuel) à des bonnes œuvres. Cette générosité unique au monde s’exprime en partie à travers les fondations dont les dons se sont élevés à 55 milliards $.
Chloé Hecketsweiler. Le Monde 23 juin 2015
Les critiques viendront, visant essentiellement les placements financiers opérés en attendant que soit utilisé l’argent, placements dont, disent les détracteurs, l’éthique est loin d’être évidente.
Le sociologue Edmond Demolins crée à Verneuil sur Avre, dans l’Eure, l’école des Roches, qui s’inspire des public schools. Il défend une éducation globale, à la fois intellectuelle, artistique, manuelle et sportive, axée sur l’autonomie de l’élève. Demolins introduit ainsi en France l’éducation nouvelle, courant pédagogique qui réunit Adolphe Ferrière, Maria Montessori, Célestin Freinet ou Gustave Monod. Mais l’objectif est aussi de former des chefs, grâce au système du capitanat. Dans chaque internat, deux pensionnaires désignés capitaines secondent les chefs de maison, souvent un couple d’adultes habitant sur place. Elle deviendra autant une pépinière d’entrepreneurs que de vedettes du show-biz. Réservée à ceux qui peuvent se permettre de ne pas compter.
_________________________________________________________________________________________
[1] Le bonhomme n’était pas né d’hier : la règle de la vie politique, c’est : Usez-vous les uns les autres. Mais il n’était pas qu’auteur de bons mots :
Je veux tenter de dire ce que représentera, pour moi, ce grand méconnu que tout le monde lut, et que personne ne sut lire… La gloire de Zola est de n’être précisément ni un littérateur, ni un artiste et de faire éclater les cadres où l’on a coutume d’enfermer les renommées humaines spécialisées. Zola n’a pas plus écrit pour se distraire que pour distraire ses voisins. Il n’a pas pris le livre que comme moyen d’action… Zola n’est pas un littérateur. Zola n’est pas un artiste : comme Homère, comme Lucrèce, il est une force élémentaire.
Elie Faure. Œuvres complètes, tome III p.897, Pauvert, Paris 1964.
[2] Auguste Scheurer-Kestner, né à Mulhouse comme Dreyfus est un chimiste, chef d’entreprise, surtout connu pour son intervention en faveur de la révision, ce qui lui a coûté sa carrière. Il est mort le jour où Dreyfus a été gracié par le président Loubet et n’aura donc pas été témoin de sa réhabilitation.
[3] Fasciné par Nietzsche et son mythe du surhomme – sans doute mal compris -, le bonhomme, de santé fragile, était convaincu de la supériorité de l’homo britannicus, mais nourrissait de l’estime pour les Boers, avec lesquels il s’était d’ailleurs allié pour se lancer dans la politique dans la colonie du Cap. Par contre, à l’opposé, Paul Krüger ne pouvait souffrir ce personnage auquel tout l’opposait, estimait-il. Quand les Boers seront contraints, une fois défaits, à côtoyer les autres Blancs travaillant dans le diamant, ils les nommeront les uitlanders – les étrangers -.


Laisser un commentaire