| Publié par (l.peltier) le 27 août 2008 | En savoir plus |
21 08 1966
En Chine, la Révolution Culturelle bat son plein, avec, pour mot d’ordre, la destruction des quatre vieilleries : la vieille culture, la vieille idéologie, les vieilles coutumes et les vieilles habitudes. Pour cela, il faut mettre sous surveillance toutes les localités du pays, et débusquer partout où ils se cachant les contrerévolutionnaires. Mao Zedong opère ainsi sa reprise du pouvoir puisque, depuis l’échec du Grand Bond en avant, le pouvoir qui lui restait n’était plus que la direction du Parti Communiste. (C’est Liu Shaoqi qui est le président de la Chine depuis le 27 04 1959 jusqu’au 31 10 1968. Arrêté en 1967, battu par les gardes rouges, il est destitué par le 12° plénum du Comité central en octobre 1968, doit faire son auto-critique. Il mourra en prison à Kaifeng le 12 novembre 1969). Les Gardes Rouges, pour la plupart fils de notables du Parti, se mettent à torturer physiquement et moralement leurs enseignants : s’ils n’en meurent pas, très souvent ils se suicident. La folie va durer dix ans. La vie politique de ce géant depuis à peu près trente ans ressemble à celle d’un malade dont le médecin, monstrueux psychopathe, aurait jugé qu’il ne pouvait lui appliquer que des électrochocs en chaîne, quel qu’en fût le prix à payer. Jamais dans l’histoire de l’humanité le bon sens n’aura subi une aussi cinglante défaite ; le coût en fût évidemment exorbitant, le plus souvent non comptable. On décervelle, on humilie, on déplace, on blesse environ 100 millions de personnes et on en tue à peu près 4 millions d’autres dans les camps de redressement les laojiao ; mais on en a tué beaucoup plus dans les années précédentes, de 1949 à 1965 : selon le rapport Walker de 1971 au sénat américain, la fourchette de personnes tuées en Chine au cours de cette période se situe entre 32,2 et 61,7 M. On peut la diviser en trois phases : mai 1966 à avril 1969, avril 1969 à août 1973, quand Jiang Qing, Zang Chunqiao, Yao Wenyuan, Wang Hongwen, réunis au Politburo, forment la Bande des Quatre, renforçant le groupe contre-révolutionnaire de Jiang Qing, septembre 1973 à octobre 1976 : à cette dernière date, le Politburo écrase la clique de Jian Qing. Hua Guofeng, Ye Jiannying et Li Xiannian mettent fin au désastre de la révolution culturelle.
Général Phoebe : Après la Libération, ma mère est partie travailler dans une crèche tandis que mon père donnait des cours de psychologie à l’université normale de la Chine de l’Est. Puis, l’Institut de recherche en sciences de l’éducation de Pékin l’a transféré, lui et toute sa famille, à Pékin. Ma mère a dû abandonner son travail à la crèche et peu après, elle s’est éteinte. Elle avait soixante-quatre ans.
Xinran : Si jeune ! De quoi est-elle morte ?
Général Phoebe : D’une hémorragie cérébrale. Trop de pression : c’était la période de la Révolution culturelle… À cette époque, les professeurs d’université étaient traités comme des animaux, c’était surtout eux la cible des attaques. Les gardes rouges ont conduit tous les professeurs et les universitaires sur le terrain de sport et les ont obligés à s’agenouiller… Ma mère ne l’a pas supporté.
Yao est une vieille guérisseuse chinoise qui vit à Xingyi, au sud de Chongqing : C’est la vérité : j’ai vraiment gagné beaucoup d’argent ! [pendant la révolution culturelle, de 1966 à 1976. ndlr] Chacun étant occupé à se disputer, à se battre, à faire la révolution, tous les hôpitaux et les écoles de médecine avaient fermé leurs portes. Mais la révolution ne soignait pas leurs maux, elle les aggravait. Et de plus en plus de gens sont venus me voir. À ma façon aussi, j’étais révolutionnaire : j’en ai soigné beaucoup qui ne pouvaient pas payer, pour rien. L’argent, je me le suis fait sur le dos des rebelles, des gardes rouges : car s’ils ne m’avaient pas payé pour mes soins, ils n’auraient rien valu de plus que les capitalistes. Mais en fait, je ne voulais pas trop de leurs sous : je me disais que s’ils devenaient pauvres à leur tour, cela les encouragerait à faire durer la révolution. Oui, j’ai bien gagné ma vie pendant cette période, mais j’ai aussi vu beaucoup d’injustices : ceux qu’on obligeait à confesser des choses qu’ils n’avaient pas faites, punis pour des crimes qu’ils n’avaient pas commis ; tout le monde était terrifié. L’argent ne m’a pas rendu heureuse. […]
Mme You : Les jeunes d’aujourd’hui n’ont pas été embrigadés dans tous ces mouvements politiques. Nous, au contraire, nous avons été témoins de tout le processus, nous avons traversé et vécu toutes ces campagnes. D’abord il y a eu la Campagne pour éliminer les contre-révolutionnaires [lancée en octobre 1950] après la campagne des Trois Anti (1951), Les trois cibles de cette campagne sont : le détournement de fonds, le gaspillage et le bureaucratisme. (N.d.T.) Puis celle des Cinq Anti (1952) : la corruption, l’évasion fiscale, le détournement des biens de l’État, la fraude et le vol d’informations économiques. (N.d.T.) La campagne anti-droitistes (1957), et enfin celle des Quatre Assainissements (1963), Mouvement d’éducation socialiste lancé par Mao en 1963, en vue d’un assainissement politique, idéologique, organisationnel et économique. Il perdura jusqu’en 1966. (N.d.T.) Et la dernière en date, la révolution culturelle, de 1966 à 1976. Un mouvement après l’autre. Les jeunes d’aujourd’hui n’ont pas subi cette pression idéologique, ni vu l’expression pathétique de leurs parents soumis publiquement aux brimades durant ces campagnes.
Xinran Mémoire de Chine Éditions Philippe Picquier 2009



30 08 1966
À Phnom Penh, De Gaulle condamne l’intervention américaine au Viet Nam.
1 10 1966
Libération de deux des trois derniers condamnés de Nuremberg : Albert Speer et Baldur Von Schirach.
6 10 1966
La guerre du Viet Nam coûte aux États-Unis 2 milliards de $/mois.
21 10 1966 9 h 15′
À Aberfan, village minier du sud-est du Pays de Galles, un glissement de terrain, en cinq minutes, va emmener dans la mort 144 personnes dont 116 enfants. Le câble du téléphone du sommet du terril avait été volé, le mettant donc hors service. Dans un premier temps la Reine refusera de s’y rendre, seul lord Snowden, son beau-frère le fera. Elle-même ira huit jours plus tard, mais cela entachera son règne à jamais.
4 11 1966
Il pleut comme jamais depuis deux jours sur la Toscane. La veille, Piero Bargelini, maire de Florence, invité de la chambre de commerce américaine, avait encore l’humeur joyeuse : Florence n’a jamais redouté la compétition : s’il continue à pleuvoir ainsi, demain l’Arno fera pâlir votre Mississippi ! [1]
En amont de Florence, dans le Valdarno avaient été construits 2 barrages, le Levane et la Penna représentant une retenue de 13 millions de m³. Dans la nuit du 3 au 4, les ingénieurs donnent l’ordre d’un lâcher de 5 millions de m³. Plus tard enflera une rumeur selon laquelle les registres avaient été falsifiés postérieurement… procès il y aura qui fera apparaître que les employés n’avaient cherché qu’à détailler le récit de ces heures tragiques. On estimera à 250 millions de m³ la quantité d’eau et de matières arrachées : donc les 5 millions de m³ des deux barrages représentent bien peu de choses dans ce total. Le bilan en vies humaines sera de 121 morts pour toute la Toscane, dont 34 à Florence – 17 en centre-ville et 17 en périphérie. 50 000 familles se retrouveront sans abri, 15 000 voitures seront détruites, 6000 boutiques ravagées, 8 000 tableaux perdus à jamais dans les sous-sols des Offices.
Les catastrophes dévoreuses de vie humaines ne manquent pas dans l’histoire de l’humanité, d’un coût beaucoup plus élevé que celui-ci. Mais pareille destruction d’un patrimoine culturel de cette importance est chose unique : cinquante ans plus tard, les fous de Daech et l’Al Quaïda feront à nouveau revenir en surface cette même insondable tristesse en s’en prenant aux Bouddhas de Bâmian, à Palmyre etc…Un tsunami culturel, une dévastation.
C’est un faux débat que d’opposer les secours apportés aux victimes et ceux apportés au patrimoine culturel, de même que c’est un faux débat que d’opposer, en France, les aides sociales aux subventions importantes accordées à l’Opéra, qui n’est fréquenté que par les catégories sociales les plus aisées. Les intellocrates qui ironisent sur le fait qu’à force de chercher ses racines, on prend le risque de se prendre les pieds dedans, que disent-ils donc du formidable élan de solidarité qui fera venir des centaines de jeunes d’Amérique, et de l’Europe entière pour consacrer des jours, des semaines, des mois à nettoyer ce qui était récupérable et représentait un inestimable patrimoine culturel ?
L’attention filiale des Américains pour les chefs d’œuvre d’architecture, peinture, sculpture, littérature de l’Europe, la rapidité et l’efficacité avec laquelle ils donnent corps à cet attachement dans les temps de désarroi a quelque chose de poignant : on les aura aussi vu fréquemment en France à Versailles après la Commune, et encore après la tempête de décembre 1990. Ils se souviennent c’est là où sont nés leurs ancêtres, que s’est construite leur civilisation. Ils arrosent leurs racines sans se prendre les pieds dedans.
Et l’eau ne cesse d’abonder par torrents. La place inondée se vide par le célèbre Borgo Ognissanti, dans le prolongement presque direct de la rue d’où l’inondation continue d’emplir l’esplanade. L’Ognissanti ne tarde pas à devenir une sorte de rapide filant en direction du Prato. L’embouchure en est partiellement obstruée par un entassement de voitures retournées et de branchages feuillus contre lequel bouillonne le courant en forçant son passage. Dans moins de trois heures, le niveau de l’eau, actuellement d’un mètre d’un bord à l’autre de l’Ognissanti, aura bondi sans crier gare à trois puis quatre mètres, sans cesser de battre et de rugir au même rythme dévastateur, huit ou neuf heures durant, à plein régime, laissant l’Arno, libre de toute entrave, emplir le cœur de Florence toujours plus haut, jusqu’à ce que le fleuve décide, entre minuit et trois heures, de refluer aussi vite qu’il était monté, abandonnant la ville au chaos et à la désolation. De tout cela, nous ne pouvons encore nous douter. Nous ne le découvrirons que demain matin. Ce qui, pour l’heure, nous bouleverse et nous rend malades, est la force irrésistible de ces montagnes d’eau – eau bistre, incroyablement bourbeuse, détruisant tout sans distinction. Aucun mot n’est assez fort pour traduire la puissance de l’Arno lâché dans les rues de Florence. Nous apprendrons plus tard que l’eau circulait en ville à la vitesse de 60 km/h, avec un débit de 3 500 m³/h. […]. Pour le moment, nous ne voyons rien d’autre que cet énorme débordement, tel un barrage rompu.
[…] L’étendue de la tragédie ne se dévoile que progressivement. Devant nous, un pont dilacéré dont les rambardes tordues retiennent des masses de détritus, à l’entrée duquel se sont amoncelés des tas de bidons de mazout. Nous n’avons pas atteint le Ponte Vespucci que déjà nous marchons dans une épaisse gadoue, sorte de pâte noirâtre et glissante qui nous oblige à poser un pied après l’autre pour ne pas perdre l’équilibre. […] Les élégantes façades des palais sont recouvertes d’un manteau de graisse noire jusqu’à la cote maximale de la crue, laquelle ne cesse de monter le long des murs à mesure que nous progressons dans une vase toujours plus épaisse.
À l’entrée d’un de ces palais, un portier chasse une boue liquide vers le trottoir à l’aide d’un vieux balai, mais le grand hall derrière lui disparaît sous plus de dix centimètres de gadoue, si bien que l’étroit passage qu’il dégage se referme à mesure qu’il avance – et le paquet de boue gluante sur le trottoir prouve qu’il s’active depuis un moment. Nous devons le contourner.
Nous passons devant une boutique d’articles de mode dont le rideau de fer ne protège plus aucune vitre ; à l’intérieur, dans quinze centimètres d’eau noire, gisent des rayonnages renversés, un amas de cartons détrempés et de vêtements souillés de boue – un chaos indescriptible. Sur plus d’un demi-mètre au-dessus de cette mare, les murs sont imprégnés de mazout. Un peu plus loin, dans une petite vitrine intacte, une paire de chaussures de bal bleues à talons aiguilles et boucles d’argent trône immaculée sur un coussin de satin blanc.
Plus nous avançons, plus les dégradations sont impressionnantes. Presque aucune boutique n’est épargnée, pas une cour qui ne soit un marécage vaseux. La ville, au soleil du matin, est plus immobile qu’un cadavre.
Piazza Ognissanti, où se font face le Grand Hôtel et l’Excelsior, règne un désordre effrayant. Une couche noire de mazout adhère à la façade de la jolie petite église presque jusqu’au linteau des portes. Un marais bourbeux de paille pourrie et de déchets, profond de trente centimètres, ondoie sur la place et dans la rue. Des voitures cabossées, maculées jusqu’au toit, sont enchevêtrées comme dans un gigantesque carambolage. Des portiers chaussés de bottes tentent d’évacuer les quarante centimètres de fange où baigne le hall de l’Excelsior, à l’extérieur duquel, côté Lungarno, [les Quais de l’Arno] une échelle a été disposée contre le balcon du premier étage pour permettre aux clients d’atteindre le trottoir.
Un carrefour plus loin, la Piazza Goldoni offre un spectacle de complète dévastation. L’esplanade n’est plus qu’un cauchemardesque imbroglio de voitures, de branches, de boue, de pavés arrachés et d’articles détruits. La grande pharmacie à l’angle ouest, toute noire, ses trois grands volets d’acier froissés comme des feuilles de papier, est entièrement ravagée. Étagères et rayonnages sont effondrés dans un bourbier de plus d’un mètre, garni de débris, où de petites boîtes de médicaments et des flacons cassés se sont répandus tels de gros confettis. Et cette nappe de mazout qui pollue tout… Mais d’où s’est échappée cette marée de pétrole ? [2] Aussi haut que soit montée l’eau, tout en est enduit : les rues et les trottoirs, les murs extérieurs et intérieurs, les marchandises gorgées d’eau, les branches d’arbres, les fétus de paille, les détritus… Les deux galeries d’art, la Goldoni et la Masini, offrent un spectacle bouleversant. Plus de vitres derrière les grilles distordues, plus rien sur les murs encrassés, et parmi les monceaux de cadres brisés, visqueux, jetés au sol, gisent les toiles que nous nous arrêtions encore hier pour admirer ; aujourd’hui tout est à demi enfoui sous une poix noire. Les petites rues débouchant sur la place sont pareillement obstruées, jonchées de déchets et polluées de mazout. Le cœur de la belle Florence n’est plus qu’une morne décharge. Palais et commerces sont comme éviscérés. D’interminables perspectives de façades noircies donnent à croire qu’une barrière de flammes a forcé son chemin, ne laissant derrière elle que suie et charbon. La ville semble s’être vidée de tout – sauf de ses ruines.
Les citadins qui arrivent ici par petits groupes restent pétrifiés de stupeur ; aucune indignation sur leurs traits, aucun geste, pas un cri, il n’y a place que pour la sidération et la douleur, profonde.
Che disastro ! gémit un homme grisonnant, d’une voix faussée par l’incrédulité.
Un mélange d’abattement et d’incompréhension parcourt la foule des curieux comme un écho. Le long des quais de l’Arno, lentement, péniblement, comme si chaque pas leur faisait mal, les Florentins défilent en silence, s’arrêtent, repartent. À jamais leurs visages resteront gravés dans notre mémoire : leurs regards stupéfaits, leurs bouches tordues de douleur, l’interdiction, le choc de la prise de conscience.
À l’entrée du pont d’où hier encore nous regardions l’eau monter sur la place, nous attend une autre scène de carnage. Sous nos yeux ahuris, le mur qui bordait le fleuve s’est effondré jusqu’au Ponte Santa Trinita, emporté par le courant ; la chaussée du Lungarno s’est disloquée en blocs de deux mètres qui recouvrent la rue, mêlés à des dunes de sable et de boue, des réverbères déracinés, des carreaux cassés, des briques et des conduites d’eau. Ici et là, dans les reliefs de maçonnerie, pendouillent des câbles sectionnés dont les bouts écorchés ornent la rue délabrée d’une frange insolite, comme un vêtement déchiré.
Nous dépassons le pont, dont les piliers ont été sévèrement tailladés par les énormes blocs emportés par le courant. Contre l’ouvrage dépierré s’élève un fatras d’arbres enchevêtrés, de paille, de meubles broyés, le tout recouvert d’une grande plaque d’acier rouge venue s’enrouler sur ces débris comme une embrasse.
Il devient presque impossible de progresser parmi les tas de déchets vers le Ponte Santa Trinita. Partout, dans la chaussée défoncée, se sont ouvertes de profondes crevasses. Les façades sont souillées jusqu’à deux mètres de hauteur. Les célèbres ateliers photographiques Fratelli Alinari sont en ruine, leurs vitrines pulvérisées, leurs volets métalliques tordus et fracassés, leur mobilier et tous leurs tirages – à l’exception d’une demi-douzaine d’images intactes, superbes, haut perchées sur les murs – malaxés dans une bouillie de sable, d’eau et de mazout noir, comme dans un chaudron infernal. Un cabriolet Mercedes de couleur blanche, qui devait être joli, s’est encastré dans la devanture d’un magasin. Les berges de l’Arno sont jonchées d’arbres et de branchages. Les fenêtres grillagées sont tressées d’herbes, de paille et de brindilles. Sur l’autre rive, l’eau a tracé une marque au-dessus du premier étage des maisons.
Tandis que nous approchons du Ponte Santa Trinita, nous voyons des feuillages palpiter au-dessus du pont. Ce sont des arbres dont les troncs, en éperonnant les énormes piliers, y ont pratiqué de profondes échancrures. Emboîtés dans la pierre, ils oscillent au soleil avec un faux air de fête.
Devant nous, sur la berge, s’ouvre un trou béant. À mi-distance du Ponte Vecchio, il n’y a tout simplement plus de Lungarno. La rue entière, hormis une étroite bande au pied des façades, s’est effondrée dans le fleuve. La crue, en se jetant contre la masse du vieux pont, a déferlé sur elle-même, avalant les berges, les murs et les fondations. Là où subsistent des portions de voie, la chaussée est écorcée comme une peau. Vers l’intérieur, une eau morte et noire recouvre les rues ; nous arrivons au cœur de la ville sinistrée. Comment imaginer que de l’eau ait provoqué pareil saccage ?
O povera Firenze, murmure un homme de noble apparence, lèvres tremblantes.
Oui, pauvre Florence…
Nous longeons les façades sans même les voir, attentifs à ne pas trébucher sur le peu qui reste du quai arraché, un œil sur nos pieds, l’autre sur le Ponte Vecchio. Le vieil édifice est toujours debout, mais dans quel état ! Les échoppes des joailliers sont des carcasses noircies que le courant a traversées de part en part, emportant tout sur son passage. Pendant la nuit, certains boutiquiers ont été réveillés par leur veilleur qui les prévenait que le pont était sur le point de céder ; plusieurs familles ont sauté en hâte dans leur voiture pour venir sauver, dans le noir et sous la pluie, leurs précieux stocks d’or et de diamants, au petit bonheur, à la lueur des chandelles, tandis que le pont tremblait et vacillait sous leurs pieds, menaçant de s’écrouler à tout instant. Mais la plupart n’ont pas été avertis, ou bien sont arrivés trop tard pour accéder au pont. Et ce matin, agenouillés dans les décombres, ces pauvres gens, riches marchands transformés en chiffonniers, déblaient à mains nues cette invraisemblable mixture de terre, de branches et d’ordures, tamisant le sable boueux pour en extraire ici une chaîne, là une bague ou une petite broche qu’ils exhibent d’un air étonné, presque heureux d’avoir sauvé cette infime partie de leur patrimoine à jamais perdu. Tout le reste a sombré dans l’Arno.
La rue qui s’enfonce en ville, Por Santa Maria, est une mer de boue et de gravats. Des tas de détritus commencent à s’élever sur les trottoirs car les propriétaires de boutiques, hommes et femmes, sont déjà à pied d’œuvre, armés de pelles et de balais. Pataugeant jusqu’à la taille, souvent même jusqu’aux épaules, ils commencent l’interminable nettoyage.
Nous les regardons pelleter et repousser à leurs portes des paquets de crasse et de sable déposés par la crue, mais aussi tous ces biens manufacturés qui faisaient leur spécialité, livres d’art souillés de boue, sacs à main gluants et chaussures détrempées, chiffons graisseux qui furent des chemisiers de soie, des robes, de la lingerie. Rien qui puisse être sauvé parmi cette charpie. Tout est jeté sur le trottoir ou dans le caniveau. Pas une larme sur les visages graves mais farouchement déterminés de ces commerçants qui s’activent. Tôt ce matin, posant les yeux sur ce spectacle de désolation, ils sont restés sans bouger, à plaindre leur ville et regretter la perte de leurs biens. Mais les Florentins ont une longue expérience de l’adversité ; sans attendre, ils se sont mis au travail. Sans un mot, résolus, opiniâtres, ils se sont attelés à cette tâche immense, proprement insurmontable.
Une grosse femme en pull-over bleu s’accorde une pause. Appuyée sur son grand balai, elle essuie de son avant-bras la sueur de son front. Un homme et une femme, sortis d’une porte voisine, lui adressent la parole. Les Italiens se touchent volontiers pour exprimer leurs sentiments ; une main se pose sur son bras, tandis qu’une autre lui tapote l’épaule.
- Terribile, dit l’homme d’une voix lourde de chagrin.
- Terribile ! lui répond la femme en bleu.
- Pire que la guerre, ajoute-t-il gravement.
C’est vrai, la guerre n’était rien en comparaison, approuve l’autre en pesant ses mots.
- Quelle misère, dit-il en contemplant l’horreur de la rue. Les deux femmes opinent instinctivement, se palpent encore un peu et retournent chacune à son labeur, avec la même tête de circonstance.
Spectateurs immobiles, nous sommes de plus en plus stupéfaits par le courage de ces gens crottés de boue. Ils ne sont pas plus de deux à s’affairer dans chacune des boutiques, dont une bonne moitié, saccagées, sont encore sens dessus dessous et combles de déchets. Ceux qui sont là s’enfouissent dans les immondices jusqu’aux genoux ou jusqu’aux hanches, fouillant la fange, explorant ce capharnaüm pour extraire des débris un rayonnage intact, un tiroir qu’ils mettent de côté. Un homme tente de racler, à l’aide d’un bout de latte extirpé de ce champ de ruines, l’épaisse gangue de mazout recouvrant l’un de ces objets rescapés. La tâche est très au-dessus de leurs forces et tous ces efforts paraissent dérisoires face à ce gigantesque dépotoir ; et pourtant les visages sont fermes et les vieux balais frottent infatigablement. Le consul général, d’habitude grave et réservé, s’exprime d’une voix blessée que l’effroi a rendue tranchante.
C’est la ruine, ni plus ni moins. Ces petits commerces sont à terre. Il n’y a rien à sauver. Je ne vois pas comment ils pourraient redémarrer.
La police, non sans raison, éloigne les piétons des abords du vieux pont, à l’exception des commerçants. En rebroussant chemin le long du fleuve, nous passons devant un grand atelier de marbrier dont toutes les vitrines ont explosé et qui n’est plus qu’un champ de briques, de pierres et de statues décapitées baignant dans l’eau et le mazout. Une femme vêtue d’un chandail, mais sans bottes, évacue de petites pelletées de boue sableuse sous le grillage déchiqueté de la devanture.
De retour au Ponte Santa Trinita, j’abandonne mon compagnon pour traverser la place – inconsidérément, car la zone est un étang infranchissable d’un demi-mètre d’eau boueuse. Je le contourne tant bien que mal, mais bientôt je me retrouve coincée et tente un détour par une étroite ruelle du XIII° siècle parallèle au Borgo Santissimi Apostoli, pataugeant dans un décimètre de bourbe et évitant des véhicules renversés, ratatinés contre les murs de cette artère juste assez large, en temps normal, pour laisser passer une voiture de front. Enfin, je finis par trouver une allée montant vers le nord. Elle paraît peu engageante, croupissant sous un demi-mètre de boue, mais semble tapissée d’un banc de sable qui devrait la rendre praticable. J’assure chacun de mes pas, reculant prestement dès que le sable se dérobe sous ma semelle, de l’eau au ras des bottes. Ici, les seuls déchets sont une escadre d’escarpins en provenance d’un bon chausseur pour dames, quoique ainsi gorgés de boue ils n’aient plus rien de luxueux. À première vue, on dirait que des femmes qui passaient par là ont toutes perdu leurs souliers dans la gadoue. À l’autre bout de l’allée, une mère et son fils apparaissent, puis disparaissent aussi vite après s’être enfoncés dans l’eau. Quelques grandes enjambées périlleuses et patatras : de la boue plein les jambes et de l’eau qui me dégouline jusque sur les chevilles. Je prends de nouveau sur ma gauche, me faufile dans un cimetière de voitures retournées et de mobylettes désarticulées, et me voici Via Tornabuoni. Le marécage est derrière moi.
La Via Tornabuoni est la plus chic des grandes artères commerçantes de Florence, l’équivalent italien de l’intersection 5° Avenue-57° Rue à New York. Mais aujourd’hui c’est une sorte de terrain vague. Pas d’autre son que la sirène d’une ambulance qui s’éloigne vers le nord et se dissout dans le silence. Magasins éventrés, façades répugnantes, barbouillées de mazout, partout la ruine et la désolation. Dans la rue sans vie, une ou deux personnes immobiles, l’air effaré. Sur ma droite, les arbustes et les élégantes chaises à grillage d’une terrasse de café forment un maquis brun pétrole, festonné de chaume et de bandes de papier noircies. Dans ce silence atroce, le cœur de Florence semble avoir cessé de battre. C‘était une ville bruyante et animée ; comment croire que la vie y reprendra ?
De l’autre côté de la rue, derrière un fatras de débris, de gravats, de briques et de boue, cet écriteau : WAGONS-LITS COOK. Les barreaux des fenêtres, tels des paillassons, sont garnis d’herbes, de brindilles et de banderoles de papier sales.
Un peu plus loin, au beau milieu de la chaussée déserte, gît un très grand arbre, incongru dans cette avenue naguère luxueuse. Bien incapable d’en estimer la longueur, j’entreprends de le mesurer, comptant un mètre par enjambée : j’arrive à treize ! Perdue dans mes observations, j’entends soudain crier mon nom, quoique j’aie peine à le croire. Une main m’attrape par le bras ; c’est la vendeuse de la boutique de mode où, avant-hier soir, sous la pluie battante, j’étais allée faire un essayage – cela paraît dater d’un siècle ! Elle est endimanchée, mais ses pieds et ses jambes sont couverts de boue. Elle me fixe d’un air éperdu, sombre et douloureux, mais parfaitement maîtresse d’elle-même.
O Signora ! gémit-elle en m’enlaçant comme une naufragée s’accroche à une épave. Il negozio è tutto andato, tutto andato ! [La boutique est entièrement détruite, entièrement détruite ! ]
Je n’ai aucun mal à le croire, je viens de voir la rue dévastée, proche du Ponte Vecchio, où elle se situe. Nous restons quelques minutes agrippées l’une à l’autre, échangeant des bribes de phrases affligées, puisqu’il n’y a rien d’autre à exprimer que la tristesse et qu’elle se refuse à pleurer ; je suis plus proche des larmes qu’elle.
Non c’era pre-allarme, [Il n’y a pas eu d’alerte.] me dit-elle d’une voix tendue. C’est une belle jeune femme au regard noir, dont la voix mélodieuse de Florentine me raconte, avec toutes les nuances d’une lamentation, la triste fin de sa petite boutique.
Faute d’alerte, rien n’a pu être sauvé. Ils habitent sur l’autre rive. Avant d’avoir appris le désastre, aux environs de neuf heures du matin, le piège liquide s’était refermé sur le secteur du Ponte Vecchio. Une nièce habitant sur la rive nord de l’Arno est descendue en hâte, mais elle a dû battre en retraite devant l’irruption du torrent. Si bien que tous les vêtements taillés pour les clients ou sur le point de l’être, tous les rouleaux de soie et les délicats lainages ont été réduits en guenilles et lambeaux imprégnés de vase et de pétrole. C’est la finimondo, me dit-elle accablée mais résignée – la fin du monde, l’équivalent italien le plus fort de catastrophe. Ce mot, je l’entendrai sur bien des lèvres ce matin, mais plus du tout demain lorsque, passé le premier choc, les Florentins auront encaissé ce coup terrible ; car ce terme est trop fort, il sous-entend la capitulation ; or, dès ce premier jour, il paraît évident que Florence, durement meurtrie, ne s’avouera pas vaincue.
Plus haut sur la Via Tornabuoni, par la vitrine disparue d’une grande librairie, on aperçoit une masse pâteuse de papier répandue au sol. Derrière une fenêtre haut perchée, un petit livre rose immaculé au titre pimpant, La félicita è un cucciolo caldo – Charlie Brown, vainqueur des flots !
À l’est du palais Strozzi, il y a déjà plus de curieux dans les rues, plus de commerçants aussi qui tentent de nettoyer ce chaos si indescriptible qu’ils donnent l’impression de ne parvenir à rien du tout. Ceux qui en ont portent des bottes, d’autres sont en cuissardes, beaucoup ont recouvert leurs pieds et leurs jambes de sacs en plastique noués à l’aide de ficelle. Tous sont crottés jusqu’à la taille. Les étrangers se parlent et se désignent, en s’attrapant par le bras, tel détail affreux de ce tableau dantesque.
Che disastro ! disent-ils avec des gestes effarés.
Eux aussi paraissent abasourdis.
À un coin de rue, on accuse la commune de n’avoir pas su donner l’alerte. Le ton monte. Pourquoi n’a-t-on pas entendu sonner les cloches, les vieilles cloches d’alarme du Palazzo Vecchio ? Pourquoi des sirènes n’ont-elles pas averti les citadins ? Un gros homme vêtu d’un manteau de bonne coupe fait observer, sarcastique, que si les sirènes avaient retenti, les gens auraient cru à une attaque nucléaire et se seraient tous précipités dans les caves, pas exactement le meilleur refuge contre une inondation. Un sourire se dessine à grand-peine sur de nombreux visages, pâle témoin du fameux sens de la dérision des Florentins. Une autre voix fait valoir qu’une alarme générale aurait provoqué un embouteillage, tous les commerçants affluant en ville pour sauver leurs marchandises ; des centaines de personnes, capturées par les eaux, seraient mortes noyées avec leurs biens. De sorte que c’est l’absence d’alerte, ajoutée au fait que ce vendredi était férié, qui a permis d’épargner de nombreuses vies. Les rues étaient déjà assez engorgées avec les voitures venues tôt profiter de la festa ; quant aux conducteurs qui ont entendu les premières sirènes des pompiers, ils se sont retrouvés bloqués et isolés. D’ailleurs, voici leurs véhicules, sur le trottoir pour la plupart, de vraies épaves, roues arrachées, carrosserie broyée, ou bien miraculeusement indemnes mais recouverts d’une gangue de mazout et dégoulinants de boue.
Le long de la Via Vecchietti, rue de commerces et de banques de dépôt, une sorte d’épais cambouis s’est déposé dans les caniveaux, mais les taches noires sur les façades s’arrêtent à un mètre vingt – hauteur suffisante, toutefois, pour avoir inondé les banques et les botteghe -, gravement sinistrées. Au Credito Italiano, un énorme tronc d’arbre s’est échoué dans la salle de change. Mais c’est dans les rues basses parallèles au fleuve que les dégâts sont les plus considérables. La crue s’y est littéralement engouffrée. Bien des rues adjacentes, quoique sévèrement touchées, n’ont pas eu à subir de telles hauteurs d’eau. Ici, trois fenêtres brisées ont déjà été barricadées. Les vitres du magasin de porcelaine, où j’achetais des verres en cristal pas plus tard que la semaine dernière, sont intactes, mais les portes semblent avoir cédé car le sol est jonché d’éclats de Minton, Staffordshire, Dresde et Royal Delft, ainsi que de cristal de Sèvres et de Waterford. Quant aux pièces restées sur les tables et les présentoirs, elles sont engobées d’une strate brunâtre. La moquette est une soue innommable.
Sur le trottoir boueux, devant la porte d’un magasin, des cravates spongieuses, dégoulinantes de mazout, pendent d’un présentoir. À la vitrine d’une animalerie, des oiseaux noyés dans leurs cages.
Piazza délia Repubblica, les carabinieri ont déjà construit un grand abri en bois. On dirait que la place n’a pas été ravagée par une inondation mais par un ouragan, car elle ruisselle littéralement de papiers détrempés – banderoles, feuilles, napperons, des milliers de lambeaux collés un peu partout ou ornant l’imbroglio de branchages, chaises crasseuses et tables démolies qui sont l’unique vestige des cafés à la mode à la terrasse desquels on pouvait rester des heures au soleil, à lire le journal ou un magazine en sirotant un cappuccino ou un Cinzano -.
Du côté ouest de la piazza, la galleria où se trouvait l’étal du fleuriste est farcie de boue, de débris et de voitures projetées sous les arcades, tout cela recouvert d’une funèbre jonchée de fleurs, de fougères et de verdure dépenaillées, saupoudrées de brisures d’ampoules électriques.
Et le mazout, le mazout ! Pas un objet, un centimètre de mur qui ne soit nappé de ce carburant pestilentiel, parfois sur plusieurs centimètres d’épaisseur. On se dit qu’on n’en viendra jamais à bout, qu’une allumette suffirait pour réduire la ville en cendres. Mais Florence est faite de pierre, et tout ce qui était inflammable est tellement imprégné d’eau qu’une telle crainte est sans doute infondée [3]. Pis que l’eau et la boue, c’est le mazout qui a parachevé le saccage des biens et du mobilier. Sur le chemin du Duomo, je passe devant une maroquinerie de luxe. Dans la vitrine, un protège-bouteille en vachette rouge taché de graisse est renversé sur le côté ; sur le trottoir, je manque trébucher sur un tas gluant de sacs à main en serpent, veau ou daim, de portefeuilles et de porte-monnaie mazoutés à demi ensevelis dans une épaisseur de boue, comme de vulgaires ordures. Ils sont surmontés d’un balai visqueux appuyé contre le mur. Je connais cette boutique. Ces sacs pourrissants, produits artisanaux de première qualité, coûtaient de trente à soixante-dix dollars pièce, deux fois moins qu’aux États-Unis. Tous ces dommages sont incalculables. La majorité de ces commerces étaient de petites entreprises privées, dont tous les bénéfices étaient réinvestis dans le stock ; pour la plupart, ces articles perdus sont tout bonnement synonyme de faillite. Comment se rétablir s’il n’y a strictement rien à sauver ? Si vous avez emprunté à la banque pour acheter des marchandises irrécupérables ?
Et pourtant, dans chaque rue, petit à petit, les Florentins remontent la pente. Ne serait-ce que pour jeter ce qui ne peut être sauvé et relever la tête de toute cette lie. Admirable spectacle. À chaque pas de porte, chaque seuil de magasin, chaque entrée de maison, c’est le même frottement de balais, le même grattement de pelles – balais antiques et pelles inadéquates, sans doute, mais ils décapent sans faiblir les tapis et les marbres maculés de boue liquide, et lorsque les trottoirs disparaissent à leur tour sous la fange évacuée, ils se mettent à balayer les trottoirs, par habitude, comme s’ils commençaient leur journée de travail par une belle matinée ensoleillée. Bien sûr, leurs moyens sont parfaitement dérisoires : des ustensiles en piteux état, face à des montagnes de boue et de déchets. (Plus d’un mois après les faits, je lis, selon les rapports d’expertise, que cinq cent mille tonnes de boue auraient englouti Florence ; l’image n’est donc pas exagérée, d’autant moins qu’il s’agit d’une estimation basse.)
Et, comme pour rendre le nettoyage impossible, il n’y a plus d’eau. Toutes les amenées sont cassées, seule est disponible cette mare fangeuse dormant sous une épaisse couche de mazout. Comment venir à bout de cette crasse sans eau ? Et où évacuer la boue ? Les bouches, le long des trottoirs, sont trop étroites et les égouts sont bouchés. Tout va donc à la rue. Quant au fourbi sorti des maisons et des commerces, il vient grossir les empilements de voitures, d’arbres, de détritus graisseux, de pavés, de rayonnages et de meubles brisés que la boue déposée par le fleuve a déjà agglomérés. De sorte que le nettoyage ne progresse qu’imperceptiblement ; mais il n’y a que tous ces bras pour remettre de l’ordre, toutes ces mains pour affronter tant de fange pendant tant d’heures, et personne ne se résigne à s’asseoir ou ne songe à s’interrompre pour se plaindre. S’ils pouvaient mesurer leur efficacité, je crois bien qu’ils s’arrêteraient sur-le-champ ; alors, au lieu de réfléchir, ils manient la pelle. Non, je suis injuste. Rien n’est moins aveugle, rien n’est moins stupide que ce qui se joue ici. Ce serait une erreur de sous-estimer le solide bon sens de ces gens, qui ont toujours su qu’ils vivaient aux limites du danger et qui ne se racontent pas d’histoires. Ils mesurent parfaitement l’ampleur du désastre qui les frappe. Cet homme, Via Porta Santa Maria, qui s’exclamait Quelle misère ! ne faisait que sobrement résumer la détresse générale. Il est extraordinaire que, sachant ce qu’ils savent, ces gens se mettent au travail sans désemparer, au lieu de s’effondrer en se lamentant sur leur sort, comme l’envie ne leur en manque peut-être pas. Et les pelles et les balais de s’activer. En fin de compte, c’est à eux que Florence devra son salut – à eux, qui ne craignent pas de brandir un balai contre le chaos -.
Quoique je commence à m’habituer plus ou moins à l’horreur, et malgré les comptes rendus à la radio, hier soir, qui auraient dû me préparer à ce spectacle, je n’en suis pas moins estomaquée par ce qui m’attend sur la Piazza San Giovanni. La vaste place, totalement dévastée, est sens dessus dessous. Les grandes portes de la cathédrale sont fermées. L’esplanade ressemble à un no man’s land jonché de pavés descellés, de branches, de loques, de panneaux indicateurs et de signalisation sciés net, de chaînes et de plots métalliques déracinés, couchés dans un champ de boue. Le mazout, ici, est particulièrement dense.
À une hauteur incroyable, entre le majestueux Duomo de marbre vert et blanc et le campanile de Giotto, une voiture verte déglinguée est restée coincée, négligeable rebut abandonné par la crue. Sur un sarcophage romain, devant les portes sud du baptistère San Giovanni, trône un baril de mazout. Un attroupement s’est formé autour du baptistère. Je m’approche du premier groupe de curieux. Par-dessus les têtes, je vois que les portes internes en bois ont été forcées et fracassées. Mais que sont devenues les portes externes, celles du Pisano ? Leur encadrement en bronze a disparu, et l’un des bas-reliefs du XIV° siècle, sur la partie basse du battant droit, est manquant – celui qui représentait la Charité. Un Italien, d’une voix éteinte, dit qu’on en a retrouvé des fragments.
Il y a encore plus de monde du côté ouest du baptistère, qu’ornent les magnifiques portes de Ghiberti, celles que Michel-Ange appelait les portes du Paradis. Mais je ne pressens rien, abusée que je suis par l’illusion que la crue n’a pu envahir la place que par le sud, du côté le plus proche du fleuve, alors que le plus gros de l’inondation, comme aurait dû me le suggérer la voiture échouée tout là-haut, s’est engouffré par les rues parallèles à l’Arno, d’est en ouest. Non, mon Dieu, pas ces portes ! Hélas, cinq des dix merveilleux panneaux sont vides. Deux policiers, aux ordres d’un officier, empilent la cinquième des plaques arrachées au-dessus des quatre autres. Une légère agitation parcourt la foule. Moi qui ne suis pourtant pas d’un tempérament batailleur, je me surprends à jouer des coudes jusqu’à la barrière de protection, comme poussée à demander à voix basse à l’officier (car on n’entend presque aucun autre bruit que le tintement du métal) :
- Sont-elles très abîmées ? À part le descellement et la nafta ?
L’officier se retourne et me regarde d’un air grave, les yeux humides. Il hoche la tête sans pouvoir dire une parole.
On nous écarte pour laisser passer la charrette qui doit emporter ces panneaux comptant parmi les plus hauts chefs-d’œuvre de l’art, non seulement florentin, mais universel. Nous la regardons passer comme pétrifiés. Un homme, qui a tout l’air d’un professeur, dit très doucement à son voisin : Et dire que pendant la guerre, alors qu’approchaient les Allemands, on a fait venir les meilleurs artisans et les plus grands experts de toute l’Italie pour les démonter et les mettre à l’abri des Tedeschi – et que pas un n’a su les enlever. Ils n’arrivaient pas à les desceller !
Je préfère me retirer à pas lourds, malade et soucieuse à cette pensée : et tout le reste, les autres œuvres d’art ? Qu’en est-il de la chapelle des Médicis dans la basilique San Lorenzo ? des Michel-Ange de la Galerie de l’Académie ? du palais Bargello ? Qu’en est-il des fresques ? des tableaux dans les églises ? Après ce choc, je me sens soudain extrêmement lasse. Comment les Florentins, dépositaires de ces trésors, souffriront-ils tout cela, si moi-même, qui ne suis florentine que de cœur, suis malade de tristesse et découragée ? J’accuse le ciel avec amertume : c’est trop injuste, trop cruel. Je me sens glacée jusqu’aux os, en colère plus qu’en larmes.
Il y a un raccourci pour rentrer à la pension en passant par la gare ferroviaire, à deux bons carrefours d’ici. Ou plutôt il y avait, jusqu’à avant-hier. Je crapahute en dérapant par les rues obstruées, m’agrippant aux murs, escaladant des montagnes de déchets et de décombres, contournant d’étranges écheveaux de rideaux de fer démontés, de lourdes grilles de cuivre tordues et entortillées, des étagères éclatées et des meubles tous ornés de haillons infects, de brins de paille et d’entrelacs de papier. Via Cerretani, on voit un entassement de voitures accidentées – ailes, toits et portes défoncés. Une décapotable bleue tout aplatie, qui a dû faire plusieurs tonneaux, barre le passage sur l’étroit trottoir ; ses fauteuils crevés dégueulent par ce qui fut la lunette arrière ; sa carrosserie est entièrement froissée, le pare-brise a disparu, le moteur est éventré, la batterie pendouille hors du capot, les pneus sont affublés de lambeaux de tissus et de déchets végétaux.
Dans la petite rue conduisant à la gare, les magasins ont été submergés presque jusqu’au plafond. Les grilles ont été forcées de l’intérieur quand la crue est ressortie en tourbillonnant. De vastes portions de chaussée ont été labourées. Il s’agit surtout de modestes échoppes. Des rangées de vêtements bon marché, dégorgeant de crasse, jonchent chaque côté de la rue. La boue, sous le pied, crisse de verre pilé. Devant une pellicceria, des fourrures spongieuses gisent çà et là, tels de pauvres chats noyés. Ici, les visages sont hagards. Les gens regardent les passants d’un œil mort, découragés par l’insurmontable perte.
Sur la place de la gare, la trace de l’eau est à deux mètres du sol. Briques arrachées et pavés descellés rendent la marche périlleuse. La gare elle-même domine le désastre, mais on peut se représenter le passage de l’eau en observant les rangées d’arbustes et de balisiers dont l’état matérialise la crue : aux broussailles sans vie, qui ont l’air d’avoir baigné dans le goudron, succède, dans la partie supérieure du jardin, une portion encore verte, ponctuée de fleurs rouges.
De petits attroupements de curieux se sont formés aux entrées des deux longs passages souterrains qui traversent la place. On se représente mieux comment la crue s’est déversée dans ces boyaux, aspirant tout sur son passage, à la vue des profonds bassins noirs où s’enfoncent les rampes d’accès et d’où émerge le plus incroyable enchevêtrement de troncs et de voitures, plongés cul par-dessus tête dans un marais de pétrole et d’immondices. Sous terre, des échoppes et des cafés bordaient ce passage piétons ; il se murmure, parmi la poignée de témoins, que vingt-quatre personnes seraient restées prisonnières des eaux qui s’engouffraient par chaque bout, ou qu’elles auraient été fauchées par le courant dans le square, puis emportées et noyées au fond de ces culs-de-sac. Mais ce ne sont que rumeurs, comme partout. On ne sait vraiment plus que croire. Toutefois, l’énorme bouchon d’arbres et de voitures retournées, devant les larges bouches des deux tunnels, prouve assez que rien de ce qui pouvait être emporté n’a résisté à la marée. Le piéton qui avait le malheur de se trouver dans le square n’avait aucune chance de résister à la force d’aspiration des eaux.
Ventiquattro persone sepolte, colporte le bouche-à-oreille. Era una trappola. [Vingt-quatre personnes ensevelies. Un véritable piège.]
Un soleil radieux baigne ce paysage de désolation. Je grimpe vers la gare sous ses chauds rayons et pénètre dans le hall. Le sol de marbre est zébré de longues traces boueuses laissées par les passants. Même si personne n’est venu attendre un train, puisqu’il n’y a plus de trains. Un lac de plusieurs kilomètres recouvre la campagne environnante.
De l’extrémité de la gare, le Lungarno n’est plus qu’à quelques pâtés de maisons. Mais au premier coup d’œil, il est clair qu’il n’y a aucun moyen de rejoindre le fleuve. Car entre les deux s’étend la cuvette du Prato, lequel n’est plus qu’une mer d’eau bistre sur laquelle évoluent les canots pneumatiques des équipes de secours. Les pompiers apportent du pain et de l’eau aux personnes coincées aux étages des maisons dont le rez-de-chaussée est encore submergé.
Je me dirige péniblement vers l’est en tentant d’emprunter les rues latérales l’une après l’autre, mais à chaque fois une chaussée inondée ou des hommes chaussés de bottes, longeant la lagune, me forcent à faire demi-tour. Je passe devant une boulangerie, reconnaissable au monceau de farine gluante repoussée sur le trottoir, pâtée répugnante d’où dépassent des ustensiles cassés, ainsi qu’une paire de balances disloquées. Chacun des innombrables petits objets familiers éparpillés dans la boue raconte une tragédie particulière : un patin d’enfant, l’interminable ruban rouge et noir d’une machine à écrire, une peinture à l’huile, une chemise de nuit, une paire de lunettes tordues.
Tandis que je rebrousse chemin dans la troisième des rues adjacentes, je suis abordée par un jeune Italien en caoutchoucs, élégamment vêtu, qui me demande s’il est possible de traverser. Les hommes en bottes rient amèrement en regardant nos pieds. Nous nous éloignons avec un geste d’impuissance. Ce jeune homme est descendu à pied de sa maison, dans les collines de Fiesole. Il est très inquiet pour la famille de son frère, qui habite de l’autre côté de l’Arno, or il n’y a pas d’autre solution que de s’y rendre à pied, si tant est qu’on le puisse. À mesure que nous progressons lentement de rue en rue, de ruine en ruine, son anxiété croît à vue d’œil. Il n’est pas tranquille, n’ayant pu avoir son frère au téléphone. Or, celui-ci vit en zone inondable avec de jeunes enfants. Cependant il conserve dignité et courtoisie, m’aidant à franchir les trous de boue les plus pernicieux, comme si nous étions deux amis sortis faire une agréable passeggiata. Je repense aux nombreuses manifestations de générosité et de civilité dont j’ai été témoin aujourd’hui, d’autant plus révélatrices que les Florentins peuvent être gens cassants et ne sont en tout cas pas renommés pour leur patience. Je n’ai vu personne s’arracher les cheveux ou céder à l’emportement ; l’attitude générale était plutôt à la gravité et à la retenue. Une capacité à accueillir dignement les pires désastres, sans cris et sans pleurs, un souci de ne pas se donner en spectacle, une conscience de la douleur d’autrui ont dicté à tous de taire leurs souffrances et d’afficher le masque du courage, où seuls les yeux trahissent des océans de désespoir. Bisognafare la bella figura : cette devise florentine ne m’a pas toujours paru digne d’admiration. Mais force est d’admettre aujourd’hui que ce flegme, face à la tragédie, est la preuve qu’une certaine solennité n’est pas l’apport le moins utile de la civilisation, et que le sens des convenances, lorsqu’il est partagé par tout un peuple, peut se révéler une grande force.
Tout en haut de la Via délia Scala, à la caserne militaire, nous rencontrons les premiers signes tangibles de l’arrivée des secours dans la ville sinistrée. C’est une file de voitures et de camions bondés de soldats en tenue camouflée, mais qui semblent n’avoir reçu aucun ordre, ouvrent de grands yeux en sautant des véhicules et forment de petits groupes désœuvrés dans la rue. Un lieutenant finit par apparaître à la porte et fait signe à un des groupes de le suivre à l’intérieur.
Nous voici de nouveau sur les hauteurs, mais lorsque nous rejoignons l’avenue bordée d’arbres menant au Ponte della Vittoria, celle-ci nous apparaît presque impraticable, croupissant de part et d’autre dans une profonde gadoue et jonchée sur toute sa longueur de voitures et de camions empilés les uns sur les autres, dans un carambolage géant provoqué par la crue – carrosseries cabossées, fangeuses, portes et toits arrachés -. Un grand camion poubelle de couleur grise a replié un autobus Sita rouge comme un simple ballon crevé. On ne peut marcher que sur les traces des voitures qui ont réussi à rouler jusqu’au pont ; partout ailleurs, la boue est si visqueuse de mazout que l’on risque de s’étaler à chaque pas.
Quelques voitures parviennent à circuler, mais avec prudence, bien loin des habitudes de conduite de ces casse-cou d’Italiens. Nous tâchons de patiner hors de leur passage, pas assez loin toutefois pour empêcher leurs pneus de nous cracher des jets de boue jusqu’aux genoux. Mais y a-t-il une seule personne encore propre à Florence ? Il y a belle lurette que mon manteau est maculé et que mes gants sont mazoutés. Les jambes de l’impeccable pantalon à pli de mon camarade sont toutes mouchetées et les revers sont encroûtés.
Pas d’autre solution, après le dernier carrefour, que de patauger jusqu’au Lungarno en glissant et dérapant dans d’interminables mares de vase et de cambouis. Enfin, nous atteignons le quai ensoleillé, désert et silencieux. Au pied de la muraille roulent et grondent les eaux toujours puissantes de l’Arno. Un hélicoptère passe en bourdonnant au-dessus du fleuve, à basse altitude.
Notre petit palais bruisse de rumeurs et de nouvelles. Tous les grands hôtels ferment les uns après les autres – le Grand, le Villa Medici, l’Excelsior, l’Anglo-American. Les cuisines et les chaufferies sont noyées, les halls sont des champs de boue et, faute de lumière, de chauffage, d’eau courante et de nourriture, l’accueil de la clientèle est tout simplement impossible. L’épouse du professeur, qui s’est rendue au consulat des États-Unis, y a vu des centaines de touristes qui cherchaient à partir. Certains, rapporte-t-elle en rougissant, étaient prêts à payer pour être évacués – comme si l’argent pouvait être d’une quelconque efficacité lorsque les trains sont cloués au sol, que l’Autostrada del Sole est toujours lagata et que le monde extérieur est tout simplement hors de portée.
Les dégâts en ville sont considérables. Les magnifiques églises ont terriblement souffert. On déplore la perte de chefs-d’œuvre inestimables – fresques, huiles, sculptures -. Les soubassements du Duomo sont fragilisés et son dallage menace de s’effondrer ; il est interdit d’y pénétrer. Le campanile de Giotto est en péril. Tout risque d’écroulement du Ponte Vecchio n’est pas écarté ; la moitié des joailliers du vieux pont ont tout perdu.
L’ex-consul général et sa femme se sont rendus, eux aussi, au consulat américain, à deux portes d’ici. Ils y ont rencontré un de leurs amis italiens, le directeur des grands ateliers photographiques Fratelli Alinari, dont nous avons vu les locaux saccagés ce matin. L’homme, en désespoir de cause, était venu demander conseil. Son magasin est situé du côté du fleuve où les murs de soutènement se sont effondrés. À cet endroit, les bâtiments ont reçu de plein fouet les assauts de la crue. Le fleuve s’est littéralement déversé dans le magasin, avec une puissance telle qu’il a arraché une cheminée en marbre et balayé tables et comptoirs jusque dans les pièces du fond ; puis, ressortant par où il était entré, il a emporté avec lui cadres, lampes, tables et caisses, charriés des réserves jusqu’aux pièces sur rue. Tous les livres de comptes et de commandes, ainsi que des centaines de colis sur le point d’être expédiés aux États-Unis pour Noël, ont été retrouvés gisant pêle-mêle dans l’eau et la boue, absolument irrécupérables. Les adresses étaient effacées, les grands registres réduits à l’état de bouillie, à jamais illisibles.
Que faire ? demandait le directeur, les larmes aux yeux. Comment alerter nos clients ? Que vont-ils penser de nous ? Nous n’avons même plus trace de leurs noms !
En somme, il était venu faire savoir à l’Amérique que son entreprise ne trahissait pas ses engagements vis-à-vis de ses clients, mais que la situation était désespérée et qu’il n’avait aucun moyen de les prévenir.
Nous sommes tous tétanisés, hantés par les scènes de dévastation dont nous avons été témoins, par les visages cruellement blessés que nous avons vus. Nous n’avons pas vraiment d’informations, à proprement parler ; tout n’est encore que rumeurs, et nous sommes coupés du monde extérieur tout autant que de la vérité. Quoique l’eau ait reflué, Florence est toujours isolée au milieu de sa campagne inondée. Quelques véhicules amphibies de l’armée ont réussi à entrer en ville, mais rien ne peut en sortir, pas même le courrier ou les télégrammes. Les bureaux de poste sont inondés et les câbles télégraphiques sont à terre.
Dimanche 6 novembre […]
Toute vie normale semble arrêtée en ville. Les situations d’urgence se multiplient au lieu de décroître. Dans les quartiers pauvres et dans les campagnes, des gens sont encore naufragés sur les toits, dans l’attente des secours, tandis que les murs des maisons s’écroulent et que les toits commencent à ployer. Dans certains endroits, les câbles électriques et les antennes de télévision rendent impossible tout secours par hélicoptère : au moindre contact, l’appareil serait perdu. Le bruit court que deux vieilles paysannes, ne sachant pas comment boucler le harnais de secours descendu par l’hélicoptère en vol stationnaire, auraient glissé de l’élingue pendant le treuillage et seraient mortes écrasées au sol. (On apprendra plus tard qu’il s’agissait d’une seule vieillarde, mais le fait est avéré. Ce qui n’empêchera pas la rumeur de s’en tenir à deux.)
Les premières estimations du nombre d’œuvres d’art dégradées ou perdues sont effrayantes. Les conservateurs ont lancé un appel à l’aide pressant pour sauver peintures et manuscrits. Et l’on est encore loin de tout savoir. La chapelle des Médicis est sous l’eau. Les cloîtres de la Santissima Annunziata sont inaccessibles. Les fabuleuses collections d’instruments anciens du musée Bardini pourraient bien être détruites à jamais. Les situations les plus critiques sont simplement mentionnées, faute d’informations sur les cloîtres de la Santa Croce, la maison Buonarroti où sont conservés les dessins de Michel-Ange… L’eau interdit tout accès aux archives de la ville, qui remontent à l’Antiquité et étaient conservées sous le niveau du sol, tout comme les immenses entrepôts de la Bibliothèque nationale, au bord de l’Arno. Les manuscrits enluminés du musée du Duomo mijotent dans une soupe de boue. Des secours sont réclamés de toute urgence. Pourvu que l’aide ne tarde pas trop, beaucoup peut encore être sauvé, car l’argent ne manque pas.
On se raconte le combat héroïque des conservateurs et de cette poignée d’employés des Offices qui ont bravé la montée des eaux pour rejoindre les galeries du musée, certains ayant lutté plus de deux heures contre le courant pour traverser les rues, et qui, tout un jour et toute une nuit, sans manger ni s’arrêter, se sont mis en quatre pour remonter les chefs-d’œuvre des étages inférieurs et des ateliers de restauration où l’eau s’accumulait. Parmi tant d’autres, un Masaccio et un Filippo Lippi ont été mis hors de portée des eaux, tandis qu’un monumental Giotto, trop lourd à porter, a dû être hissé sur un échafaudage où la crue n’a pu qu’en lécher le bord. Le professeur Procacci, directeur des galeries florentines, plutôt que de faire courir un risque au personnel, a préféré jouer sa propre vie en sauvant lui-même les centaines de portraits irremplaçables accrochés aux murs du corridor menant des Offices au palais Pitti sur le Ponte Vecchio vacillant. Le Dr Baldini, chargé des restaurations, et le Dr Becherucci, conservatrice de la Galerie des Offices, ont également fait des miracles au péril de leur vie. Aux premières lueurs de la journée du 5, l’eau ayant reflué, ne leur restaient que les larmes pour regretter de n’avoir pu faire davantage et pleurer les merveilles qu’ils n’ont pu sauver, telles ces œuvres entreposées dans les ateliers en sous-sol, où la crue est entrée la première. Les Florentins, qui n’ont jamais considéré que les trésors artistiques de leur ville leur appartenaient, se considèrent comme les gardiens d’un héritage inestimable qui est le bien commun de l’Occident.
Dans son compte rendu des pertes artistiques pour La Nazione, Giorgio Batini écrit : Nous ne pleurons pas comme des enfants, mais comme des hommes rompus au combat, qu’une catastrophe incommensurable vient de jeter à terre, un désastre qu’aucun mot ne saurait traduire.
[…] La seule chose positive dans cet indescriptible foutoir, déclare amèrement notre professeur, c’est qu’on ne voit mouliner aucune caméra de télévision ni se balader aucun reporter tendant son micro. Vous imaginez le tableau ? Un de ces types sans scrupule s’approchant d’un malheureux petit commerçant, encore sous le choc, dont tous les biens gisent sur le trottoir dans la gadoue, et lui demandant l’air de rien : Qu’avez-vous ressenti quand c’est arrivé ? Ce serait obscène…
[…] Hormis le travail inlassable de ces milliers de bras, il semble que rien ne soit mis en œuvre pour nettoyer et dégager les rues obstruées. Tout reste où on l’a jeté. Il paraît que la commune ne possède qu’une seule pelleteuse.
Seules les pompes, qui désemplissent ici et là les caves inondées, témoignent de l’action communale. Car les sous-sols de Florence forment toujours un lac souterrain. Mais la ville ne dispose que de cent cinquante pompes pour une zone densément bâtie d’environ 2,5 km², soit une population de plus de cinq cent mille habitants ; or il faut toute une journée pour pomper une seule cave. Et tous les efforts se concentrent en premier lieu sur les grands édifices publics où livres et documents inappréciables, toujours submergés, commencent à se décomposer. La Bibliothèque nationale, le long de la portion de quais effondrée, dont les collections uniques de livres et de manuscrits rares sont entreposées sur d’immenses rayonnages sous le niveau du sol, est l’un des premiers bâtiments vidangés ; il n’y reste plus qu’un demi-hectare de fango…
Partout, cette matière est visqueuse de fioul. Nous apprenons aujourd’hui que celui-ci s’est échappé des chaufferies des grands immeubles qui ont explosé sous la pression de la crue et dont l’épais combustible a répandu cette écume invasive à la surface des eaux, puis dans toute la ville. Dans les rues étroites, la boue commence à dégager des relents d’ordures en décomposition, de denrées avariées et d’eaux usées. Elle pénètre dans les chaussures, s’insinue dans les bottes, tache les bas et n’est pas du genre à s’essuyer à l’eau froide, surtout s’il n’y en a qu’un demi-litre et qu’on ne peut pas acheter de savon. Mais il se trouve qu’hier soir, frigorifiée, alors que j’ouvrais une malle à la recherche d’un édredon pour mon lit, j’y ai trouvé au sommet de la pile, bien emballée dans du plastique, ma paire d’après-skis dont j’avais oublié l’existence. Grâce à cet heureux hasard, je peux traverser des océans de boue hier infranchissables.
Je traverse donc. Dans nombre de rues les pompes sont en action et les caves se vident. De loin en loin, grâce aux jets d’eau jaillis des tuyaux d’évacuation, j’arrive à détacher les paquets de boue qui alourdissent mes semelles – opération bonne à recommencer au bout de cinq mètres. Mais ces fontaines sont destinées à des besoins plus vitaux que le nettoyage des bottes. A chaque sortie d’eau attendent des groupes de femmes et d’enfants munis de seaux, de baquets, de jarres en cuivre ou, très souvent, d’un simple lot de bouteilles au fond de filets. Ils font la queue pour se procurer cette précieuse eau de crue avec laquelle ils s’en vont laver les sols, ramollir la boue, décrasser les murs et nettoyer les rares objets intacts susceptibles d’être sauvés, jusqu’à ce que l’eau elle-même ait la consistance de la boue et doive être évacuée à son tour.
Dans chaque rue, on voit passer de petits cortèges de porteurs d’eau munis de tous les récipients imaginables.
[…] On sait d’ores et déjà qu’une centaine de tableaux ont disparu, et que trois ou quatre cents autres sont endommagés – mais à quel point ? -, parmi lesquels un Lorenzo di Michelino, un Bicci di Lorenzo, un Neri di Bicci. Les fresques détrempées commencent à cloquer. On a appris qu’un Botticelli et un Tiepolo font partie des tableaux qui ont pu être sauvés aux Offices, pendant la crue, au prix d’interventions héroïques.
Mais c’est toute la vie de Florence qui est en phase critique, comme tétanisée. La moitié des installations industrielles seraient détruites (estimation exacte, comme on l’apprendra). Tous les artisans ont été victimes d’inondations, leurs outils, leurs matériaux, leurs créations ont été emportés ou saccagés. Les ouvriers sont à la rue, dans le froid, les locaux où ils travaillaient ont disparu et bon nombre de ces hommes n’ont plus de toit. Les localités voisines sont elles-mêmes toujours inondées, les fermes ont été rayées de la carte, les champs, les vignes et les vergers gisent sous des nappes de boue, des milliers de têtes de bétail ont été noyées. Sur certaines autoroutes, les voitures sont toujours bloquées dans l’eau. Quant à la ville, ensevelie sous une épaisse couche de boue, plongée dans le froid, le noir et la faim, elle semble à l’abandon. Nous n’avons encore vu aucun véhicule de la Croix-Rouge.
La situation paraît complètement désespérée.
Ora povera Firenze, dit notre petite Signora d’une voix tremblante. Povera Firenze !
Ce soir, la radio de Rome annonce d’une voix neutre un retour à la normale à Florence – alla normalità.
Mercredi 9 novembre
Quelle normale ?, demande La Nazione en première page, dans un éditorial rageur conçu pour secouer la torpeur des services de l’État qui, à Rome, aussi sûrs d’eux que mal informés, tiennent pour certain qu’il n’y a plus de problème à Florence, puisque l’eau a reflué. Voici deux jours que la capitale a tranquillement décrété le retour à la normale, de telle sorte qu’un flot de voitures d’amis et de parents, persuadés que tout est rentré dans l’ordre, ont créé un gigantesque embouteillage aux abords de la ville, toujours impénétrable, et compliquent l’accès des véhicules de secours.
Le maire, Piero Bargellini, un homme réfléchi dont la maison a gravement souffert de la crue, vient d’adresser au gouvernement, ainsi qu’aux villes italiennes, un pressant appel à l’aide. La ville a besoin d’engins de terrassement pour dégager l’épaisse couche de boue et de détritus sous laquelle elle est ensevelie. La survie de Florence dépend de l’arrivée urgente de bulldozers, de décapeuses et de camions à benne. Deux bataillons du génie sont en train de déblayer les zones les plus touchées, mais ils manquent d’outils appropriés, tout comme la population elle-même.
Comment pourrions-nous venir à bout de cette masse liquide avec de simples pelles ? plaide le maire, dans l’espoir presque vain qu’une oreille officielle l’entendra.
Pour ce qui est de la nourriture et de l’eau potable, la situation s’arrange plus ou moins. Les gens attendent patiemment leur tour devant les centres de distribution. Les épiceries inondées ont rouvert, sur ordre de la ville, mais les produits en paquet, la farine et les pâtes, sont irrécupérables.
[…] Dès la fin de l’après-midi, grâce au labour des énormes engins, semblables à des troupeaux d’éléphants, troncs d’arbres, carcasses de voitures, dunes de boue et déchets encombrants ont presque disparu d’un grand nombre d’artères du centre-ville. Il est heureux que le travail ait commencé ici, où bat le cœur même de Florence. Ces opérations de déblayage apportent une bouffée d’optimisme aux habitants, même s’il reste des kilomètres de rues et de ruelles à nettoyer, tâche qui devrait prendre encore plusieurs semaines. Même dans les rues du centre, maintenant dégagées, dix bons centimètres d’eau bourbeuse stagnent entre les trottoirs. Non loin du Ponte Vecchio, on barbote encore dans un vrai marécage, une boue liquide, grasse et pestilentielle.
Peggio délia guerra [4] , râle un homme en traversant ce racahout, mais il n’a pas l’air en colère.
Si la situation n’avait pas été si catastrophique ces jours derniers, les dégâts et la malpropreté nous paraîtraient encore insurmontables ; mais l’arrivée des secours a rendu le sourire à notre petit monde.
Dans ce secteur de la ville, pelles et brosses géantes repoussent et déplacent de tous côtés. Des camions à benne s’en vont en file indienne, chargés de montagnes de boue compacte, de pavés, de branches et de déchets sortis des maisons et des boutiques. On peut lire, sur les portes des cabines, des inscriptions en lettres noires et banches : COMUNE DI RlMINI soccorso a Firenze ; Comune di Forli – soccorsi a Firenze (alors que Forli elle-même a été inondée) ; MlLANO soccorso a FlRENZE. L’une après l’autre, les villes italiennes répondent à l’appel. Les services d’entretien routier des zones montagneuses, au nord, ont envoyé des chasse-neige ; quant aux équipements les plus importants, ils proviennent d’aussi loin que la Suisse et l’Allemagne, entre autres.
Les pompiers de Florence ont accompli des prodiges, travaillant souvent jour et nuit depuis le premier jour pour sauver des vies, porter secours, transporter les malades ; et les hommes de la Misericordia ne sont pas en reste. Deux sources d’infection potentielles, la halle aux poissons et le marché aux viandes, ont été nettoyées par les pompiers, qui ont dû y pénétrer avec des masques à gaz pour évacuer à la pelle des tonnes de poisson et de chairs animales putréfiées, en quantité suffisante, lorsqu’elles étaient fraîches, pour nourrir un demi-million de personnes.
Un vent d’espoir semble ranimer la ville. Dans la rue, un adolescent passe près de moi en chantant gaiement. Pelles et balais continuent de virevolter dans toutes les mains, et si les gens ont l’air tout aussi déterminés qu’aux premiers jours, les plus cruels, ils sont aussi un peu moins abattus. Ils haussent les épaules en disant : Pazienza. Et ils sourient.
[…] Car la vraie misère, elle, se fait plus criante de jour en jour. On compte six mille foyers sans abri ; des milliers d’ouvriers sont sans travail, les machines sont détruites dans les ateliers et les marchandises en attente d’expédition sont bonnes à jeter. Il faudra des mois, peut-être des années pour tout remettre en état. En attendant, ces personnes restent inemployées, sans avenir au milieu du désastre, et elles réclament des aides publiques.
Un ami qui fait office d’agent auprès des artisans et leur garantit des commandes sur le marché américain me rapporte que tous ses clients ont été inondés. Il est incapable de dire quand le travail pourra reprendre. Jour après jour, il passe les voir dans leurs échoppes fangeuses où le nettoyage ne progresse qu’au ralenti. Le froid raidit les mains ; le soir tombe à seize heures et, faute d’électricité, il est impossible de travailler la nuit. Les outils ont disparu et, Noël approchant, les chances sont minces qu’ils puissent honorer les commandes à temps ; quand bien même, au prix d’efforts extraordinaires, ils parviendraient à en satisfaire quelques-unes, il y a fort à parier qu’elles auront été annulées et que ces marchandises leur resteront sur les bras. Ces artisans, m’assure-t-il, ne pleurent pas sur le lait versé, même si l’heure a sonné pour eux d’évaluer leurs pertes et d’estimer le peu qu’il leur reste.
On n’entend personne se plaindre. Le sentiment s’est spontanément fait jour, chez tous ces gens, qu’ils endurent une seule et commune épreuve et qu’ils sont tous embarqués dans le même prodigieux effort pour survivre et rebâtir leur vie ; faire état de dommages individuels serait une façon de se désolidariser, de même que réclamer un traitement privilégié serait perçu par tous comme choquant et malvenu. Cette épreuve, ils la traverseront ensemble.
La ville commence, elle aussi, à estimer l’ampleur du sinistre. Six mille des dix mille boutiques de Florence ont été balayées. Dix mille voitures, surprises au cœur de la ville, sont embouties ou bonnes pour la casse. Le nombre d’œuvres d’art abîmées ou perdues se monte désormais à mille trois cents. Il n’y a aucun espoir de sauver le Crucifix de Cimabue. Et des millions de livres sont couverts de boue.
Neuf des dix facultés de l’Université de Florence sont gravement endommagées et leurs bibliothèques anéanties. Cette Université n’a jamais été riche ; et maintenant, voici que le système d’éclairage et de chauffage est détruit, que les équipements scientifiques et les infrastructures sont inutilisables, les laboratoires de chimie entièrement rasés. Les pertes sont estimées à dix milliards de lires. Là aussi, les étudiants payent de leur personne pour débarrasser les bibliothèques de leur chape d’eau et de boue, mais la remise en état des livres aura un coût incalculable. Quelque onze mille étudiants ne devraient pas reprendre les cours avant janvier.
Les monuments publics les plus abîmés sont l’ancien Palazzo di Parte Guelfa, l’église de San Firenze, le monastère de la Badia et la maison de Dante. Mais, Dieu merci, les magnifiques tombeaux de Michel-Ange, dans la chapelle des Médicis, sont indemnes. Et bien que la Carminé ait été inondée, la Cappella Brancacci, qui renferme les fresques de Masaccio et Filippino, a surnagé. Les majestueuses galeries des Offices et du palais Pitti, bien sûr, sont trop hautes pour avoir été inquiétées. En revanche, les dégâts à la Santa Croce sont effrayants ; l’énorme vague est entrée dans l’église et a envahi les cloîtres en tourbillonnant comme une hélice, formant un lac bouillonnant qui a vite atteint les chapiteaux des piliers, souillant et vandalisant au passage quelques-uns des grands chefs-d’œuvre de la ville. Les magnifiques intarsias du Quattrocento tombent en morceaux ; l’église ravagée et les cloîtres offrent un spectacle de cataclysme.
Lorsque je suis passée au consulat américain cet après-midi, un vieil Italien aux larges mains noueuses et calleuses de travailleur, les traits tordus d’inquiétude, est entré et s’est mis à réciter d’une voix plaintive la litanie de ses malheurs : sa maison avait été littéralement mise à sac, il ne lui restait ni matelas, ni meubles, ni vêtements, tout avait été fracassé ou emporté. Sa fille et sa toute petite-fille étaient sauves, il n’en remerciait pas assez le Seigneur, mais maintenant ? Comment les nourrir, comment s’occuper d’elles ?
- Qui voudra m’embaucher, maintenant que plus personne n’a les moyens de recruter un employé ?
- Et d’ajouter lugubrement :
- Destituzione.
Il était jardinier, s’est contentée de m’indiquer la secrétaire.
[…] Samedi 4 mars
Dans ce crépuscule de printemps, la cité, offre l’apparence d’une fleur rose, et de là vient, bien entendu, son nom de Fiorenza, la ville en fleurs, la cité des lys rouges flamboyant sur ses blancs écus. Lys qui, hier noyés mais solidement enracinés dans la boue, refleurissent vaillamment. Quel meilleur présage que le spectacle de cette ville épanouie sous un ciel rougeoyant ?
Me reviennent en mémoire les jours de boue, d’horreur et de puanteur ; jours de besogne opiniâtre et solitaire dans le froid, l’humidité et la désolation. Je revois les étudiants radieux statufiés par le fango, les marchands d’art, de l’eau jusqu’à la taille, luttant pour sauver leurs tableaux. Je songe au degré de civilisation d’un peuple qui se réjouissait du sauvetage d’un Botticelli tout en répugnant à verser une larme sur son propre sort. Je me rappelle l’extrême courtoisie, la curiosité bienveillante et attentive qu’ils se manifestaient les uns aux autres, comme à ceux qui, comme nous, vivaient parmi eux, une forme d’obligeance presque oubliée avec les années de prospérité, mais que l’on voit aujourd’hui regagner du terrain, ingrédient primordial de cette seconde vie. Je revois les patientes files d’attente pour le pain et l’eau, et cette femme qui me lançait : Bisogna cantare ! Je me souviens de ce vaillant petit écriteau : APERTO – SI RICOMINCIA et de cet humour désabusé qui trouvait le moyen de se nourrir du désastre, les pancartes annonçant des BAINS DE BOUE dans les rues transformées en marais. Je me rappelle ces deux jeunes hommes qui avaient tout perdu et qui disaient : Sono molto contento. Nous sommes fortunatissimi. Je me dis que Florence, malgré ses blessures, et elles sont profondes, peut compter sur une richesse : ses habitants, leur fière éducation, le choix qu’ils font, lorsque tout paraît sombrer, de sauver avant tout ces deux fermes cadeaux de la vie que sont à leurs yeux la créativité et l’intégrité. Sans oublier leur inépuisable courage. Il m’apparaît alors que l’un des premiers citoyens de Florence, je veux dire Dante, s’il lui avait été donné d’observer la réaction de ses concitoyens dans ces mois d’angoisse, leur aurait pardonné tout ce qu’il a pu leur reprocher ; il aurait vu s’accomplir en eux son propre idéal d’exigence, d’orgueil et d’amour invincible. J’aime à croire qu’il leur ferait l’honneur des lauriers qu’il décernait à l’ancienne Fiorenza, que lui-même n’avait pas connue :
A cosï bello viver di cittadini… a cosï dolce ostello [5].
Kathrine Kressmann Taylor 1903-1996. Journal de l’année du désastre. Autrement 2012


À Venise, c’est l’Acqua alta la plus forte jamais vue, avec 1.94 m, 1.20 m sur la place Saint Marc, ci-dessous. Une tempête sur l’Adriatique est venue s’ajouter au scirocco, détruisant en partie le murazzi, un mur de 10 km de long sur l’île Pellestrina, construit au XVIII° siècle.


26 11 1966
Inauguration de l’usine marémotrice de la Rance, munie de 24 groupes bulbes de 10 MW chacun, fournissant de l’électricité à marée montante et descendante ; la conception était sans doute très bonne, mais cet électricité se révélera être la plus chère, les coûts de fonctionnement, essentiellement le nettoyage des alluvions, ayant été nettement sous estimés.
Mais, contrairement aux commentaires plutôt exaltés du moment : génial, visionnaire, fantastique etc… il est parfaitement faux de voir quelque originalité et nouveauté dans cette idée, qui en fait, date … des Romains : c’est sous l’empire romain que le premier moulin à marée a été construit sur la Fleet, un affluent de la Tamise à Londres. L’Europe entière s’en est équipée ensuite au Moyen Âge, de l’Espagne atlantique à la Scandinavie. On en compte à peu près 70 en France. Le coût en était important, car nécessitant la construction d’une digue pour constituer un bassin de retenue des eaux à marée haute, mais on était certain des marées … on l’est moins du vent. Aujourd’hui les seuls à être opérationnels le sont à titre historique, car, le plus souvent ils étaient situés sur un estuaire ou une embouchure et donc mettaient fin à la vie naturelle ; de plus se posait déjà le problème qui tuera l’usine de la Rance : le dépôt des alluvions et le coût de leur enlèvement. L’éolien prendra vite le pas sur le marin.

Île de Bréhat. Moulin dy Birlot

Un demi-siècle plus tard, le bilan est plutôt globalement négatif : […] Avant, il n’y avait que du sable, de la berge jusqu’au chenal, se souvient Pierre Yves Chevestrier. Millimètre par millimètre, la vase s’est déposée. Pourtant, ici, on est relativement préservé grâce aux vents et aux courants. A certains endroits de la ria, classée Natura 2000, les sédiments s’entassent sur plusieurs mètres de haut, jusqu’à rendre la navigation périlleuse. Régulièrement, des plaisanciers manœuvrant du mauvais côté d’une bouée de l’étroit chenal s’enlisent. Ces dix dernières années, ils fuient l’estuaire. Le port de Dinan a vu son activité chuter de 40 %. La situation est grave, observe Didier Lechien, maire de Dinan (UDI) et président de Cœur émeraude, association défendant le classement de la vallée en Parc naturel régional. La Rance doit être la colonne vertébrale de ce parc. Pourtant, on continue à mener une politique de l’autruche quant à son envasement… Comme la majorité des élus locaux et des associations de riverains, il reproche à l’Etat et à EDF d’avoir ignoré les conséquences de l’activité de l’usine marémotrice de la Rance. Propriété de la France exploitée par l’entreprise énergétique, ce fleuron de l’industrie tricolore des trente glorieuses produit, depuis son inauguration en 1966, 17 % de la production d’énergie bretonne, ou encore suffisamment d’énergie renouvelable pour satisfaire les besoins en électricité d’une ville de 220 000 habitants comme Rennes. Ce prototype, copié à une seule reprise en Corée du Sud, profite de la marée naturelle montante pour faire tourner ses vingt-quatre turbines et retenir l’eau de l’autre côté du barrage, pour la vidanger ensuite afin d’actionner à nouveau ses machines. Ce jeu de flux et de reflux modifie les courants, accélère la durée de remplissage de l’estuaire, qui conserve parfois un niveau de pleine mer pendant plusieurs heures. Résultat : son envasement, le développement de polders, la disparition de plages, la mue de la faune et la flore… Extraction laborieuse Après des décennies à qualifier cette sédimentation de naturelle, EDF a finalement reconnu sa responsabilité à la suite de la publication en mai 2017 d’un rapport du Commissariat général à l’environnement et au développement durable. Le document réclamait que le niveau d’ambition sur le plan de l’état écologique du plan d’eau ne soit pas moindre que celui qui porte sur la production d’énergie renouvelable. Les experts proposaient un programme quinquennal préconisant une extraction annuelle de 50 000 m³ de sédiments et la mise en place d’un comité scientifique chargé d’imaginer des actions pour endiguer le phénomène. Mais, selon l’association Rance environnement, qui rassemble 600 adhérents, ce rapport minimise l’ampleur de l’envasement.
Un récent travail des bureaux d’étude Egis et Idra pour l’établissement public territorial de bassin (EPTB) Rance Frémur orchestrant le curetage de la ria, que Le Monde s’est procuré, estime que 3,65 millions de m³ de boue se sont déposés dans l’estuaire entre 2011 et 2018. C’est dix fois plus qu’annoncé en 2017. Ces données sont plausibles, mais incertaines. Nous avons besoin de davantage d’éléments pour affiner le constat. S’ils se confirment, ces résultats seraient… préoccupants, juge Pierre Le Hir, chercheur à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) et président du comité scientifique nouvellement formé. L’expert estime que l’activité de la centrale provoque au moins la moitié de la gangrène sédimentaire.
Pour EDF et l’Etat, hors de question de cautionner ces analyses. L’usine a une part de responsabilité qui n’est cependant pas quantifiable à ce jour. En attendant des études nouvelles fiables, je reste sur le compromis raisonnable de 50 000 m³ annuels, maintient Antoine Malafosse, directeur hydroélectricité Bretagne et Normandie à EDF. Dominique Consille, sous-préfète de Dinan, appuie : Le rapport de 2017 a déverrouillé une situation bloquée depuis des années. Travaillons à partir de cette feuille de route. Nous avançons bien. Cet optimisme tranche avec le scepticisme des différents acteurs impliqués dans le plan d’actions proposé en 2017. Son budget de 9,5 millions d’euros n’est toujours pas ficelé. EDF, qui assure que le barrage n’est pas rentable et rappelle avoir déboursé dix millions d’euros depuis 1990 pour l’entretien de l’estuaire, refuse d’assumer l’intégralité de la note. L’Etat, les collectivités territoriales et les différents organismes publics rechignent à compléter le budget. L’extraction préconisée de la vase se révèle laborieuse, de l’aveu d’Yves Chesnais, premier adjoint au maire de Saint Jouan des Guérets et président de l’EPTB : Cette année, nous allons évacuer… 9 000 m³. Si certains parlent d’échec, je ne veux pas en assumer la responsabilité. Je fais avec les moyens à ma disposition. Pas un désastre. Quant au Conseil scientifique, ce groupement d’une quinzaine de professionnels mobilisés bénévolement, mis en place en 2018, il attend que les études qu’il préconise soient financées pour cerner l’impact réel de l’usine sur son environnement, proposer un ajustement de ses conditions d’exploitation, repenser le dragage de la vase et la valorisation de cette substance considérée comme un déchet… Nous ne financerons pas toutes les demandes et prioriserons les plus pertinentes. Nous devons trouver une solution conciliant la production électrique, l’écologie, l’économie de la plaisance, celle de la pêche à pied et de la conchyliculture…, temporise la sous-préfète. L’envasement n’est pas un désastre. Cette matière peut même être écologiquement plus intéressante que du sable. Ces déclarations irritent le sénateur Les Républicains (LR) des Côtes d’Armor, Michel Vaspart, qui dit ne plus avoir confiance. L’élu a décidé de contourner l’Etat et EDF. Accompagné d’autres responsables locaux (LR et La République en marche, LRM), il a rencontré le commissaire européen à l’énergie pour faire reconnaître la production de la centrale comme renouvelable et imposer à EDF de la commercialiser plus chère que le tarif classique. Les élus veulent contraindre l’entreprise à utiliser cette nouvelle manne pour financer l’entretien de la Rance. Depuis des années, le ministère me disait que ce légitime changement de tarification était impossible. Le commissaire a été vite convaincu. Il était surpris de ne pas avoir été sollicité plus tôt par l’Etat…, s’agace Michel Vaspart, qui attend désormais le feu vert du ministère de la transition écologique. Tous ces atermoiements questionnent sur l’avenir de l’exploitation dont la concession s’achèvera en 2043. Et si l’ouvrage subissait le même sort que les autres symboles du génie industriel tricolore des années 1960 : le Concorde, Le Redoutable ou le France ? L’Etat et EDF refusent d’évoquer un possible arrêt du barrage qui subit actuellement un chantier de rénovation de 100 millions d’euros, sans pour autant écarter fermement cette hypothèse. Personne ne milite pour la fin de l’usine, conclut Jean François Mordrel, le président de Rance environnement. Nous voulons qu’elle fonctionne mieux. La production d’électricité verte ne peut pas se réaliser au détriment de l’environnement.
benjamin keltz. Le Monde du 21 08 2019
14 12 1966
L’aviation américaine bombarde Hanoï.
21 12 1966
Alunissage en douceur du vaisseau spatial Luna XIII.
1966
La femme devient juridiquement l’égale de l’homme. Edmonde Charles Roux est rédactrice en chef de Vogue depuis plus de 15 ans : elle impose une mannequin noire en couverture, quelques semaines après que le Vogue anglais l’ait fait : elle est virée ; en fait les motifs de son éviction tiennent aussi à ses relations trop à gauche au goût des patrons américains : Louis Aragon sent tout de même le souffre. Mais le préjugé raciste était bien là : il faudra attendre encore plus de 20 ans pour qu’une femme noire, Naomi Campbell fasse la Une de Vogue.
René Girard, philosophe français installé aux États-Unis, a invité Roland Barthes, Jacques Derrida, Lucien Goldmann et Jacques Lacan, qui reprend en arrivant, le mot de Freud à Ferenczi en 1909 : nous allons leur apporter la peste.
Inauguration du pont de l’île d’Oléron… qui n’aura jamais eu de permis de construire. L’Académie française de médecine se prononce pour une nouvelle définition de la mort, substituant l’inactivité cérébrale à l’arrêt cardiaque.
27 01 1967
À Cap Canaveral, Grissom, White et Chaffee meurent brûlés dans une capsule Apollo. Il s’agissait d’une répétition générale, avant la mission Apollo XI : un test au sol, en condition d’autonomie : la fusée ne contenait même pas de carburant.
Apollo 1 est un drame de l’impréparation. Comme le révélera l’enquête, tous les éléments étaient réunis pour une catastrophe. D’abord, des négligences dans l’électricité et la plomberie : un fil électrique dénudé tout près d’une tuyauterie du système de refroidissement à l’éthylène-glycol, qui était sujette à des fuites. Ensuite, une atmosphère pressurisée, dans la cabine, composée d’oxygène pur. Enfin, un cockpit tapissé de matériaux inflammables. Le cocktail Molotov revisité par la NASA. Si on ajoute à cela une porte difficile à ouvrir en cas d’urgence, on aboutit à trois morts par asphyxie – Grissom, White et Chaffee.
Pierre Barthélemy. Le Monde du 16 07 2019
Des négligences de ce type, il y en avait plein ; Apollo-1 a sans doute été un traumatisme nécessaire, qui a changé fondamentalement la donne chez tous les contractants et les sous-contractants : chaque détail devenait important, sinon c’était mort d’homme.
Alain Cirou, directeur de la rédaction du magazine Ciel & Espace.
01 1967
Mao Zedong parvient non sans mal à mettre fin à la folie des Gardes Rouges. Mais le mouvement lancé par la Révolution Culturelle, va encore durer 10 ans, pendant lesquels on estime à 17 millions le nombre de jeunes instruits qui seront envoyés à la campagne pour y être rééduqués par les paysans.
15 03 1967
Mise à l’eau du Redoutable, premier sous marin nucléaire français atomique lanceur d’engins – SNLE – : 128 m. de long, 10.6 m. Ø, 10 000 tonnes en plongée, appareil propulsif de 16 000 CV. 16 missiles nucléaires embarqués, de 2 500 km de portée. Chaque bombe a une puissance de 500 kilotonnes – 400 fois la puissance de la bombe d’Hiroshima -.
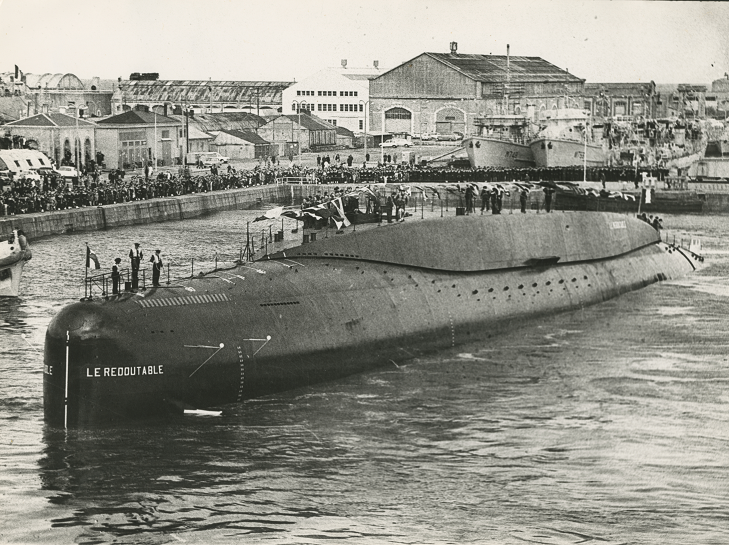


18 03 1967
Naufrage du Torrey Canyon sur Pollard’s Rock, du récif de Seven Stones, au large des îles Scilly, proche de la la Cornouaille anglaise ; c’est une des premières marées noires ; 77 000 tonnes iront saloper 180 km de côtes anglaises et, marée du siècle aidant, quelques plages des côtes nord de la Bretagne. On n’en a pas fini avec les marées noires : plus de 700 de par le monde au cours des 50 années qui suivent.


7 04 1967
Jacques Chirac entre au gouvernement de Georges Pompidou, comme Secrétaire d’État à l’Agriculture.
19 04 1967
Kathrine Switzer, américaine de 20 ans court beaucoup. Elle a décidé de faire le marathon de Boston, – interdit aux femmes – en s’inscrivant comme K.V. Switzer, Syracuse, pour tromper l’ennemi. Après le départ, Jock Semple, un des organisateurs, ayant réalisé le subterfuge, tentera de la faire sortir du parcours, mais son ami Tom Miler l’en empêchera et ainsi elle terminera la course, en 4 h 20’, presque une heure de plus que Bobbie Gibb, une autre femme, mais qui ne s’était pas faite inscrire. Cette entrée par effraction dans un monde jusqu’alors exclusivement masculin orientera toute sa carrière d’écrivaine conférencière.

Ciro Roberto Bustos, lieutenant de Che Guevara, Roth, journaliste anglais et Régis Debray, français de 26 ans, sont arrêtés à l’entrée du village de Muyopampa par l’armée bolivienne : ils vont être condamnés à 30 ans de réclusion. Le contenu de leur interrogatoire sera tenu secret : 40 ans plus tard, le secret tenait toujours. Bustos aura plus de mal que Debray à balader les militaires qui posaient les questions : il portait sur lui les photos de ses petites filles qui vivaient en Argentine : le chantage était dès lors facile. Bustos s’exilera à Malmö, en Suède et Régis Debray, libéré au bout de 4 ans, reviendra finalement en France, via le Chili de Salvador Allende. De Gaulle était intervenu :
Je ne l’ai jamais rencontré. Il était trop loin, trop haut. Il m’a pourtant sauvé la vie, sans me connaître. Quand j’ai été arrêté, en Bolivie, en 1967, il a télégraphié au général-président, qu’il connaissait un peu, sur le mode : Entre militaires, je vous le demande, ne tuez pas ce jeune fou. Ça a marché. Je n’ai même pas pu lui dire merci : quand j’ai été libéré, il était mort.
Régis Debray. Journal du Dimanche 4 04 2010
24 04 1967
Le colonel russe Vladimir Mikhailovich Komarov meurt, prisonnier d’un Soyouz 1 désemparé qui s’écrase sur la Terre, après 18 révolutions autour de la lune. Le lendemain aurait dû être lancé un Soyouz 2 avec 3 cosmonautes à bord, l’un d’eux faisant une sortie extra véhiculaire pour rejoindre Soyouz 1 : ce lancement sera annulé.
Les tests menés à vide sur la capsule Soyouz ont mis en évidence plusieurs dysfonctionnements mais peu importe, les autorités soviétiques veulent reprendre la main dans la course à l’espace, profiter du fait que les Américains aient eux aussi subi un coup d’arrêt après le drame d’Apollo-1[…]
Le 23 avril, Komarov décolle de la base kazakhe de Baïkonour. La suite, Alain Cirou et Jean-Philippe Balasse la narrent dans leur livre Les Hommes de la Lune (Seuil, 224 pages, 34,90 euros) : Très rapidement le vol dégénère, des systèmes vitaux tombent en panne et il faut interrompre la mission. Komarov a tout juste le temps de s’entretenir par radio avec sa famille avant de chuter comme une pierre et de s’écraser au sol. Le parachute ne s’est pas ouvert : le cosmonaute est tué. Le Soyouz, un des éléments de base du programme lunaire, n’est pas prêt. Si tant est que les Soviétiques ont vraiment pensé un jour être les premiers à aller sur la Lune, cet échec sonne le glas de leurs espoirs.
Pierre Barthélémy. Le Monde du 18 07 2019
27 04 1967
Exposition Universelle de Montréal. Jusqu’au 27 octobre, elle attirera 50 M. de visiteurs.
04 1967
Une junte de colonels analphabètes et dévoyés, – Jacques Lacarrière -, prend le pouvoir en Grèce.
Philips sort un disque L’amour et la vie, sur l’éducation sexuelle des jeunes qui reçoit le meilleur accueil de l’ensemble de la presse écrite. L’auteur principal en est un certain Paul Berthet… qui n’est autre que le milicien Paul Touvier, qui, ainsi, pourra mettre du beurre dans ses épinards. L’affaire a pu se faire grâce au parrainage de Jacques Brel, qui l’avait introduit chez Philips. Paul Touvier avait fait sa connaissance en octobre 1959, lors d’un concert que le chanteur avait donnée à Tarare, proche de Lyon. Les deux hommes étaient suffisamment proches pour que Jacques Brel ait mis un temps à la disposition de Paul Touvier le chalet qu’il avait acheté à Saint Pierre de Chartreuse en 1965.
Georges Pompidou, président de la République en 1972, répondra lors d’une interview sur la mesure de grâce envers Paul Touvier qu’il prit le 23 novembre 1971 :
Tout d’abord, les faits. Ce M. Touvier a été condamné à mort à la Libération, par contumace. Je suppose que tous les Français savent que cela veut dire qu’il ne s’est pas présenté à l’audience. Il se cachait. La chancellerie considère et a considéré que ces condamnations à mort par contumace étaient prescrites, c’est-à-dire qu’elles n’avaient plus d’existence, donc le problème ne m’a pas été posé, et il n’aurait d’ailleurs pas pu l’être car je ne peux pas gracier les condamnés par contumace.
Donc, ma grâce a consisté uniquement à relever M. Touvier de l’interdiction de séjour et de la confiscation de ses biens officiels, en l’espèce, de la possession en indivision d’une maison avec quatre ou cinq frères et sœurs. Voilà le dossier tel que je l’ai traité et les faits ramenés à leur exactitude. Mais, par contre, je ne l’ai pas relevé de ses droits civiques, ni d’un très grand nombre d’incapacités. Il est toujours frappé de ce qu’on appelle la mort civile.
Alors on m’a demandé de me justifier, voire de révoquer ma décision, même des juristes. Le droit de grâce n’est pas un cadeau fait au chef de l’État pour lui permettre d’exercer ses fantaisies. C’est une responsabilité, parfois effrayante, qu’on lui impose et qu’il prend au vu des dossiers, bien sûr, et seul, avec sa conscience, et la tradition, et le devoir, l’empêche et de s’expliquer et, bien sûr, de revenir sur ses décisions. Imaginez ce que cela donnerait dans d’autres cas, une condamnation à mort, par exemple. Ce qui ne veut pas dire que la grâce constitue une absolution de la faute, ni que, si peu que ce soit, elle diminue la pitié ou le respect que l’on doit aux victimes. Elle est purement et simplement un acte de clémence et c’est tout.
Mais si je ne m’explique pas, et si je ne peux, ni ne veux, revenir sur cette décision, je puis, par contre, vous indiquer quelques réflexions que m’ont inspirées les réactions que j’ai reçues, par un très nombreux courrier, souvent émouvant et auquel je n’ai pas répondu, individuellement, mais, grâce à cette question, je peux y répondre collectivement.
Notre pays, depuis un peu plus de trente ans, a été de drame national en drame national. Ce fut la guerre, la défaite et ses humiliations, l’occupation et ses horreurs, la Libération, par contrecoup, l’épuration et ses excès, reconnaissons-le, et puis la guerre d’Indochine, et puis l’affreux conflit d’Algérie et ses horreurs, des deux côtés, et l’exode d’un million de Français, chassés de leurs foyers, et du coup, l’OAS et ses attentats, et ses violences et, par contrecoup, la répression.
Alors, ayant été, figurez-vous, dénoncé par les gens de Vichy à la police allemande, ayant échappé deux fois à un attentat de l’OAS, une tentative, une fois aux côtés du général de Gaulle et l’autre fois à moi destinée, je me sens le droit de dire : allons-nous éternellement entretenir saignantes les plaies de nos désaccords nationaux ? Le moment n’est-il pas venu de jeter le voile, d’oublier ces temps où les Français ne s’aimaient pas, s’entre-déchiraient et même s’entre-tuaient ? et je ne dis pas ça, même s’il y a ici des esprits forts, par calcul politique, je le dis par respect de la France.
16 05 1967
Les négociations sur les tarifs douaniers – Kennedy Round – aboutissent à une baisse de 40 % des droits de douane sur les produits industriels des 50 pays qui représentent 80 % du commerce mondial.
27 05 1967
Au sud-est du Nigéria, la province du Biafra, riche de gisements de pétrole et de ses aptitudes au travail, proclame son indépendance : c’est le début d’un génocide qui fera 2 M. de morts, sur les 14 M. que compte le Biafra. La guerre prendra fin le 12 janvier 1970. Du début à la fin du conflit, le Biafra sera resté dramatiquement seul, face à un Nigeria qui aura rassemblé à ses côtés les ennemis d’hier, Etats-Unis, Angleterre, Russie. Seules la Tanzanie, le Gabon, la Côte d’Ivoire et la Zambie le reconnaîtront. La France enverra officieusement armes et secours, via le Gabon et le Côte d’Ivoire. Le Gabon accueillera des orphelins. L’ensemble des pays africains est habité par la hantise de l’éclatement des frontières héritées de la colonisation : ce serait une explosion sans fin d’indépendances, jusqu’à se retrouver avec des frontières reprenant les contours des ethnies : impensable ! C’aurait été le retour à l’Afrique confetti d’avant les colonisations, à l’exception des rares royaumes existant encore à la fin du XIX° siècle, et l’Afrique aurait alors perdu tout possibilité de développement économique et d’influence à l’international.
Tu te taisais pendant que nous mourions.
As-tu vu ces photos en soixante-huit
D’enfants aux cheveux réduits en rouille,
Touffes étiolées lovées sur ces petites têtes,
Et puis qui tombent, comme des feuilles pourries s’émiettent ?
Imagine des enfants aux bras comme des allumettes,
Le ventre en ballon de foot, peau tendue à craquer.
C’était le kwashiorkor – mot compliqué,
Un mot pas encore assez hideux, un péché.
Tu n’as pas besoin d’imaginer. Les photos
S’étalaient dans les pages luxueuses de ton Life.
Les as-tu vues ? As-tu eu de la peine, un instant,
Avant, vite, d’enlacer ta femme, ton amant ?
Leur peau avait pris la teinte acajou d’un thé léger,
Dévoilant un réseau de veines et d’os cassants ;
Des enfants nus qui riaient, comme si l’homme
N’allait pas prendre ses photos et puis partir, les laissant.
Chimamanda Ngozi Adichie. L’autre moitié du soleil Gallimard. 2006
C’est la naissance de l’humanitaire moderne : Bernard Kouchner, – que l’on dira plus tard un tiers mondiste, deux tiers mondain [6] -, Claude Malhuret, Xavier Emmanuelli interviennent au titre de la Croix Rouge ; gênés par le silence que leur impose la déontologie de ce mouvement, ils le quittent, et fonderont, 4 ans plus tard, Médecins sans frontières.
Sur le terrain de la guerre, l’humanitaire côtoie les marchands d’armes : et il se trouve que ceux-là peuvent être aussi suisses : après la capitulation du Biafra, les contrôleurs de l’ONU trouveront dans ses casernes des douzaines de canons Bührle-Oerlikon, frappés de la croix gammée et des numéros de série allemands : c’était des canons que la Suisse s’apprêtait à livrer à l’Allemagne en 1945 quand sa capitulation vint mettre fin aux livraisons ; mais ces armes avaient déjà été payées. En les vendant une seconde fois, Dieter Bührle fit donc une très bonne affaire, dont il dût tout de même déduire les 20 000 FS d’amende demandés par le Tribunal fédéral pour n’avoir pas respecté l’embargo.


28 05 1967
Sir Francis Chichester revient d’un tour du monde de 28 000 miles à bord du Gipsy Moth IV. Il a 65 ans ; 10 ans plus tôt, il avait été atteint d’un cancer.

31 05 1967
Le roi Fayçal d’Arabie Saoudite, en visite officielle en Belgique, se voit remettre par un ministre belge la clef d’un très beau pavillon d’exposition orientaliste du jardin du Cinquantenaire, pavillon qu’il nomme pour l’occasion mosquée, à charge à l’Arabie Saoudite d’entreprendre les travaux nécessaires pour répondre à cette nouvelle fonction. Si la Belgique voulait dérouler le tapis rouge au wahhabisme saoudien, elle ne pouvait mieux s’y prendre. Les extrémistes de l’islam s’engouffreront sur cette autoroute en se concentrant sur le quartier de Molenbeek.
5 au 11 06 1967
Guerre des Six Jours, entre Israël et l’Égypte ; en six jours, les troupes israéliennes auront anéanti trois armées, détruit 80 % du matériel égyptien et conquis des territoires quatre fois plus vastes que leur État au prix de pertes très limitées : 679 tués, 2 563 blessés. Dans les mois qui suivirent, un haut responsable égyptien s’emportera devant l’ambassadeur soviétique :
- Tout cet armement que vous nous avez vendu ne vaut rien !
- Nous avons fourni le même aux Vietnamiens !
Un an plus tard, David Ben Gourion déclarera : Si je devais choisir entre la paix et les territoires conquis l’année dernière, je choisirais la paix.
11 06 1967
Le paquebot Lydia a 36 ans d’âge. Les fées du troisième âge se sont penchées sur lui pour lui offrir une vieillesse à faire pâlir d’envie tous les vieux rafiots qui rouillent dans des cimetières abandonnés ou partent à la découpe chez les ferrailleurs comme les bœufs à l’abattoir. Ce jour-là, deux remorqueurs le hâlent au fond d’un chenal creusé pour lui, d’où il sera hissé trois mètres au-dessus du niveau de la mer, sur le lido du Barcarès, entre mer et étang, dans le Languedoc Roussillon, et en avant toute pour une vieillesse de folie ! que des folles nuits animées par le monde du showbiz, ouvert un temps au public, réservé un autre temps aux copains-copines d’une milliardaire japonaise. Et ce n’est pas de l’eau de mer ni d’Évian qui coulent à flots ! Ces agitations de vieille dame indigne le fatigueront et aujourd’hui il se contente de rouiller tout en recevant des expositions, beaucoup plus paisibles. Où peut-on voir à l’heure actuelle un bateau de 84 ans se prélasser sur la plage ?
Construit en 1931 dans un chantier danois, alors le seul à motoriser en diesel des paquebots, pour le compte d’une compagnie australienne, il se nommait alors le Moonta. Au départ, paquebot mixte de 91 mètres de long, il était à même d’emmener 157 passagers, à des prix défiant toute concurrence, pour caboter le long des côtes sud de l’Australie : nombre de jeunes mariés y avaient fait leur voyage de noce. Des Grecs l’avaient racheté en 1955, le rebaptisant Lydia et le transformant pour qu’il puisse accueillir 460 passagers. Il naviguera en Méditerranée jusqu’en 1967.
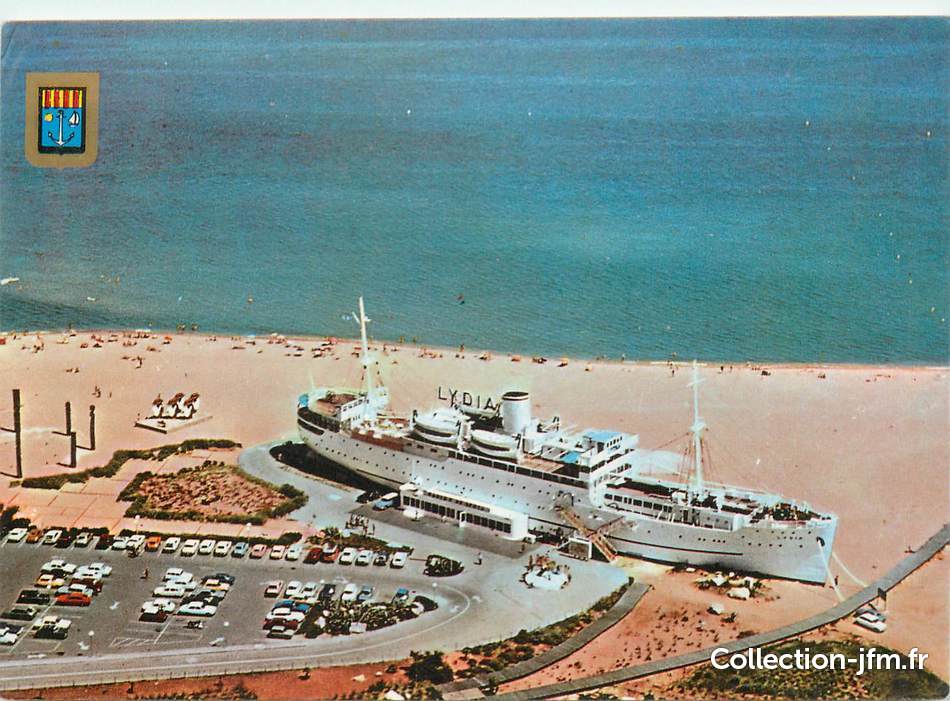

7 07 1967
Le Tour de France passe par le Ballon d’Alsace. Poulidor est tombé dans la descente du Harrenberg et termine l’étape sur le vélo de son coéquipier Delberghe ; la montée est une descente aux enfers…
Précédé par l’Espagnol Aranzabal, comme par un appariteur à chaîne, le Tour s’avançait par monts et par Vosges à pédales feutrées, à travers un brouillard qui masquait aux acteurs eux-mêmes les fils de la conjuration qui était en train de se nouer. Quand on redescendait dans les vallées, une pluie diluvienne, les incitant à se réfugier dans le peloton de Noé, étouffait leur lucidité stratégique sous une résignation humide. Les grandes résolutions tactiques ne pouvaient faire long feu chez les hommes qui, dans un cas comme dans l’autre, n’y voyaient pas plus loin que le bout de leur nez. Ce n’était donc pas encore la guerre déclarée et cependant, comme on dit dans le langage diplomatique, c’était assurément déjà l’escalade. On venait de passer trois ou quatre cols d’appellation plus ou moins contrôlable, les ascensions et les descentes se chevauchant en un toboggan continuel, quand il apparut que la tension, elle aussi, se mettait à monter à l’intérieur de la course, et que les ingrédients de l’exploit ou de la défaillance se trouvaient rassemblés, avec pour excipient en quantité suffisante la débauche d’efforts accomplie par tout un chacun depuis quelques jours. Cela commença par des signes avant-coureurs qui nous étaient donnés, en l’occurrence, par des coureurs de l’arrière. Dès qu’on peut associer un nom à un paysage, c’est que le rideau vient de se lever. Avec les premiers lacets du collet du Linge, quelques-unes de nos silhouettes les plus familières, blanches comme un collet du même nom, nous apparurent au détour des sapins, égrenées dans leur solitude respective. Puis, […] nous plongeâmes sur Munster où nous attendait la fameuse tarte chaude aux myrtilles – car ces cols impitoyables sont également des cols à manger de la tarte. C’est la dernière bouchée dans le bec, avec devant les yeux une pancarte qui proclamait : Zimmermann, 1er au Ballon d’Alsace, que nous apprîmes l’abandon de celui-ci, signalé par la gendarmerie. L’expression coutumière prenait pour une fois un sens terrible, comme s’il se fût agi d’un malfaiteur. Après tout, peut-être les gendarmes allaient-ils le conduire au Ballon ? C’est vers le Ballon, en effet, que convergeaient tous les calculs et toutes les énergies, ceux d’un Pingeon qui ressemblait plus que jamais à une cigogne déroutée dans sa migration, d’un Gimondi aux abois depuis le départ, d’un Aimar fureteur, d’un Poulidor livré aux bêtes. Depuis la descente du col du Harrenberg où il était tombé sans gravité, Poulidor, piégé dans un groupe légèrement attardé, portait tout le poids d’une chasse de plus en plus vaine, sur un vélo d’emprunt. Verrouillé par les Italiens de circonstance, traînant derrière lui sur plus de trente kilomètres, non pas vingt forçats mais vingt boulets de la route, il savait que pour sa part c’est, si l’on ose dire, en captif qu’il aborderait le Ballon. Il se montra néanmoins grandiose, fou de prodigalité, et le contrecoup fut terrible. Mais nous avons vu trop souvent sans grande émotion Poulidor perdre de justesse pour ne pas affirmer à quel point nous l’avons aimé aujourd’hui dans l’ampleur qu’il sut donner à son drame. On y devinait la carrure de l’homme. Ce drame éclata à Bussang, au pied de l’ascension, quand ce qui n’était encore qu’une malencontreuse péripétie collective, une faillite chiffrable, se mua en un de ces désastres individuels où l’on vit rarement sombrer un champion. À ce moment, on ne pouvait dévisager Poulidor, les joues creuses, le regard absent, l’oreille sourde, dépassé par des coureurs qui ne lui arrivent pas à la cheville, et le plus souvent ceux qu’il avait traînés après lui, sans que le cœur ne fendît. Ce corps cassé en deux, ces mains hagardes qui se tendaient dans le vide, cette soif qui était celle de la passion et de la fièvre évoquaient une affreuse agonie. La foule, exemplaire en ce qu’elle ne chercha à aucun moment à pousser Poulidor, comprenant que ce n’était plus le champion mais l’homme même qui était en cause, convertit spontanément son admiration en tendresse et c’est sans doute porté par les anges que Poulidor trouva la ressource d’atteindre le sommet. Pour ce qu’il contient de sensationnel, le calvaire de Bussang aura sa place dans la mémoire. Il reste qu’en sport tout ce qui se rapproche du fait divers n’est guère aimable et qu’à cet égard la déroute de Poulidor est un modèle du genre.
Antoine Blondin. L’Équipe du 8 juillet 1967, in Tours de France. La Table Ronde, 2000.
13 07 1967
Une semaine plus tard, le Tour de France est au Ventoux : Tom Simpson meurt à 36 ans sur ses pentes, victime du cocktail dopage/chaleur.

Tommy Simpson is seen here competing in the 1964 Tour de France. One of Britain’s finest ever cyclists, Simpson tragically died of heat exhaustion during the 1967 race. The post-mortem examination found that Simpson had amphetamines and alcohol in his system. He still remains a hallowed figure in the cycling world – Simpson was also Britain’s first world road race champion in 1965, and won a bronze medal as part of the team pursuit team at the 1956 Melbourne Olympics
26 07 1967
Du balcon de l’hôtel de ville de Montréal, de Gaulle lance son Vive le Québec libre. Il avait déjà bousculé le programme du voyage, en faisant passer le Québec avant Ottawa ; les autorités fédérales souhaitent lui signifier que sa visite n’est plus de mise, quand il leur coupe l’herbe sous les pieds en disant : Je rentre.
6 08 1967
À Lisbonne, inauguration du pont Salazar sur le Tage, long de 2 278 m. Après la chute de Salazar, il sera rebaptisé Pont du 25 Avril (jour de la révolution des œillets, en 1974).
22 08 1967
À Pékin, les Gardes rouges incendient les bureaux du chargé d’affaires britannique.
juillet-août 1967
François Spoerry, architecte de Mulhouse, qui a une maison à Cavalaire, a acheté en 1962 30 hectares qui attendaient un acquéreur depuis 7 ans, – ils deviendront 75 -, dans le fond du golfe de Saint Tropez, près de l’embouchure de la Giscle, une zone marécageuse infestée de moustiques. Il projette d’y édifier une marina avec un anneau de mouillage devant chaque maison. Premier permis de construire le 14 juin 1966. Cette cité lacustre sera édifiée sur la terre avant que la mer n’y soit amenée par l’intermédiaire de canaux qui seront consolidés pour éviter la pollution de la nappe phréatique. Les futures îles et presqu’îles qui doivent former la cité sont préalablement délimitées par des palplanches d’acier destinés à stabiliser la terre, puis elles sont surélevées par les déblais issus des canaux qui sont creusés au ras de ces palplanches. Il livre la première tranche de 75 maisons et 40 appartements de Port-Grimaud. Les travaux se poursuivront jusqu’aux années 2000 : cet ensemble immobilier unique s’étend sur 75 hectares et représente au total 2 400 logements, plus de 2 000 places de bateaux, 7 km de canaux, 14 km de quais, quatorze ponts plus une passerelle en bois, ainsi que douze îles.


Il y manque l’essentiel : la patine des ans
3 09 1967
En Suède, la circulation automobile passe de gauche à droite.
_________________________________________________________________________________________
[1] Même au plus fort de sa crue, l’Arno aura un débit de l’ordre du cinquième de celui du Mississipi : 3 500 m³ contre près de 17 000 m³.
[2] En entrant en ville, les eaux furieuses de l’Arno ont commencé éventrer les cuves de gasoil des immeubles collectifs, quasiment toutes remplies à l’approche de l’hiver.
[3] J’ai appris depuis que les pompiers étaient restés en alerte plusieurs semaines, à cause du risque d’incendie lié à l’épaisseur de la nappe de mazout déposée en ville. (NdA)
[4] Pire que la guerre. (NdT)
[5] À une si belle vie de citoyens […] à un séjour si doux. Dante, Divine Comédie, Le Paradis, chant XV, traduction de Jacqueline Risset (Flammarion, 1990).
[6] L’auteur de la formule, dont l’intelligentzia de gauche dénoncera avec emphase le très mauvais goût, ne pouvait soupçonner qu’il avait été en fait bien gentil, très en dessous de la réalité ; et c’est la fille de Bernard Kouchner, Camille qui, en 2021, sortira Familia grande, où elle révélera qu’Antoine, son frère jumeau, avait connu pendant des mois les abus sexuels de la part de son beau-père Olivier Duhamel. Antoine ne sera pas partisan de mettre tout cela sur la place publique, mais quand sa sœur le fera, elle lui fera lire le texte avant de l’envoyer à l’éditeur et il dira : tout ce qu’a écrit ma sœur dans ce livre est exact.
Retour en arrière : Bernard Kouchner et Évelyne Pisier, sœur de Marie-France, ont trois enfants, dont les deux derniers, Camille et Antoine sont jumeaux. Bernard et Evelyne se séparent, et Evelyne vit désormais avec Olivier Duhamel, constitutionnaliste reconnu par toute l’intelligentzia de gauche sur la place parisienne et ce dernier devient de fait l’éducateur des enfants de Bernard Kouchner. Évelyne s’échappe fréquemment dans l’alcool et Olivier passe ses instincts sexuels avec Antoine. Dans la famille, cela se sait, Bernard Kouchner inclus, qui s’avance en terrain découvert – je vais lui péter la gueule – mais en fait ne fait RIEN. Ainsi, ce soignant fait-il le tour du monde pour prêter assistance aux peuples en danger, lorsque les médias le suivent, mais lorsque c’est son propre fils qui est en danger, il ne bouge pas le petit doigt, puisque les médias ne sont pas là. Un sommet dans la tartuferie !
Que la victime, Antoine ait demandé à son père de ne rien entreprendre, c’est une chose qui ne regarde que lui, mais en quoi cette demande pourrait-elle venir faire obstacle à l’application de la loi ? De toutes façons, la loi n’y trouvera rien à redire, puisque l’affaire sera classée sans suite le 14 juin 2021, les faits étant prescrits. La prescription, les juges la mettent en avant ou au rebut selon leur humeur, illustrant ainsi le fameux selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.

Laisser un commentaire